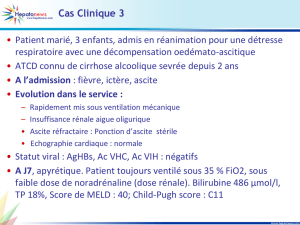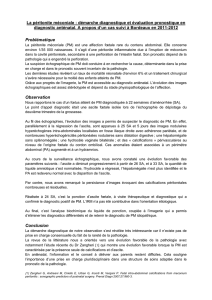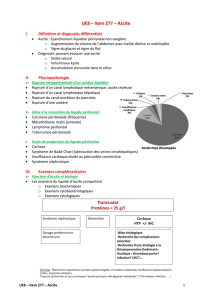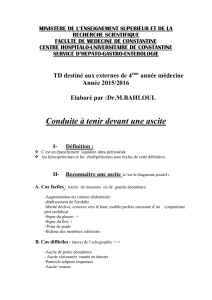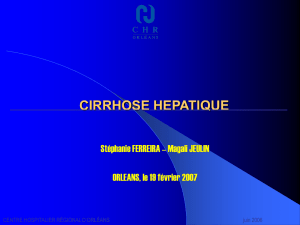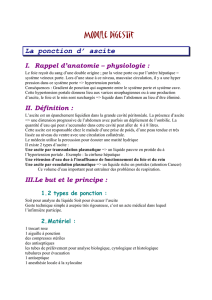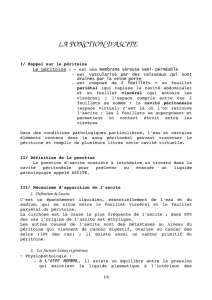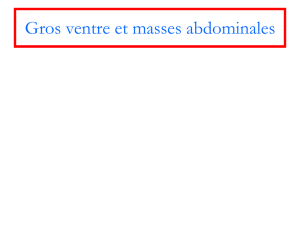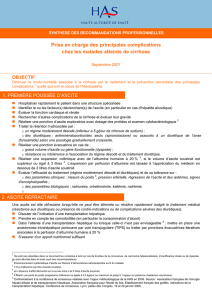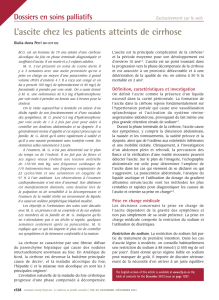02/03/2016 ROUX Alexandra L2 CR : Nyl CHEMLI Digestif

DIGESTIF - Ascites
02/03/2016
ROUX Alexandra L2
CR : Nyl CHEMLI
Digestif
Pr. D. BOTTA-FRIDLUND
10 pages
Ascites
L'ascite est un symptôme qu'on retrouve dans beaucoup de maladies et beaucoup de spécialités, et pour
lesquelles l'enquête étiologique (pour trouver la cause) est assez vaste. Quand on est face à une ascite, on pense
cause hépatique car c'est la plus fréquente.
A. Définition et sémiologie du péritoine
Le péritoine est composé de 2 feuillets : le péritoine pariétal et le péritoine viscéral, avec une cavité virtuelle.
Une ascite se définit comme la présence d'un liquide sérofibrineux dans la cavité péritonéale. Ce liquide n'est
pas n'importe lequel, c'est un liquide transparent, clair, limpide, avec absence de sang, de pus ou de bilH
A l'état pathologique, on peut également avoir :
–Hémopéritoine : si distension par du sang
–Pneumopéritoine : si distension par de l'air
–Péritonite : si distension par du pus (perforation d'un abcès, d'un organe avec une surinfection)
–Cholépéritoine : si distension par de la bile (perforation des canaux biliaires)
Si la distension est due à un liquide limpide qui n'est ni du sang, ni de la bile, ni du pus, on parle d'ascite. Mais
dans le cas d'un épanchement de sang ou de bile, les causes et les circonstances diagnostiques sont différentes.
Le liquide peut parfois être chyleux (rempli de triglycérides, de lipides pendant la période postprandiale). On
parle d'ascite chyleuse (fuite lymphatique). Cette ascite fait aussi partie des ascites car l'enquête est similaire à
celle des autres ascites.
1/10
Plan :
A. Définition et sémiologie du péritoine
B. Éléments du diagnostic et sémiologie
I. Éléments du diagnostic
II. Examen clinique
III. Diagnostics différentiels
C. Physiopathologie et étiologies
D. Composition
I. Ponction
II. Contenu
E. Mécanismes de l'ascite transsudative
F. Complications
G. Diagnostic
I. Diagnostic étiologique
II. Démarche diagnostique
H. Causes des ascites

DIGESTIF - Ascites
B. Éléments du diagnostic et sémiologie
I. Éléments du diagnostic
C'est parfois évident lorsque le patient arrive avec un ventre énorme.
L'ascite se recherche à l'examen clinique. L'installation est rapide ou progressive. L'ascite est généralement
indolore (ou peut entraîner quelques faibles douleurs abdominales pendant son installation), ce qui permet
d'orienter le diagnostic. C'est la prise de poids et l'augmentation du volume du ventre qui est la cause de la
venue du patient.
Elle devient gênante lorsque son volume augmente trop et provoque :
–une augmentation du volume de l'abdomen
–un déplissement de l'ombilic, voire une hernie ombilicale
–une dyspnée (par gêne du mouvement du diaphragme)
–une prise de poids
CR : c'est la prise de poids et l'augmentation progressive de l'abdomen qui fait s'inquiéter les patients, et non la
douleur.
Elle est détectable cliniquement si la quantité de liquide est supérieure à 2 litres. Une ascite de faible abondance
ne peut être détecté que par échographie.
Dans le cas où on peut la détecter cliniquement, le diagnostic est confirmé par ponction (quand volume très
important) ou échographie.
A retenir : Dyspnée + douleurs importantes + complications sur l'Ombilic → ponction urgente de l'ascite
II. Examen clinique
a) Inspection
A l'inspection l'abdomen est distendu, augmenté de volume de façon
symétrique mais variable selon la position du sujet en fonction de la
pesanteur. La peau est lisse, tendue et luisante.
L'ombilic peut être déplissé. Un œdème hypogastrique ou du scrotum ainsi
que la saillie d'une hernie sont fréquemment associés (ascite inguino-
scrotale).
Au niveau du grill costal et des flancs une circulation veineuse collatérale
cave supérieure ou inférieure ou cave/cave doit être recherchée (signe
d'hypertension portale).
Le patient peut être jaune.
b) Percussion
A la percussion on entend une matité de l'hypogastre et des flancs :
–déclive
–mobile
–concave vers le haut
–avec un tympanisme péri ombilical.
La matité et les autres sonorités sont variables avec la position du malade, c'est une matité mobile. Il est
nécessaire de mobiliser le patient pour mettre en évidence une ascite de faible abondance. C'est une matité
déclive car plus importante sur les flancs du patient.
2/10

DIGESTIF - Ascites
Ailleurs la matité est dite « en damier », hétérogène : c'est la signification d'une ascite infectée, purulente ou
néoplasique.
A la percussion :
–si c'est sonore → c'est de l'air
–si c'est mat → c'est du liquide
c) Palpation
La palpation des organes intra-abdominaux est difficile, surtout si l'ascite est très importante. On peut détecter
2 signes :
–le signe du glaçon : choc en retour lié à la remontée du foie au sein du liquide d'ascite, il faut que le foie
soit dur, palpable. Il « flotte » dans l'ascite. Ce signe se voit essentiellement dans les cirrhoses.
–le signe du flot : il s'agit de la transmission de l'onde à travers le liquide. On place une main d'un côté
du ventre, on donne une petite tape de l'autre côté et on doit sentir l'onde arriver sur l'autre main. C'est la
transmission transabdominale liquidienne d'une pression controlatérale.
d) Autres signes
D'autres signes sont à rechercher :
–épanchements pleuraux, surtout à droite (CR : à rechercher en second)
–œdèmes des membres inférieurs → anasarque (= œdème généralisé) (CR : à rechercher en priorité)
–dyspnée et tachycardie dans les grands épanchements (compression du diaphragme et de l'oreillette
droite)
–touchers pelviens
III. Diagnostics différentiels
Les diagnostics différentiels de l'ascite sont :
–le globe vésical (vessie gonflée car ne peut s'évacuer donc matité convexe vers le haut, avec symptômes
douloureux)
–une obésité abdominale importante (CR : ex → un syndrome métabolique, c'est l'échographie qui
différencie)
–un volumineux kyste (ovarien, rénal ou hépatique) ou une tumeur kystique
➢matité déclive mais non mobile et concave vers le bas
➢sonorité des flancs
➢l'échographie corrige le diagnostic
3/10

DIGESTIF - Ascites
–autres épanchements (sang, bile, chyle)
➢entraînent des douleurs +++ (CR : les douleurs dans les épanchements sont très importantes et
permettent d'orienter les diagnostics différentiels
➢sont différenciés grâce à la ponction
Photo en haut à droite : étranglement d'une hernie
ombilicale → ponction d'urgence.
L'ascite peut également se rompre.
L'ascite à l'imagerie :
–Échographie : la poche noire est du liquide donc de l'ascite.
–Tomodensitométrie : liquide autour du foie (CR : foie en gris claire à gauche de la photo, liquide
autour gris foncé)
C. Physiopathologie et étiologies
Est-ce une ascite mécanique ou inflammatoire ?
Il existe 3 types de mécanismes principaux de formation d'ascite dont 2 principaux :
1) Excès de production de liquide péritonéal (++)
→ Ascite mécanique. On parle de transsudat. Une hyper pression entraîne une sortie de liquide des vaisseaux.
Les causes sont :
–hypertension portale (HTP) due à la cirrhose (CR : HTP responsable également d'une grosse rate)
–insuffisance cardiaque droite (→ hyperpression dans système cave inférieur)
–péricardite.
4/10

DIGESTIF - Ascites
2) Gêne à la résorption du liquide péritonéal par obstruction ou inflammation péritonéale (++)
Ascite inflammatoire. On parle d'exsudat.
Les causes sont :
–carcinose péritonéale (CR : métastase péritonéale, l'ascite peut être révélatrice du cancer sous-jacent
mais il est déjà à un stade métastatique et extensif
–tuberculose abdominale (CR : Tuberculose = granulations du péritoine, avec exsudation)
–mésothéliome (cancer primitif de la plèvre)
3) Rupture intra-péritonéale d'un conduit liquidien : (moins fréquente)
–canal lymphatique intestinal : ascite chyleuse (blanche comme du lait) car riche en chylomicrons
–canal lymphatique hépatique : après chirurgie hépatique
–canal pancréatique : pancréatites aiguës, (ou fracture du pancréas lors d'un accident de voiture par
exemple)
–uretère : traumatisme, chirurgie
D. Composition
I. Ponction d'ascite
Vient après le diagnostic. L'endroit classique de la ponction est à gauche. On prend la ligne entre l'épine iliaque
antéro supérieure et l'ombilic et on pique au 2/3 en partant de l'ombilic. Mettre le patient en déclive suffit pour
vider l'ascite, pas besoin d'aspirer. CR : c'est une procédure très réglementé, on pratique TOUJOURS aux 2/3)
II. Contenu
On prélève 4 tubes lors de la ponction d'ascite pour faire 4 études : l'aspect du liquide, la biochimie, la cytologie
et la bactériologie.
a) Aspect du liquide
Le liquide est clair et transparent ou légèrement trouble. Il peut être légèrement rosé si c'est une ascite
hémorragique ou lactescent si c'est une ascite chyleuse.
Si le liquide est trouble → on suspecte une inflammation.
Si c'est une ascite hémorragique → on suspecte une ascite cancéreuse.
5/10
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%