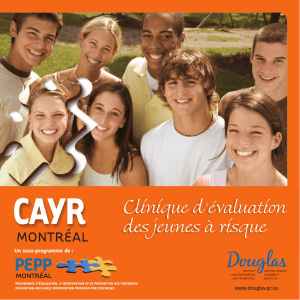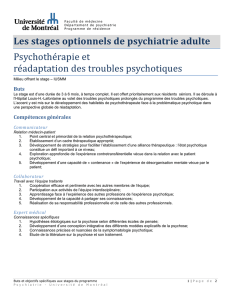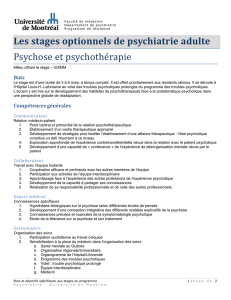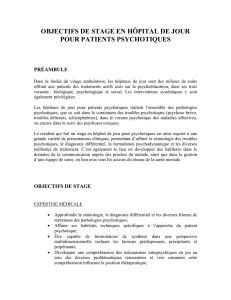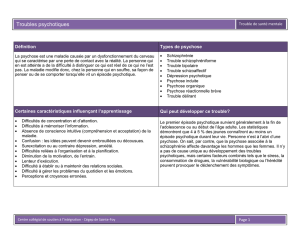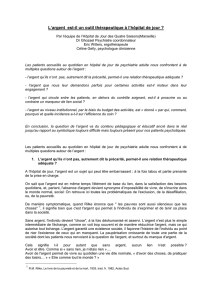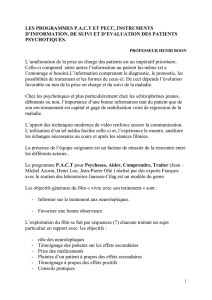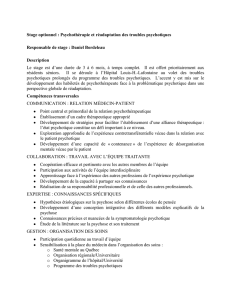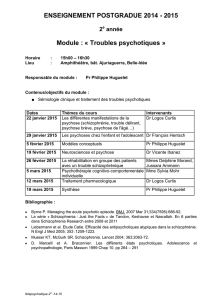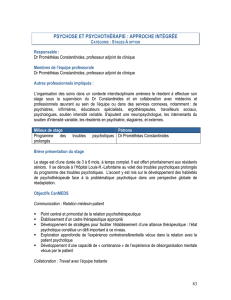Premier épisode psychotique: un défi particulier pour le

Forum Med Suisse 2012;12(20–21):402–405 402
Actuel
Premier épisode psychotique: un dé particulier
pour le diagnostic différentiel et le traitement
Andor E. Simona, b, f, Anastasia Theodoridouc, f, Roland Schneiderd, f, Philippe Conuse, f
Introduction
Au cours de ces 15 dernières années, le diagnostic et le
traitement précoces des troubles psychotiques se sont
développés et constituent désormais un domaine de re-
cherche intensive en psychiatrie. Parallèlement aux ef-
forts consentis dans de très nombreuses disciplines de
la médecine somatique, l’ambition à l’égard des troubles
psychotiques est de pouvoir dépister à temps ces mala-
dies psychiatriques qui sont potentiellement graves, de
manière à prévenir le développement de leur tableau
clinique complet ou tout au moins d’en inuencer favo-
rablement l’évolution. La phase précoce des troubles psy-
chotiques se divise en deux: la phase dite prodromale et
le premier épisode psychotique qui lui fait suite [1]. L’ ad-
jectif prodromal ne peut par dénition être utilisé que
rétrospectivement, après la manifestation d’un premier
épisode psychotique constitué. Prospectivement, avant
que le seuil de psychose ne soit atteint, on doit parler
«d’état de haut-risque» et les expressions «at-risk men-
tal state» ou «clinical high risk» sont utilisées dans la
littérature [1]. Dans le domaine des états à haut risque,
la recherche se focalise avant tout sur l’identication de
critères permettant de prédire le risque de transition
vers la psychose constituée [2]. Dans le domaine des
premiers épisodes psychotiques, l’attention est surtout
portée à la mise en place d’un traitement adéquat et ce
dans les plus brefs délais.
Swiss Medical Forum a publié plusieurs articles sur la
phase psychotique précoce ces dernières années. Ils
s’intéressaient principalement aux questions relatives à
la phase prodromale ou aux états à haut risque de psy-
chose [1, 3–5]. Le présent article ne traite que du premier
épisode psychotique et montre dans une première partie
que le diagnostic différentiel est un dé complexe posé
aux cliniciens, tant il est souvent difcile dans cette
phase de la maladie de classier les patients dans l’un
des deux grands groupes de psychoses, affectives
(trouble bipolaire et dépression) ou non affective (prin-
cipalement la schizophrénie). Dans la seconde partie,
nous discutons des éléments importants du traitement
qui feront prochainement l’objet d’un symposium inter-
national organisé dans le cadre du réseau Swiss Early
Psychosis Project (SWEPP).
Nosologie du premier épisode psychotique
Lorsqu’une psychose est diagnostiquée on pense tout
d’abord soit à une schizophrénie soit à un trouble bi-
polaire. Cette dichotomie des psychoses fonctionnelles
non organiques date de plus d’un siècle, et se base sur
le concept, proposé par Emil Kraepelin en 1896, de la
distinction entre dementia praecox (de mauvais pro-
nostic) et troubles maniaco-dépressifs (de meilleur pro-
nostic) [6]. Kraepelin déjà, et plus tard Kurt Schneider
[7], ont décrit des symptômes présents dans ces deux
groupes diagnostiques, identiant ainsi des «cas inter-
médiaires» ne remplissant qu’insufsamment les cri-
tères des troubles schizophréniques ou affectifs quant à
leurs manifestations psychopathologiques et leur évolu-
tion. Cette question n’a cependant pendant longtemps
pas fait l’objet de beaucoup d’attention bien que Krae-
pelin ait déclaré dès 1920 que les cas ne pouvant être ca-
tégoriquement classés dans l’un de ces deux groupes de
maladies étaient «malheureusement très fréquents» [8].
Pour regrouper ces cas, Kasanin a introduit en 1933 le
terme de psychose schizoaffective [9], diagnostic qui re-
quérait selon lui un début aigu, une brève durée de l’épi-
sode et une rémission complète. Il tenait ainsi compte
d’un autre phénomène déjà observé dans les débuts de
la psychiatrie, à savoir que certains épisodes psycho-
tiques peuvent être de brève durée et avoir un excellent
pronostic.
Au XXe siècle, d’autres concepts diagnostiques ont été
élaborés pour ces psychoses de brève durée à bon pro-
nostic, par exemple les psychoses cycloïdes de la psy-
chiatrie allemande [10, 11], la bouffée délirante de la
psychiatrie française [12], la psychose psychogène ou
réactionnelle de la psychiatrie scandinave [13], la
psychose atypique de la psychiatrie japonaise [14], la
schizophrénie rémittente ou «good-prognosis» de la psy-
chiatrie nord-américaine [15] ou la psychose émotion-
nelle schizophrénotypique de la psychiatrie helvétique
[16, 17].
De nombreux arguments accumulés au l des ans
conrment qu’une distinction claire entre troubles schi-
zophréniques et troubles affectifs bipolaires n’est pas
toujours possible et suggèrent plutôt que ces deux groupes
diagnostiques se trouvent sur un continuum, ceci aussi
bien au plan de la symptomatologie qu’à celui du poten-
Les auteurs ne
déclarent aucun
soutien nancier ni
d’autre conit
d’intérêt en
relation avec cet
article.
a Ambulatorium Bruderholz, Psychiatrie Baselland
b Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie Bern
c Psychiatrische Universitätsklinik, Zürich
d Psychiatrische Klinik, Münsterlingen
e Service de Psychiatrie Générale, Département de Psychiatrie
CHUV, Université de Lausanne
f Swiss Early Psychosis Project (SWEPP)

Forum Med Suisse 2012;12(20–21):402–405 403
Actuel
tiel évolutif [18]. Le diagnostic différentiel est naturelle-
ment un peu plus facile quand il est posé rétrospective-
ment et que l’évolution est déjà connue, mais quand il
s’agit d’un premier épisode psychotique, la tâche est
souvent très complexe.
Classication des «cas intermédiaires» psychotiques
dans les systèmes de classication internationale
Un bref aperçu de l’évolution, au cours du temps, de la
classication nosologique des troubles schizoaffectifs et
des troubles psychotiques aigus et transitoires illustre à
quel point le diagnostic différentiel d’un premier épisode
psychotique peut être difcile en pratique clinique.
Dans le DSM-I (1952), le type schizoaffectif gurait dans
les réactions schizophréniques, et les critères proposés
par Kasanin (début aigu, brève durée de l’épisode et ré-
mission complète) n’en faisaient pas partie. En 1968,
aussi bien le DSM-II que l’ICD-8 introduisirent la caté-
gorie schizophrénie, type schizoaffectif, mais la dénition
était vague et ne com-
portait que l’association
de symptômes schi-
zophréniques et affec-
tifs. Dans le DSM-III
(1980), les psychoses
schizoaffectives avaient
pratiquement disparu:
les épisodes maniaques et d épressifs englobaient aussi
des cas de symptômes psychotiques affectivo-incon-
gruents, et ce n’est qu’en marge
qu’une catégorie
troubles
schizoaffectifs était ajoutée, mais sans aucune
directive diagnostique et avec la remarque qu’elle ne
devait être utilisée que s’il n’était pas possible de faire
la distinction entre trouble schizophrénique et affectif.
Dans la version révisée, DSM-III-R (1987), les troubles
schizo affectifs furent réintroduits comme troubles psy-
chotiques non autrement spéciés, et dans le DSM-IV
(1994) ils étaient rattachés à la catégorie des schizo-
phrénies et autres troubles psychotiques. En fonction
de la description encore vague du trouble schizoaffectif
dans le DSM-IV, le DSM-V apportera probablement plus
de précision, mais apparemment sans imposer claire-
ment cette catégorie diagnostique (www.dsm5.org). La
classication des troubles schizoaffectifs dans l’ICD-9
(1976) était la même que dans l’ICD-8, mais l’ICD-10
(1992), actuellement encore utilisée, présente les
troubles schizoaffectifs comme une catégorie à part en-
tière dans le chapitre des troubles schizophréniques et
délirants.
En ce qui concerne les psychoses aiguë et de brève
d urée à évolution favorable, ces deux systèmes de clas-
sication internationale n’ont introduit que relativement
tard les groupes diagnostiques leur correspondant, en
tentant d’intégrer les divers concepts nationaux aux-
quels ils correspondent. Dans l’ICD-10 (1992), on parle
de troubles psychotiques aigus et transitoires, et dans le
DSM-IV (1994) de troubles psychotiques brefs, les cri-
tères de ces deux groupes diagnostiques étant basés sur
des conventions plutôt que sur des preuves formelles.
Les critères de l’ICD-10 sont plus détaillés que ceux du
DSM-IV et distinguent plusieurs sous-types. Les troubles
psychotiques aigus et transitoires se manifestent de
manière aiguë, sont de brève durée, les patients ré-
pondent bien aux antipsychotiques et leur pronostic est
bon malgré d’éventuelles récidives. Ils se distinguent
aussi des psychoses schizophréniques par l’absence
de décit préalable au niveau des fonctions psycho-
sociales.
Implications pour la clinique et la recherche
Bien qu’il faille tenir compte des critères des systèmes
de classication mentionnés ci-dessus pour le diagnostic,
les nombreuses révisions de ceux-ci au cours des der-
nières décennies montrent qu’ils ne permettent pas
toujours de donner une image dèle et stable des pa-
thologies psychotiques telles qu’on les observe dans la
réalité clinique. Ces systèmes de classication ne tiennent
par exemple aucun compte du fait que les troubles schi-
zoaffectifs ne sont pas toujours monomorphes, et qu’ils
peuvent aussi avoir une évolution polymorphe, c.-à-d.
qu’à long terme il peut y avoir des épisodes aussi bien
schizophréniques qu’affectifs [19].
De même, les critères pour qu’un diagnostic de trouble
psychotique aigu et transitoire puisse être posé, concer-
nant dans l’ICD-10 avant tout la durée maximale des
symptômes psychotiques, sont trop peu spéciques
pour guider le traitement dans la réalité clinique [11,
19, 20]. La classication proposée dans l’ICD-10 consti-
tue en effet un appauvrissement par rapport à la descrip-
tion extrêmement détaillée des psychoses cycloïdes de
Leonhard [11]. On remarque ainsi souvent que seuls
l’examen psychopathologique approfondi et l’observation
de l’évolution des symptômes au l du temps dans le
contexte d’un programme de soins structurés permettent
de déterminer précisément le type de psychose dont
souffre le patient.
Considérant la complexité de ce diagnostic différentiel
et le côté parfois relativement arbitraire des éléments
qui les différencient, on suggère plutôt de recourir à des
concepts diagnostiques
plus généraux tels que
«premier épisode psy-
chotique» ou «psychose
émergente» et de ne po-
ser un diagnostic caté-
goriel précis qu’avec un
certain recul. On sug-
gère également de recourir à un concept de diagnostic
dimensionnel plutôt que catégoriel, dans le cadre du-
quel on prend en compte les divers éléments du tableau
clinique (symptômes positifs, symptômes négatifs, ma-
nie, dépression) pour orienter le choix du traitement.
Tr aitement
Les études conduites chez des patients présentant un
premier épisode de psychose ont mis en évidence qu’un
long délai, en moyenne de 2 ans, sépare l’apparition des
symptômes et la mise en route du traitement (durée de
psychose non traitée, DUP), et que ce délai pouvait
avoir des conséquences importantes: risque de suicide,
détérioration de l’intégration sociale, développement
de co-morbidités, moins bonne réponse au traitement
Dans le cadre des premiers
épisodes psychotiques,
l’attention est surtout portée
à la mise en route d’un
traitement adéquat dans les
plus brefs délais
Plusieurs arguments sug
gèrent qu’une distinction
claire entre troubles schizo
phrènes et affectifs bipolaires
ne soit pas toujours possible
au début de la maladie

Forum Med Suisse 2012;12(20–21):402–405 404
Actuel
[21, 22]. De plus, certains auteurs ont suggéré que les
premières années d’évolution du trouble psychotique
constituaient une «phase critique» au cours de laquelle
se développent des décits (fonctionnels, cognitifs) aux-
quels il est ensuite difcile de remédier [23].
Diverses approches permettent de diminuer la DUP.
Premièrement, il est essentiel de développer des pro-
grammes de soin facilement accessible, dotés d’équipes
mobiles pouvant se déplacer au domicile des patients
ou chez les intervenants de premier recours (médecins
généralistes, urgences). Deuxièmement, ces programmes
doivent promouvoir une attitude pro-active (aller cher-
cher le patient s’il ne se présente pas au rendez-vous)
de manière à favoriser et soutenir l’engagement dans
les soins. Troisièmement, la continuité des soins est d’une
importance fondamentale, tant l’alliance thérapeutique
souvent fragile peut être menacée par des changements
de thérapeutes. On organise ainsi habituellement les
soins autour d’un soignant de référence (case manager)
qui constitue le l rouge de la prise en charge pendant
la durée du programme qui s’étend idéalement sur trois
voire cinq ans. Ce soignant établira une relation de
c onance avec le patient, et sera à même de l’aider à
intégrer et donner un sens à cet épisode dans sa trajec-
toire de vie. Enn, il est important de faire savoir au
grand public, par le biais de campagnes d’information,
que ce type de programmes existent, et que les troubles
psychotiques se soignent. Il est ainsi utile de rappeler
par exemple que les études d’évolution à long terme
montrent que 30% des patients atteints de schizophrénie
guérissent [24].
Diminuer la DUP n’est cependant pas sufsant; il faut
aussi proposer des soins spéciquement adaptés à cette
phase de la maladie [25], en appliquant ainsi le concept
de staging aux patho-
logies psychiatriques
[26]. Premièrement, les
cliniciens doivent adop-
ter une attitude mêlant
optimisme et réalisme,
de manière à favoriser
l’engagement des pa-
tients tout en les moti-
vant à se traiter. Deuxiè-
mement, la posologie de
la médication doit être
modiée par rapport aux traitements habituels, des étu-
des ayant montré que des doses faibles de neuroleptiques
sufsent pour traiter les symptômes positifs [27]. La
question de l’interruption du traitement doit être éva-
luée avec attention et doit se faire dans le cadre d’un
suivi rapproché [28]. Troisièmement, s’il est nécessaire
d’informer les patients sur les divers aspects des trou-
bles dont ils souffrent (psychoéducation) et sur les effets
potentiels de facteurs de risque tels par exemple que
l’abus de cannabis, il faut le faire de manière adaptée,
avec des outils accessibles [29]. Quatrièmement, le
c ontenu du traitement psychologique doit également être
en phase avec les besoins spéciques de ces jeunes pa-
tients qui souvent n’ont jamais eu affaire au monde mé-
dical et ne se sont jamais trouvés dans une position de
malade. Il s’agit donc de les aider à prendre conscience
du besoin d’aide tout en sauvegardant une estime de
soi fragilisée. Plusieurs modules de psychothérapie ont
été étudiés, la majorité d’inspiration cognitive et com-
portementale [30], et certaines études suggèrent une
réponse effectivement plus favorable à ce type de trai-
tement dans la phase précoce des troubles psycho-
tiques que chez les patients chroniques [31]. Enn,
l’enjeu principal est de favoriser la réintégration sociale
des patients quand celle-ci n’a pas pu être sauvegardée.
A cet égard, l’application précoce des stratégies de sou-
tien à l’emploi (immersion rapide dans le circuit écono-
mique normal plutôt que passage par des modules de
réhabilitation) semble prometteuse [32] .
Swiss Early Psychosis Project (SWEPP):
un réseau suisse
Le SWEPP a été fondé en 1999 et a pour but de proposer
un réseau d’échange d’informations et de connaissances
sur le diagnostic et le traitement des phases psycho-
tiques précoces. En plus
de sensibiliser les mé-
decins de famille [33],
psychologues et psychia-
tres, d’organiser des sé-
minaires réguliers de
training psychopatholo-
gique et de publier plu-
sieurs travaux [4, 5, 33,
34], le SWEPP a déjà or-
ganisé plusieurs confé-
rences internationales. Leurs thèmes ont été: De la re-
cherche à la pratique (2002), Schizophrénie et cannabis
(2004), Phases psychotiques précoces: un update sur le
diagnostic et le traitement (2005) et Les phases préco-
ces des psychoses schizophréniques et affectives: points
communs et différences (2007). Après 2 congrès natio-
naux en 2010 et 2011, le SWEPP organise le 21 juin 2012
à l’Université de Berne un nouveau symposium interna-
tional consacré explicitement à la question du diag-
nostic différentiel et du traitement des phases psycho-
tiques précoces. Le programme détaillé peut être
consulté sur le site du SWEPP (www.swepp.ch).
Correspondance:
PD Dr Andor E. Simon
Ärztlicher Leiter Spezialsprechstunde Bruderholz
für psychotische Frühphasen
Ambulatorium Bruderholz, Psychiatrie Baselland
CH4101 Bruderholz
andor.simon[at]pbl.ch
Les nombreuses révisions
des critères diagnostiques au
cours de ces dernières
décennies montrent qu’ils ne
permettent pas toujours de
donner une image correcte et
stable des pathologies
psychotiques telles qu’on les
observe dans la réalité
clinique
Il est nécessaire d’informer
les patients sur les divers
aspects de leur maladie
et les risques potentiels du
cannabis par exemple, tout
en leur rappelant aussi qu’il
est possible de se rétablir et
de retrouver un bon niveau
de fonctionnement

Forum Med Suisse 2012;12(20–21):402–405 405
Actuel
Références recommandées
– Simon AE, Schmeck K, Di Gallo A, Borgwardt S, Aston J, Roth B, et
al. Zur Bedeutung der frühen Erkennung und Behandlung von Psy-
chosen. Schweiz Med Forum. 2011;11(49):913–8.
– Riecher-Rössler A, Rechsteiner E, D’Souza M, von Castelmur E, Aston
J. Frühdiagnostik und Frühbehandlung schizophrener Psychosen –
ein Update. Schweiz Med Forum. 2006;6(25):603–9.
– Simon AE, Conus P, Schneider R, Theodoridou A, Umbricht D. Psy-
chotische Frühphasen: Wann intervenieren? Schweiz Med Forum.
2005;5(23):597–604.
– Conus P, Berger G, Theodoridou A, Schneider A, Umbricht D, Conus-
Michaelis K, et al. Frühintervention bei bipolaren Störungen. Schweiz
Med Forum. 2008;8(17):316–9.
– Simon AE, Lauber C, Ludewig K, Umbricht DS. Cannabis und Psy-
chose. Schweiz Med Forum. 2004;4(24):636–9.
La liste complète des références numérotées se trouve sous
www.medicalforum.ch.
1
/
4
100%