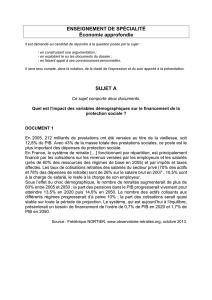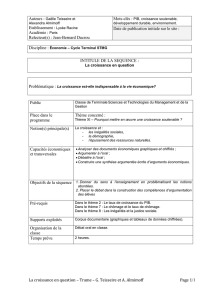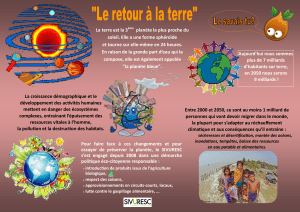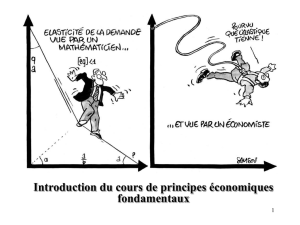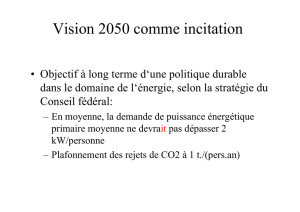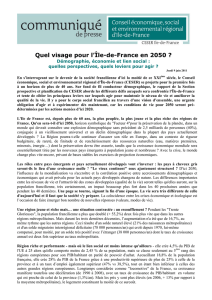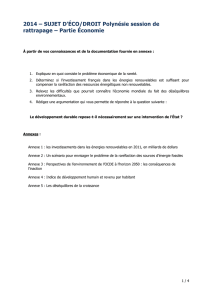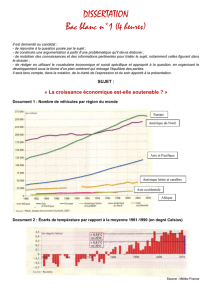Untitled - The University of Vermont


VIVEMENT 2050 !
PROGRAMME POUR UNE ÉCONOMIE
SOUTENABLE ET DÉSIRABLE

VIVEMENT 2050 !
PROGRAMME POUR UNE ÉCONOMIE
SOUTENABLE ET DÉSIRABLE
Robert Costanza
Gar Alperovitz
Herman E. Daly
Joshua Farley
Carol Franco
Tim Jackson
Ida Kubiszewski
Juliet Schor
Peter Victor
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Denot
Robert Costanza et Ida Kubiszewski : Crawford School of Public Policy,
Australian National University
Gar Alperovitz : The Democracy Collaborative and Department of Government
and Politics, University of Maryland
Herman E. Daly : School of Public Affairs, University of Maryland
Joshua Farley : Department of Community Development and Applied Economics,
and Gund Institute for Ecological Economics, University of Vermont
Carol Franco : Woods Hole Research Center
Tim Jackson : Sustainable Lifestyles Research Group, University of Surrey,
United Kingdom
Juliet Schor : Department of Sociology, Boston College
Peter Victor : Faculty of Environmental Studies, York University, Canada

Titre original :
Building a Sustainable and Desirable Economy-in-Society-in-Nature
© 2012 United Nations for the English edition / pour l’édition en anglais
© 2013 United Nations for the French edition / pour l’édition en français
All rights reserved worldwide / Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation
réservés pour tous pays.
Le présent ouvrage est une traduction non officielle pour laquelle l’éditeur se déclare
pleinement responsable.
L’ouvrage est publié pour et au nom des Nations unies.
© Les petits matins / Institut Veblen, 2013 pour la traduction
Les petits matins, 31, rue Faidherbe, 75011 Paris
www.lespetitsmatins.fr
Institut Veblen pour les réformes économiques, 38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris
www.veblen-institute.org
Traduction : Valérie Denot
Révision : Aurore Lalucq
Couverture : Thierry Oziel
Maquette : Atelier Dazibao
Graphiques : Arnaud Lebassard
ISBN : 978-2-36383-085-2
Diffusion Seuil
Distribution Volumen
Livre publié avec le concours de la Région Île-de-France
w
9
23
31
33
40
63
67
70
78
82
87
93
101
116
129
153
155
163
171
178
187
189
193
196
211
213
227
Introduction
Chapitre 1. Justification et objectifs
Contexte historique
La croissance de la consommation matérielle n’est pas
soutenable car il existe des limites planétaires
La croissance de la consommation matérielle au-delà
d’une certaine limite est indésirable…
Chapitre 2. Une économie soutenable et désirable, solidaire
et écologique en 2050
Notre vision du monde en 2050
Le capital bâti
Le capital humain
Le capital social
Le capital naturel
Chapitre 3. Concevoir une « économie » ancrée dans la société
et dans la nature
Le respect des limites écologiques
La protection des capacités d’épanouissement
La création d’une macro-économie soutenable
Chapitre 4. Quelques exemples de réformes politiques
Consommation : inverser la tendance
Étendre le secteur des biens communs
L’incidence des quotas systématiques sur les ressources
naturelles
Partager le temps de travail
Chapitre 5. Cohérence et faisabilité des politiques
Les enseignements de l’histoire
Les exemples à petite échelle
Les études de modélisation
Conclusion
Références bibliographiques
Remerciements

9
INTRODUCTION
Notre planète a subi des changements considérables.
Nos concepts et nos outils économiques ont été forgés
dans un contexte dit de « monde vide ». Relativement
vide d’hommes, vide d’objets, à une époque où le capi-
tal, les infrastructures, le matériel constituaient les
facteurs limitants, tandis que le capital naturel se trou-
vait en abondance. Mais nous avons quitté ce monde.
Nous habitons désormais un « monde plein », celui
dit de « l’anthropocène », dans lequel l’être humain
constitue une force géologique capable d’agir sur son
environnement, sur le système écologique de soutien
de la vie, à l’échelle planétaire [2]. Pour faire face à
cette situation sans précédent et jeter les bases d’une
prospérité durable, c’est-à-dire « améliorer le bien-
être humain et l’équité, tout en réduisant significati-
vement les risques écologiques et les pénuries » [3],
nous devons entièrement repenser notre économie et
reconsidérer ses relations avec le reste du monde, afin
de permettre l’émergence d’un modèle mieux adapté à
ces nouvelles conditions de vie sur Terre.
Pour y parvenir, nous aurons besoin d’une science
économique qui respecte les limites planétaires [4, 5]
et reconnaisse que le bien-être de l’homme dépend
essentiellement de la qualité de ses relations sociales
et du degré d’équité de la société dans laquelle il vit.
L’objectif de croissance de la consommation maté-
rielle devra ainsi céder la place à une volonté réelle
Nota bene : les numéros entre crochets correspondent
aux références bibliographiques situées en page 213.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
1
/
121
100%