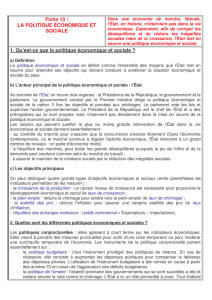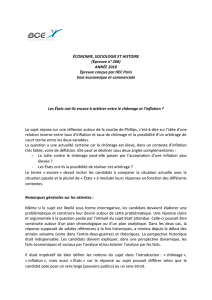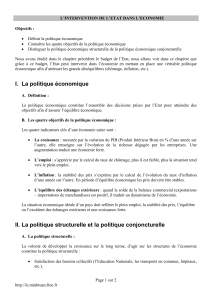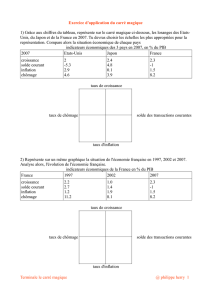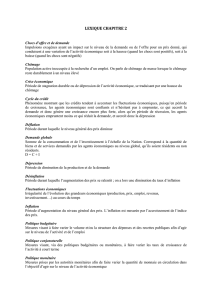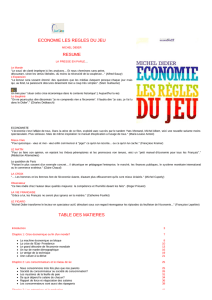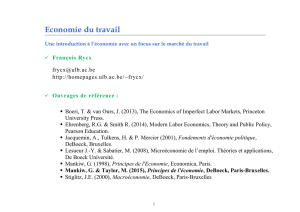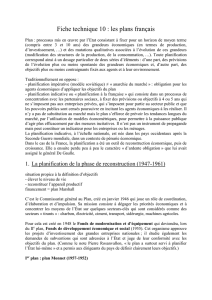En quoi la lutte contre les différents déséquilibres

En quoi la lutte contre les différents déséquilibres économiques peut être difficile pour les
pouvoirs publics ?
Document 1 : « Les politiques de relance »
En France, les politiques de relance de 1975 (stimulation de l'investissement des entreprises) et 1981 (stimulation de la
consommation par hausses du SMIC, des allocations familiales, du minimum vieillesse et des allocations de chômage) n'ont pas eu les
effets expansionnistes attendus, ce qui prouve empiriquement la faiblesse de l'effet multiplicateur. Quel lien y a-t-il entre la valeur du
multiplicateur et la propension à importer d'un pays ? L'effet multiplicateur repose sur un mécanisme de vagues successives de
dépenses et de productions induites. Or, en économie ouverte, les fuites dans le circuit économique sont nombreuses en raison de
l'existence des importations : lorsqu'un euro de revenu est consacré à l'achat d'un bien produit à l'étranger, ce revenu « sort » du
circuit économique national et ne stimule plus la production intérieure (l'effet multiplicateur est en quelque sorte « exporté »). C'est
bien ce qui se produit dans les pays développés où la part des importations de biens et services ne cesse de croître. Par exemple en
France, cette part qui était de 15,3% en 1970 représentait 23,3% en 2006. Ainsi, les relances de 1975 et 1981 ont débouché sur des
plans de rigueur induits par la dégradation du commerce extérieur.
J.-D. Lecaillon, J.-M. Le Page, C. Ottavj, Economie contemporaine, analyse et diagnostics, éd. De Boeck, 3e éd., 2008.
Remarque :
-Effet multiplicateur : effet plus que proportionnel d’une variation ponctuelle de la dépense (investissement, etc.) sur l’activité économique (PIB
fondamentalement).
-Propension à importer : part des importations dans le PIB
Document2 : Le « carré magique » de la France
Insee 2009
Document3 : « La relation inflation chômage »
La courbe de Philips met en évidence une relation inverse entre inflation et chômage. A l'origine, c'est le résultat d'une analyse
historique sur l'Angleterre entre 1867 et 1957 menée par Phillips (économiste néo-zélandais Alban W. Phillips) en 1958 qui montrait
une relation négative entre la hausse des salaires et le chômage. Elle est ensuite (Lipsey, 1960) devenue une relation entre inflation et
chômage avec le dilemme selon lequel les gouvernements devraient choisir un peu plus d'inflation pour faire baisser le chômage et,
inversement, accepter davantage de chômage afin de venir à bout de l'inflation.
L'histoire des années 1970-80 a montré qu'il s'agissait d'un « faux dilemme » et que l'on pouvait avoir à la fois de l'inflation et du
chômage. L'histoire de cette relation mouvementée est importante car elle témoigne à la fois des discussions entre experts et des
allers-retours entre les théories et les faits. La clé de l'interprétation est sans doute à chercher dans les comportements des agents
économiques, eux-mêmes déterminés par leur connaissance des mécanismes économiques, à une époque et en un lieu donnés.
Matthieu Mucherie http://www.melchior.fr/
Remarque: Melchior est un site de diffusion des sciences économiques et sociales

En quoi la lutte contre les différents déséquilibres économiques peut être difficile pour les pouvoirs publics ?
Introduction :
Annonce :
Selon Milton Friedman (1912-2006), l’augmentation de la masse monétaire effectuée lors des politiques
monétaire expansionniste est la cause unique de la hausse des prix : « L’inflation est toujours et partout un
phénomène monétaire en ce sens qu’elle est et qu’elle ne peut être générée que par une augmentation de la
quantité de monnaie plus rapide que celle de la production » (1970). Le Fondateur de l’ « École de Chicago »
s’opposé à l’interventionnisme étatique et aux politiques économiques keynésiennes. Pour lui, l’intervention
des pouvoirs publics pour lutter contre le chômage sont nocives et source d’inflation qui nuit à l’activité
économique.
Milton Friedman, malgré ses positions controversées met le doigt sur une les difficultés pour les pouvoirs
publics d’intervenir via des politiques économiques sur certains déséquilibres économiques. La politique
économique est :
Des déséquilibres économiques
Certains évoquent au sujet de ces déséquilibres, des incompatibilités.
Les
Ainsi, il apparait que l’action des pouvoirs publics via les politiques économiques est complexe, dominé par un
certains nombres de dilemmes. Mais, tous les objectifs ne sont pas la priorité des pouvoirs publics.
P.q. :
Il revient démontrer que la poursuite des différents déséquilibres économiques peut être difficile car ceux-ci
sont parfois incompatibles. En effet, les mécanismes de la politique économique sont tels qu’agir contre un
déséquilibre à une incidence sur un ou plusieurs autres. Comment ? Pourquoi ? Répondre à ces questions nous
permettra de comprendre les enjeux soulevés par ce sujet au combien d’actualité.
Plan :
Il me reviendra d’expliquer dans un premier temps que la lutte contre le chômage peut être responsable de
l’augmentation du taux d’inflation. Cependant, il faut avoir à l’esprit que cela n’est pas automatique. Dans un
second temps, conviendra de mettre en évidence que la croissance économique peut être responsable d’un
accroissement du déficit extérieur. Toutefois, les pouvoirs publics ne souffrent pas toujours de voir le déficit
extérieur s’accroitre : il existe un « bon déficit ».

I- Les objectifs de lutte contre le chômage et de stabilité des prix sont parfois difficiles à concilier
A- La lutte contre le chômage peut être responsable du développement de l’inflation
Document du cours 3
1-la relation de Philips
2-Mais, attention cette relation est soumise à conditions
-nécessite des mouvements sociaux qui augmentent les salaires.
-nécessite une augmentation des prix et non une diminution des taux de marges
-nécessite une stabilité du niveau de production
B- La lutte contre l’inflation peut être source d’une dégradation des autres objectifs
1- En quoi consiste la lutte contre l’inflation
Lutte contre inflation pol monétaire restrictive augmentation des txi baisse du crédit baisse de
l’investissement baisse de la production
2- chômage et de réduction de la demande globale
-baisse de l’investissement baisse de la production
-Loi d’OKUN « relation entre le taux de croissance et l’emploi » : il faut un certain niveau de croissance pour maintenir
les emplois et absorber les nouveaux entrants dans la pop active.
II- L’objectif de croissance économique peut être parfois source d’un déficit extérieur inquiétant.
A- L ‘augmentation de la croissance économique peut avoir comme corollaire un développement du
déficit commercial
Document du cours 1
1-La croissance intérieure peut se traduire par un développement des importations
2-La contrainte de l’ouverture des économies
a-ce développement des importations peut se faire au détriment des entreprises résidentes.
b-Par ailleurs, l’ouverture réduire l’efficacité du plan de relance à l’origine de la croissance.
B- Mais, cela n’est pas toujours dommageable pour l’économie nationale.
-Document du cours

Conclusion :
Ainsi, il apparait que l’action des pouvoirs publics via les politiques économiques est complexe, dominé par un
certains nombres de dilemmes. Mais, tous les objectifs ne sont pas la priorité des pouvoirs publics. En effet, les
objectifs sont hiérarchisés selon les projets des meneurs de la politique. Cela donne sans doute son sens au mot
« politique ».
Grille :
Etape
attente
barème
introduction
Une politique économique (Selon E. Malinvaud) : « ensembles des interventions en vues de corriger
(résorber ou mieux résoudre) des déséquilibres économiques, jugés dommageable » (dimension très
politique de la direction prise par la politique économique).
L’inflation : hausse durable et cumulative du niveau général des prix sur une période donnée.
Le chômage (versus plein emploi) : état d’un individu ou d’une population privé involontairement
d’un emploi.
Les déséquilibres extérieurs (versus équilibre extérieurs ou commercial) :
Equilibre extérieur : Situation dans laquelle une nation pratique l'échange international sans
s'endetter ou accroître son endettement extérieur
Balance Paiement= Bal commerciale+ Bal des Capitaux
Le déficit commercial est la situation dans laquelle : X ‹ M
La demande globale (point de vue de la macroéconomie keynésienne) : la demande globale est la
dépense anticipée ou ex-ante au niveau de la nation (Demande effective keynésienne). Elle est la
somme pour l'ensemble des agents économiques dépense prévues en consommation, investissement et
la valeur prévue des exportations.
Croissance économique :
5 POINTS
développement
I-Les objectifs de lutte contre le chômage et de stabilité des prix sont parfois difficiles à concilier
A-La lutte contre le chômage peut être responsable du développement de l’inflation
1-la relation de Philips
2-Mais, attention cette relation est soumise à conditions
B-La lutte contre l’inflation peut être source d’une dégradation des autres objectifs
1-En quoi consiste la lutte contre l’inflation
2-chômage et de réduction de la demande globale
-Loi d’OKUN « relation entre le taux de croissance et l’emploi » : il faut un certain niveau de croissance
pour maintenir les emplois et absorber les nouveaux entrants dans la pop active.
II-L’objectif de croissance économique peut être parfois source d’un déficit extérieur inquiétant.
A-L ‘augmentation de la croissance économique peut avoir comme corollaire un développement
du déficit commercial
1-La croissance intérieure peut se traduire par un développement des importations
2-La contrainte de l’ouverture des économies
a-ce développement des importations peut se faire au détriment des entreprises résidentes.
b-Par ailleurs, l’ouverture réduire l’efficacité du plan de relance à l’origine de la croissance.
B-Mais, cela n’est pas toujours dommageable pour l’économie nationale.
9 POINTS
Mobilisation
des documents
3 POINTS
conclusion
1.5 POINTS
Orthographe,
syntaxe
1.5 POINTS
1
/
4
100%