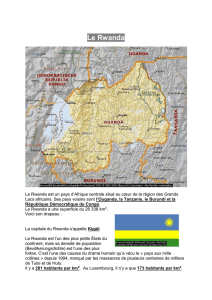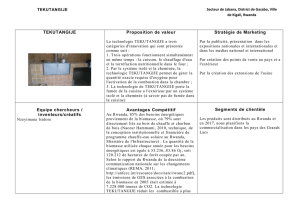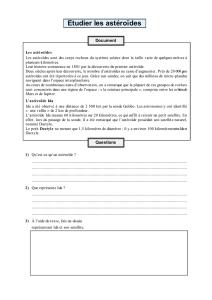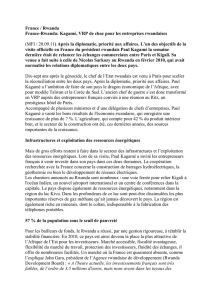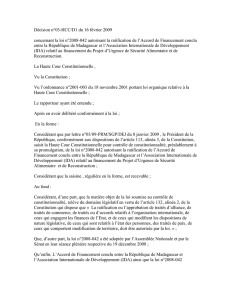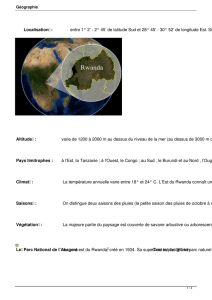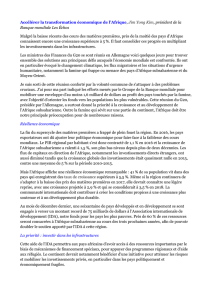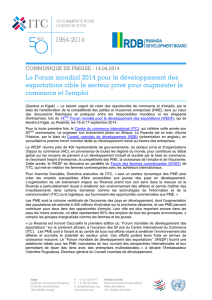Rwanda : de la reconstruction d`après conflit au

Le Rwanda a réalisé des progrès impressionnants depuis le génocide
de 1994 qui a coûté la vie à près d’un million de personnes. Le
pays a entrepris de remettre en état son infrastructure dévastée, de
rétablir les normes sociales et, enn, de mettre en œuvre une stratégie
ambitieuse de développement à long terme visant à transformer le pays
d’une économie à faible revenu basée sur l’agriculture à une économie
du savoir tournée vers les services d’ici 2010.
Indicateurs économiques 1990 1994 2008
PIB par habitant (USD) 251 152 465
Croissance du PIB (%)* –2 –50 11,2
Ination (IPC, %)* 4 1,6 (1996–98) 15
Dette extérieure totale (% du PIB) 28 127 15
Décit budgétaire (% du PIB, prêts inclus) –5 –11 0,1
Flux nets d’investissements étrangers directs
(millions USD) 8,0 0 3,6 (2004)
Incidence de la pauvreté (% de la population
vivant avec moins de 1 dollar par jour) 40 78 56,5 (2005)
Taux net de scolarisation en primaire (%) 67 S/O 95
Mortalité infantile pour les moins de cinq ans
(pour 1 000 enfants naissant vivants) 150 209 (1995) 103
Taux d’immunisation (rougeole, %) 83 25 98
Prévalence du VIH/SIDA (%) – 13 (1997) 3
Population (millions d’habitants) 7,1 5,5 9,6
Source : FMI et Banque mondiale, sauf indication contraire.
* Institut national de la statistique du Rwanda (NISR).
Le pays est de plus en plus considéré comme un modèle en matière de développement parce qu’il met
l’accent sur les résultats et qu’il tire parti des expériences des autres pays dans le monde. Le succès des
efforts de réforme s’est traduit par une croissance à deux chiffres au cours de la phase de reconstruction.
La croissance a ralenti légèrement au début de la décennie alors que le pays est entré dans sa phase
de développement, mais a ensuite atteint 11 % en 2008 grâce à une solide performance agricole.
L’IDA continue à soutenir les efforts du Rwanda en mettant l’accent sur la création d’un environnement
favorable à la croissance et à la création d’emplois.
L’IDA EN ACTION
Rwanda : de la reconstruction d’après conit au développement

2
RÉALISATIONS AU NIVEAU
NATIONAL
Le Rwanda a opéré une transition
remarquable entre la reconstruction
d’après conit et le développement
au cours des 14 dernières années.
Le génocide de 1994 a détruit la base économique
fragile du pays ainsi qu’une grande partie de son
capital humain et a anéanti sa capacité à attirer
l’investissement privé. Près d’un million de
personnes sont mortes et des milliers de Rwandais
ont fui le pays à pied. La pauvreté s’est accrue
de façon dramatique, surtout parmi les femmes,
touchant 78 % de la population en 1994.
Pendant la reconstruction, le gouvernement
rwandais a concentré ses efforts sur la restauration
des institutions, ce qui s’est traduit par une
amélioration sensible des résultats économiques
et des indicateurs sociaux. Grâce aux réformes
économiques et aux réformes de gouvernance de
grande portée entreprises entre 1995 et 2008, le
PIB a enregistré une croissance annuelle moyenne
de plus de 8,6 %. En 2005, la proportion de pauvres
était tombée à 57 % de la population. La mortalité
infantile, qui avait atteint plus de 300 décès pour
1 000 naissances vivantes après le génocide, est
retombée à 103 pour 1 000 en 2008.
Des progrès substantiels ont été accomplis pour
stabiliser et redresser l’économie. En 1998, le
PIB était revenu à son niveau d’avant 1994, stimulé
initialement par les efforts de reconstruction
après le conit. Pendant cette phase de boom,
la croissance du PIB a été en moyenne de 10,5 %
par année entre 1996 et 2002. Lorsque l’économie
est entrée dans sa phase de développement,
la croissance annuelle s’est établie à 6,1 % en
moyenne entre 2003 et 2008. L’ination est
demeurée relativement faible, entre 6 % et 7 %
par an, par rapport à la décennie précédente.
La gestion macroéconomique a été satisfaisante,
comme en témoignent les bons résultats des
cinq examens effectués dans le cadre de la
Facilité pour la réduction de la pauvreté et
pour la croissance (FRPC) du FMI. Un sixième
accord de trois ans au titre de la FRPC a été
approuvé en 2006 et devrait être achevé en
août 2009. La mise en œuvre efcace des
politiques macroéconomiques a permis au
Rwanda de parvenir au point d’achèvement
pour les pays pauvres très endettés et de
bénécier de l’Initiative d’allégement de la dette
multilatérale (MDRI).
Depuis les premiers jours de la reconstruction en 1994, l’Association internationale de développement
(IDA), le guichet de la Banque mondiale qui aide les pays les plus pauvres de la planète, a fourni au
Rwanda 1 054 millions de dollars par le biais d’opérations d’investissement et d’appui aux politiques.
L’IDA a rapidement adapté ses activités en fonction des circonstances, répondant d’abord aux besoins
de reconstruction et apportant ensuite un soutien aux réformes structurelles pour le développement.
Les importantes réformes économiques et politiques réalisées entre 1995 et 2008 ont contribué à
une croissance moyenne du produit intérieur brut (PIB) rwandais de plus de 8,6 % par an. Les progrès
constatés en termes de bien-être de la population et de prestations de services sont encore plus
remarquables. Les taux de scolarisation et de réussite dans l’enseignement primaire sont en augmentation.
Les taux de vaccination, qui se situent à 98 %, sont parmi les plus élevés d’Afrique subsaharienne et l’on
estime que la prévalence du VIH, à 3 %, est faible pour l’Afrique subsaharienne. Au cours des quatre
dernières années, le pourcentage de la population ayant accès à l’eau a presque doublé, passant de
44 % en 2003 à 71 % en 2007.
Peu après le génocide, alors que le Rwanda se battait pour reconstruire son avenir, la Banque mondiale
a été parmi les premiers donateurs à lui apporter un soutien, en lui fournissant des analyses ciblées et
des conseils de politique générale et en facilitant l’harmonisation et l’alignement entre les donateurs.
n n n

3
Premièrement, le pays est stable et en paix.
Même si les séquelles du génocide persistent,
le pays a fait des progrès considérables sur la
voie de la réinstallation de la population, de la
réconciliation nationale, de la démobilisation
et de la réintégration des ex-combattants.
Environ 15 000 membres de l’ancienne armée
gouvernementale ont été intégrés dans l’armée
nationale rwandaise à différents niveaux de
commandement, et près de 3,5 millions de
réfugiés rwandais ont été rapatriés et réinstallés
dans ce petit pays densément peuplé.
Les indicateurs de la gouvernance se sont
améliorés, et s’inscrivent dans le cadre d’une
amélioration globale de l’Évaluation de la
politique et des institutions nationales (EPIN)
du Rwanda. Sur les 45 pays d’Afrique subsaha-
rienne qui ont été notés (dont le Rwanda),
72 % se situaient en dessous du Rwanda, 18 %
au-dessus et 10 % ont reçu une note égale à celle
du Rwanda. Entre 1998 et 2008, le Rwanda a
aussi été reconnu, même au-delà de l’Afrique,
pour son leadership dans la lutte contre la
corruption. Il se classe actuellement au-dessus
de 60 % des pays à l’échelle mondiale en matière
de lutte contre la corruption. Le Rwanda a aussi
amélioré ses résultats au regard de quatre sur
six indicateurs suivis par la Banque mondiale,
notamment la stabilité politique, l’efcacité des
pouvoirs publics, la qualité de la réglementation
et le respect du droit. Le pays n’a cependant pas
réalisé de progrès signicatifs dans le domaine du
dialogue et de la responsabilisation. Les donateurs
bilatéraux travaillent actuellement avec le
gouvernement pour ouvrir le dialogue politique.
De plus, le Rwanda poursuit un programme de
décentralisation ambitieux pour donner plus
d’autonomie aux communautés locales et pour
accroître la transparence et la responsabilité.
Le Rwanda a fait des progrès considérables en
vue de l’atteinte des objectifs de développement
pour le Millénaire (ODM).
Le pays a obtenu des
résultats spectaculaires dans les secteurs sociaux :
le taux de scolarisation en primaire a atteint
95 % en 2008, contre 67 % en 1990, et le taux
d’achèvement de la scolarité est passé à 55 % en
2005. Le taux de vaccination, de 98 %, est parmi
l’un des plus élevés d’Afrique subsaharienne. La
population utilisant des moustiquaires impré-
gnées d’insecticide est passée de 4 % à 65 % entre
2004 et 2008. La prévalence du VIH, qui est de
3 %, est en diminution.
Cas unique en Afrique, le Rwanda a élargi
l’accès à l’assurance-maladie (au moyen de
dispositifs locaux appelés mutuelles de santé).
La population couverte est ainsi passée de 7 %
à 70 % entre 2003 et 2007, ce qui se traduit
par l’utilisation accrue des services de santé,
comme en témoigne, par exemple, le nombre
d’accouchements assistés. Au cours des quatre
dernières années, le pourcentage de la population
ayant accès à l’eau a presque doublé, passant
de 44 % en 2003 à 71 % en 2007.
CONTRIBUTIONS DE L’IDA
Depuis 1994, l’IDA a accordé au Rwanda des
crédits et des dons d’un montant de 1 054 millions
de dollars. Environ la moitié de ce soutien
nancier a été fournie dans le cadre d’opérations
de redressement économique et d’appui aux
politiques, dernièrement sous la forme de trois
crédits/dons à l’appui de la réduction de la
pauvreté. Depuis 2004, ces crédits/dons ont
soutenu directement les vigoureux efforts de
réforme entrepris par le gouvernement, en
particulier dans le domaine du développement
du secteur privé et de la fourniture de services
sociaux et d’infrastructures ainsi que dans celui
de la gestion et de la responsabilisation du
secteur public. De plus, l’IDA a nancé environ
19 opérations d’investissement et a établi plus
de 27 rapports analytiques et examens.
Répondre aux besoins du pays.
Le soutien de l’IDA s’est adapté à l’évolution de
la situation au Rwanda. Après le génocide, l’IDA
a concentré ses efforts sur la reconstruction,
notamment la reconstruction de la base
économique et institutionnelle, et la réponse
aux besoins fondamentaux dans les domaines
de l’éducation, de la santé, de l’eau, de l’énergie,
des transports et des communications. De plus,
elle a soutenu le gouvernement dans ses efforts

4
pour reconstituer le tissu social et promouvoir la
réconciliation.
Le soutien de l’IDA est ensuite passé de l’aide
d’urgence au nancement d’activités de
développement à plus long terme. L’IDA vise
désormais à soutenir le statut du Rwanda en tant
que modèle pour le développement, avec de
nouveaux prêts novateurs visant à accélérer la
croissance et à réduire la pauvreté.
Compte tenu des bons résultats du gouverne-
ment, le soutien de projets a été associé à un
appui des politiques, fondé sur un dialogue et une
analyse constructifs. Étant donné la volonté de
réforme du gouvernement, l’IDA a pu travailler
avec ses homologues dans le pays pour offrir
une assistance nancière et technique et des
services d’analyse qui ont directement contribué
à l’obtention de résultats tangibles sur le plan
du développement.
Mener un dialogue de politique
générale constructif.
À mesure que le pays est sorti de la phase
de reconstruction, l’IDA a apporté un soutien
croissant au programme de réforme politique
du gouvernement au moyen de crédits/dons à
l’appui de la réduction de la pauvreté destinés
au secteur social et au secteur de l’infrastruc-
ture ainsi qu’au secteur public et à la gestion
macroéconomique. Ces crédits/dons ont permis
de procéder à un dialogue complet et de haut
niveau sur la stratégie du programme de réforme
du Rwanda. Ce dialogue a été facilité par le travail
d’analyse de l’IDA, mais, surtout, la qualité du
dialogue de politique générale témoigne de la
ferme volonté de réforme du gouvernement.
Élaborer un programme
de développement conduit par le pays.
L’IDA a aidé le gouvernement à élaborer son
premier Document de stratégie pour la réduction
de la pauvreté (DSRP), qui a été achevé en
2002. D’après une évaluation indépendante,
les objectifs du DSRP ont généralement été
atteints, voire dépassés. Cette évaluation indique
aussi les domaines à améliorer. L’IDA a aidé le
gouvernement à préparer sa deuxième stratégie
de développement économique et de réduction
de la pauvreté, achevée en 2007.
Faciliter l’harmonisation entre
les donateurs et l’alignement de l’aide.
La coordination entre les donateurs a été essen-
tielle pour assurer le succès des efforts des
donateurs au cours de la période d’après conit.
Alors que le ministère du Développe ment inter-
national (DFID) du Royaume-Uni s’est concentré
sur le développement humain, en particulier
l’éducation, l’IDA a fourni des compétences et un
soutien nancier pour la gestion du secteur public
et les questions duciaires et de gestion. La
coordination a été favorisée par la préparation du
premier crédit de l’IDA à l’appui de la réduction
de la pauvreté, dans le cadre du document de
stratégie du gouvernement.
L’IDA, en collaboration avec le DFID et les autres
donateurs, a également fourni l’aide qui a permis
au gouvernement d’élaborer un cadre commun
d’évaluation des performances en 2008. Ce
cadre comprend un ensemble d’indicateurs et
d’actions politiques choisis dans la stratégie de
développement économique et de réduction de
la pauvreté (la deuxième du pays) ainsi qu’une
évaluation conjointe de la gouvernance par les
donateurs et le gouvernement. Ce cadre constitue
le fondement du soutien budgétaire octroyé au
pays et de l’évaluation conjointe des donateurs
de la performance du Rwanda en ce qui a trait à
la mise en œuvre de sa stratégie de développe-
ment économique et de réduction de la pauvreté.
L’IDA a également nancé le développement
d’approches sectorielles (SWAP) dans les domaines
de l’énergie, de l’agriculture et de la santé.

5
L’impact de l’IDA, par le biais
de nancement et de conseils
de politiques, se manifeste
dans de nombreux secteurs.
Dialogue de politique générale. Le dialogue de
politique générale entre l’IDA et le gouvernement
rwandais a d’abord porté sur la sécurité de
base, la réconciliation, la stabilisation macro-
économique, la privatisation et la fourniture de
services sociaux de base. Les réformes se sont
poursuivies avec l’amélioration de la gestion
des nances publiques, la mise en place d’un
cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) pour
renforcer la planication et la budgétisation,
et la création d’un climat d’investissement
propice aux affaires. Récemment, l’accent a été
mis sur des activités qui font la promotion de
la transformation économique et permettent
d’éliminer les obstacles à la croissance ainsi
que sur des activités axées sur la réduction de
la vulnérabilité sociale. L’IDA cherche enn à
obtenir une solide collaboration avec le
gouvernement, des résultats et réalisations
tangibles en matière de développement et une
harmonisation entre les donateurs.
Agriculture. Le secteur agricole est essentiel
à l’économie du Rwanda. Il représente 39 %
de son PIB, 80 % de ses emplois et 63 % de ses
revenus en devises étrangères. L’agriculture
contribue de manière considérable à la
croissance économique. La solide croissance du
secteur agricole a été le principal moteur de la
croissance économique, de l’ordre de 15 %, qui a
été enregistrée en 2008. L’aide de l’IDA dans le
secteur agricole est donc axée sur l’augmentation
de la croissance et la réduction de la pauvreté
au moyen de la création d’emplois.
L’IDA est le principal donateur dans le secteur
agricole. Elle fournit de l’aide technique et
contribue à l’harmonisation des donateurs de
concert avec le DFID, le Fonds international de
développement agricole (FIDA) et la Belgique.
L’IDA a soutenu le développement d’une
approche sectorielle visant à appliquer la
stratégie agricole du Rwanda et appuiera le futur
Projet d’aménagement du sol, de récupération
de l’eau et d’irrigation des versants.
Le programme d’appui au secteur rural de 2006
à 2008 a permis de doubler les rendements des
récoltes de riz sur les terrains marécageux ciblés
par le projet. L’aide future de l’IDA sera axée sur le
renforcement des versants, notamment au moyen
de la production horticole, et sera versée à un
programme du gouvernement dans ce domaine.
Développement du secteur privé. Le soutien de
l’IDA a aidé à formuler et adopter une stratégie de
développement du secteur privé puis une stratégie
de promotion des exportations, et a permis de créer
l’agence rwandaise en charge de la promotion des
investissements et des exportations (RIEPA). Un
guichet unique pour faciliter le développement
des entreprises a été créé au sein de l’agence, et
la première phase d’une zone franche industrielle
a été mise en œuvre.
De l’engrais pour la croissance
La réponse apportée par l’IDA à la crise des
denrées alimentaires de 2008, qui a été nancée
par un don spécial d’urgence octroyé dans le cadre
d’un don de l’IDA déjà en cours pour soutenir la
réduction de la pauvreté, ciblait la productivité des
récoltes alimentaires grâce à l’accès à de l’engrais.
De cette aide est né le premier système de mise
aux enchères et de coupons pour les engrais, ce
qui a encouragé la distribution d’engrais par le
secteur privé. Le programme a eu pour résultat de :
i) remplacer entièrement la distribution d’engrais
par le secteur public par la distribution d’engrais
par le secteur privé, en améliorant ainsi l’accès,
en particulier pour les récoltes alimentaires ; et
ii) d’octroyer des coupons pour 26 % des engrais
mis aux enchères à des producteurs de récoltes
alimentaires qui, pour la plupart, obtenaient ainsi
accès à de l’engrais pour la première fois. La
production alimentaire a augmenté de manière
considérable en 2008, contribuant tant à la
croissance qu’à la quantité de denrées alimentaires
disponible par habitant.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%