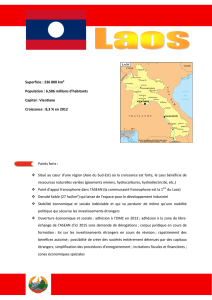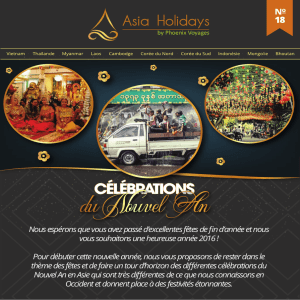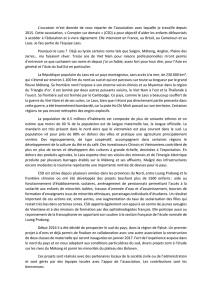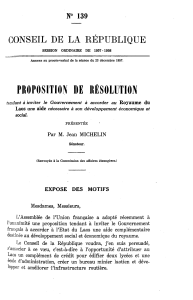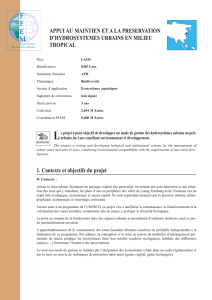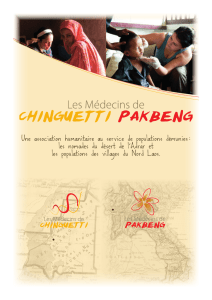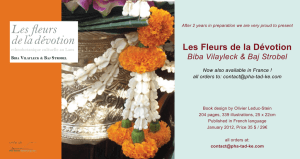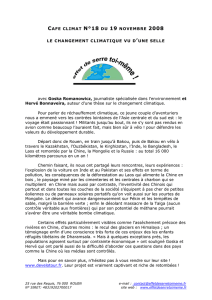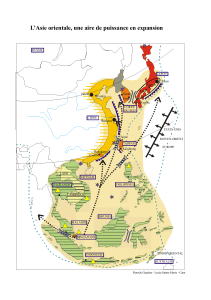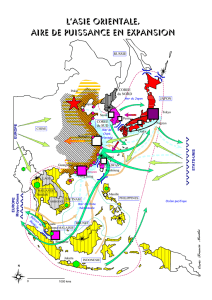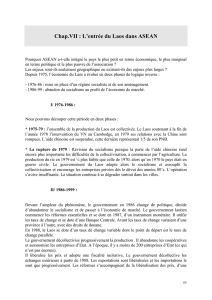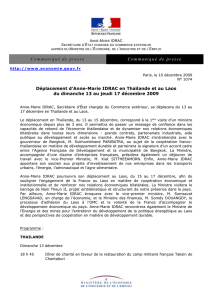Quelques pays resurgissent de l`ombre au hasard de l`actualité

TOPIC
Juillet 2003
A l’ombre du Laos et de la Birmanie…
Deux dictatures
oubliées
Le Laos…
Enclavé au cœur
de la péninsule
indochinoise…
… refermé sur
lui-même mais
soutenu par le
Vietnam…
… tiraillé par une
résistance en
déshérence
Quelques pays resurgissent de l’ombre au hasard de
l’actualité. C’est le cas pour le Laos et le Myanmar depuis deux
mois. Très mal connus – à part pour les voyageurs qui apprécient les
circuits touristiques qui sortent de l’ordinaire –, ils sont pourtant sur
le devant de la scène depuis mai dernier.
L’Asie du Sud-Est, on a tendance à l’oublier, doit elle aussi
compter avec la dictature et le retard économique. Loin du « tigre
thaïlandais », les communistes laotiens et la junte militaire birmane
tiennent chacun d’une main de fer des pays au bord du gouffre.
Pays montagneux et recouvert à 95% par la forêt tropicale,
le Laos ne dispose que de 5% de terres pour nourrir ses 5.4 millions
d’habitants. 80% de la population active travaille dans le secteur
agricole qui représente encore 50% du PIB. L’agriculture de
subsistance est très largement majoritaire puisque 72% des surfaces
agricoles ont une superficie inférieure à deux hectares. A moyen
terme, la pression sur les terres arables devrait s’accroître du fait de
la croissance démographique qui a atteint en 2002 les 2.5% contre
1.42% pour le Thaïlande et 1.01% pour le Vietnam.
Le Laos est aussi un pays complètement enclavé et dépend
de ses voisins pour ses exportations et importations. Il est donc très
exposé aux chocs externes. La crise de 1997-1998 l’a frappé de plein
fouet du fait de ses liens avec la Thaïlande, principal investisseur du
pays. Mais, sa faible intégration dans les échanges internationaux lui
a permis de profiter, l’an passé, du dynamisme thaïlandais et lui a
évité d’être affecté par le ralentissement de l’économie mondiale.
Le régime communiste en place entretient des relations
politiques privilégiées avec son voisin vietnamien. Rappelons
qu’après de longues années de guerre civile, la guérilla communiste,
devenue le LPRP (Lao People’s Revolutionary Party), a pris le
pouvoir en 1975. La coopération militaire avec le Vietnam – jusqu’à
50 000 soldats vietnamiens ont stationné au Laos – a contribué à
réduire fortement la portée de la résistance anti-gouvernementale. La
Chine, qui avait un temps soutenu les rebelles a mis fin à son aide
après le réchauffement de ses relations avec les autorités laotiennes.
Que reste-t-il de ces mouvements d’opposition ? 2 000
personnes tout au plus, principalement issues de l’ethnie Hmong
soutenue dans les années 70 par la CIA mais qui, aujourd’hui, vit
isolée dans le Nord du pays. Pourtant, depuis le début de l’année, la
résistance Hmong semble se raviver. Plusieurs attentats ont eu lieu

Arrestation
mouvementée et
l’emprisonnement
de journalistes
Occidentaux…
… mais un pays
sous perfusion
internationale
L’économie
birmane officielle
au bord de la
faillite...
… malgré un fort
potentiel et la
vitalité du secteur
informel
Mme Suu Kyi :
l’épine dans le
sur la route qui relie la capitale Vientiane, à Luang Prabang, faisant
25 morts au total.
C’est dans ce contexte que les deux journalistes européens
et leur traducteur américain ont été arrêtés le 4 juin dernier, au cours
d’un affrontement entre les soldats laotiens et les rebelles Hmong.
D’abord accusés du meurtre d’un des militaires, ils ont ensuite été
condamnés le 30 juin, au cours d’un procès expéditif, à 15 ans de
prison pour « obstruction à l’activité des forces de sécurité et
détention illégale d’explosifs ».
C’était sans compter avec les Etats-Unis qui, certes, n’ont
pas dénoncé officiellement l’attitude des autorités laotiennes mais
qui disposaient d’un moyen de pression conséquent. Un accord
commercial bilatéral doit être en effet prochainement signé entre les
deux pays. En aucun cas, Colin Powell et le représentant au
commerce Robert Zoellick, appuyés par le Congrès, ne veulent
remettre en question la signature de cet accord. L’ambassadeur
américain, sur place, soutient aussi pleinement le projet, convaincu
des retombées positives sur le pays. L’Europe, de son côté, a brandi
la menace d’une baisse de l’aide financière. Or le Laos vit sous
perfusion. Ce sont l’Union Européenne (UE), le Japon et le FMI,
dont l’aide représentait, en 2001 14% du PIB, qui le maintiennent en
vie depuis de nombreuses années. Et ceci d’autant plus que les
recettes issues du tourisme devraient fortement régresser en 2003. Le
SRAS et, maintenant, l’arrestation abusive des ces trois Occidentaux
dans le climat actuel d’insécurité rendent en effet le Laos beaucoup
moins attractif – après une forte croissance du nombre de voyageurs
ces cinq dernières années.
De l’autre côté de la péninsule indochinoise, le Myanmar. A
nouveau, un pays montagneux mais qui, lui, a la chance de posséder
pas moins de 2832 km de côtes maritimes.
Cette ouverture physique sur la mer ne l’a pourtant pas
empêché de vivre quasiment en autarcie depuis plus de trente ans.
L’Europe et les Etats-Unis lui ont d’ailleurs retiré la plupart des
privilèges qu’ils octroient d’habitude aux pays en développement.
Les sanctions telles que l’embargo sur les armes ou le gel des avoirs
principaux viennent d’être renforcés par l’Union Européenne.
L’économie officielle traverse, elle, une crise profonde. Le
secteur bancaire est proche de la faillite. L’inflation à deux chiffres
continue d’augmenter – mais plus modérément depuis février –
tandis que le kyat poursuit sa chute inexorable face au dollar.
Pourtant, l’importance de ses réserves naturelles, son
potentiel agricole et le tourisme pourraient favoriser son décollage.
Mais le commerce de la drogue apparaît beaucoup plus profitable
aux yeux de la junte militaire qui entretient activement l’économie
informelle.
Rien ne semble pouvoir ébranler la dictature birmane, pas
même la chef de file de l’opposition birmane et prix Nobel de la Paix

pied de la junte
militaire…
Un pays de plus
en plus
stratégique pour
les pays
limitrophes
Aung San SUU KYI. Bien au contraire, sa récente libération après
sept années en résidence surveillée – à la suite du lancement de sa
campagne en faveur de la démocratie en 1988, date du coup d’Etat
militaire –, n’aura été que de courte durée. Depuis le 30 mai, elle est
maintenue au secret en prison malgré les vives protestions venues de
l’Occident.
En Asie, l’annonce de son arrestation ne semble pas avoir
autant de répercussions. Et pour cause. Ni l’ASEAN (Association of
Southeast Asian Nations), ni l’Inde, ni la Chine ne veulent se mettre
le Myanmar à dos. Car, il est devenu un pays stratégique dont on
cherche à s’attirer les faveurs. Son entrée au sein de l’ASEAN en
1997 est très largement liée à la volonté des pays d’Asie du Sud-Est
de l’éloigner du giron chinois. Quant à l’Inde, elle n’a de cesse de
renforcer ses liens avec un pays dont elle redoute les relations de
nature toute militaire qu’il entretient avec la Chine. Le conflit sino-
indien de 1962-1963 est encore gravé dans les mémoires… L’Inde
est prête à beaucoup de concessions pour éloigner la Birmanie de la
sphère d’influence chinoise.
Mais la Chine possède une longueur d’avance sur l’ASEAN
comme sur l’Inde. Elle est le premier investisseur de l’économie
birmane. Et cette manne financière n’est pas sans arrière-pensée. Sa
participation dans l’amélioration des infrastructures portuaires le
long du Golfe du Bengale, en particulier, face à l’Inde, pourrait un
jour servir à accueillir des navires militaires chinois. Depuis la
normalisation de ses relations avec le Myanmar en 1988, les
échanges commerciaux entre les deux pays n’ont cessé d’augmenter
pour atteindre 650 millions de dollars en 2002. Un très grand nombre
de Chinois venus du Yunnan se sont installés dans le nord.
Désormais, la majorité des entreprises prospères sont chinoises. Les
Etats-Unis voient d’un mauvais œil cette interaction grandissante. Et,
pourtant, ils font partie – avec Singapour et la Malaisie – des
principaux investisseurs étrangers – malgré les sanctions imposées
par le Congrès sur ce pays.
Les priorités des Occidentaux concernant le Laos et le
Mynamar sont aux antipodes des préoccupations des pays asiatiques
qui les entourent. Ces derniers préfèrent jouer la carte de
l’intégration au nom de leurs propres intérêts. Les alliances en cours
sont peu connues des Européens en particulier. Et pourtant, il semble
qu’un nouveau paysage stratégique se dessine entre une Thaïlande
qui se tourne de plus en plus vers la région du Grand Mékong donc
vers le Laos, une Chine qui aimerait bien voir sa sphère d’influence
progresser plus au sud-ouest, une Inde qui veut à tout prix contenir
cet appétit chinois et enfin l’ASEAN toujours à la recherche de
l’unité régionale.
L.B
www.hec.fr/eurasia

Laos
Population : 5.5 millions
Croissance démographique (2001 - 2002) : 2.5%
Economie :
z PIB/hab : 327 USD
z Croissance du PIB réel (2002e) : 5.8%
z Inflation (2002e) : 10.6%
N
ature du régime : Parti Unique (LPDR)
Khamtai Siphandon
Président du Laos depuis
1998
Myanmar
Aung San Suu Kyi
Population : 51 millions
Croissance démographique (2001 - 2002) : 0.6%
Economie :
z PIB/hab : 140 USD (2000)
z Croissance du PIB réel (2002e) : 4.2%
z Inflation (2002e) : 15%
N
ature du régime : dictature militaire
1
/
4
100%