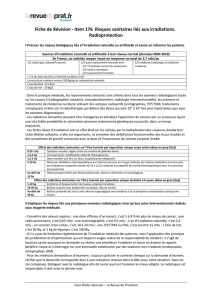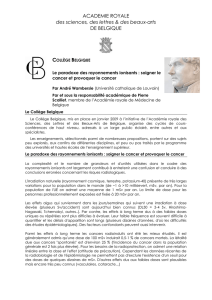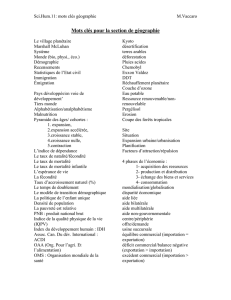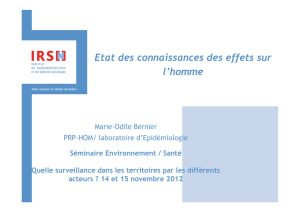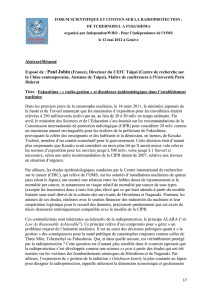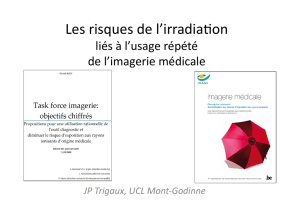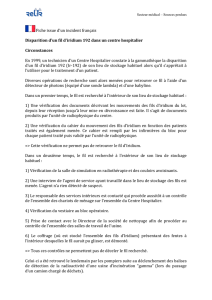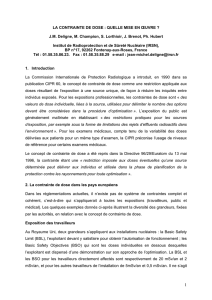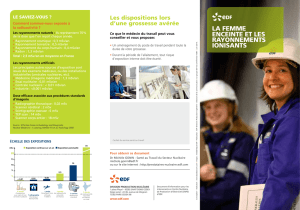TEXTE 2 Génétique, technologie et société : l`héritage de Chernobyl

TEXTE 2 Génétique, technologie et société : l’héritage de Chernobyl
Le 26 avril 1986, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire électrique de Chernoby
explosait en éjectant une quantité massive de composés radioactifs autour d’elle et
dans tout l’hémisphère nord. L’explosion tua 31 sauveteurs et en irradia profondément
200 autres. Dans les 9 jours qui suivirent l’explosion, la température du réacteur
approcha le point de fusion et des produits de fission radioactive comme l’iode, le
xénon, le strontium et le césium, furent relachés dans l’atmosphère. Les retombées
radioactives diffusèrent dans toute l’Europe centrale, atteignant la Finlande et la Suède
trois jours après l’explosion initiale, le Royaume Uni et les Etats-Unis une semaine
après. Des millons de personnes furent exposées à des quantités mesurables de
radioactivité. Les personnes vivant dans un rayon de 30 km autour de Chernobyl
furent exposées à des niveaux de radioactivité très importants avant d’être évacués 36
heures après l’accident. De même, les quelques 600 000 militaires et civils envoyés à
Chernobyl pour décontaminer la zone et enfermer le réacteur dans un sarcophage
furent aussi fortement exposés.
L’accident de Chernobyl fut la plus grande émission accidentelle de radioacivité jamais
survenue dans le monde. La question encore en suspens est de savoir si cette
pollution menace la santé à long terme de millions de personnes.
On en sait plus sur les conséquences des radiations sur la santé humaine que sur les
conséquences de n’importe quel autre toxique (sauf peut-être la fumée de cigarette).
Les rayons X et les rayons gamma sont un sous-groupe de radiations ionisantes qui
possèdent suffisamment d’énergie pour éjecter des électrons des atomes. Les
radiations ionisantes peuvent endommager n’importe quel constituant cellulaire, altérer
les nucléotides et induire des cassures double brin sur l’ADN. Ces lésions de l’ADN
peuvent induire des mutations ou des translocations chromosomiques.
Les fortes doses de radiations ionisantes augmentent le risque de développer certains
cancers. On a observé chez les survivants des bombes atomiques d’Hiroshima et
Nagasaki une augmentation de l’incidence des leucémies dans les deux ans qui
suivirent ces bombardements. Les cancers du sein ont été multipliés par dix, ainsi que
les cancers du poumon, de la thyroïde, du colon, de l’ovaire, de l’estomac et du
système nerveux. Puisque les radiations ionisantes induisent des lésions de l’ADN, on
pensait voir chez les descendants des survivants une augmentation du nombre de
malformations ou maladies congénitales, ce qui jusqu’à maintenant n’est pas le cas.
Extrapoler de Hiroshima à Chernobyl est un problème de dose. Chez les survivants de
la bombe atomique, le taux de cancers a augmenté chez les personnes exposées à
plus de 200 mSv (mSv = millisievert, unité de dose absorbée de radiation). On estime
que les personnes qui vivaient dans la région la plus contaminée de Chernobyl ont subi
une exposition d’environ 50 mSv, et certains des travailleurs chargés du nettoyage du
site furent exposés à des doses de l’ordre de 250 mSv. En dehors de la région de
Chernobyl, les doses de radiations ont été de 0,4 à 0,9 mSv en Allemagne et en
Finlande, 0,01 mSv au Royaume Uni et de 0,0006 mSv aux Etats-Unis.
A titre de comparaison, la dose moyenne de radiation absorbée lors d’un diagnostic
médical (par exemple une radiographie dentaire ou du poumon) est de l’ordre de 0,39
mSv par an. L’exposition d’une personne à la radioactivité naturelle (rayons
cosmiques, roches radioctives ou gaz radon) est de l’ordre de 2 à 3 mSv par an. Les
fumeurs s’exposent eux-mêmes à une dose d’environ 2,8 mSv par an à cause des
produits naturels mais radioactifs incorporés dans le tabac.
Il semble que le taux de mutations parmi les plantes et les animaux exposés aux
déchets radioactifs de Chernobyl est de deux à dix fois le taux normal. On sait aussi
que le taux de mutation du gène HPRT chez les nettoyeurs de Chernobyl est de 25%
supérieur au taux normal. De même, le taux de mutation dans les séquences
microsatellites chez les enfants nés dans la zone polluée est deux fois celui d’enfants

témoins du Royaume Uni. Mais ces augmentations des taux de mutations ont-elles un
effet sur la santé ?
On estime que parmi les 115 000 personnes évacuées de la région de Chernobyl, il y a
eu 26 cas supplémentaires de leucémies dus à la catastrophe, en plus des 25 à 30 cas
spontanés. On estime également qu’il y aura 17 000 cas supplémentaires de cancer en
Europe, en plus des 123 millions qui surviendront normalement. Mais jusqu’à présent,
aucune augmentation du nombre de leucémies ou de tumeurs solides n’a été détectée
dans l’ex-URSS, la Finlande ou la Suède, ou chez les 600 000 personnes qui ont
participé au nettoyage du site.
Mais bien que le taux de tumeurs solides et de leucémies n’ait pas augmenté, un type
de cancer semble clairement en augmentation, c’est le cancer de la thyroïde. La
fréquence de ce cancer chez les enfants a atteint 100 cas par million d’enfants et par
an, alors que le taux normal attendu est de 0,5 à 3 par million d’enfants et par an. Bien
que les épidémiologistes débatent pour savoir si cette augmentation est entièrement
due aux effets de Chernobyl ou si elle est due en partie à une meilleure détection de ce
type de cancer, l’importance de l’augmentation et le fait qu’un des radioisotopes
relâché par la centrale soit l’iode est très en faveur d’un lien direct entre cette
augmentation de cancers de la thyroïde et la catastrophe de Chernobyl.
Les conséquences les plus importantes et les plus immédiates de Chernobyl sont sans
doute psychologiques. On a observé chez les netoyeurs du site une augentation de
50% du taux de suicide ainsi qu’une augmentation de l’alcoolisme et du tabagisme.
D’autres études montrent que 45% des personnes vivant dans un rayon de 300 km
autour de Chernobyl croient être atteinte d’une maladie radio-induite. Des maladies
telles que la dépression, les troubles du sommeil, l’hypertension et l’altération de la
perception sont aussi documentées. En fait, le stress post-traumatique peut être une
menace plus importante que l’irradiation elle-même. Les gens ont le sentiment de vivre
sous la menace constante du cancer, attendant le résultat d’une sorte de lotterie.
Finalement, même si les maladies génétiques et les cancers n’augmentent pas de
façon spectaculaire, les effets de la catastrophe de Chernobyl sur la santé ont été et
seront encore dévastateurs.
1
/
2
100%

![(NUCLEAIRE SANTE2 [Lecture seule] [Mode de compatibilité])](http://s1.studylibfr.com/store/data/004419939_1-c17aa940c4162ca554765fbd9a370e7e-300x300.png)