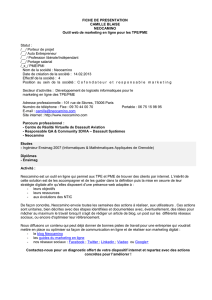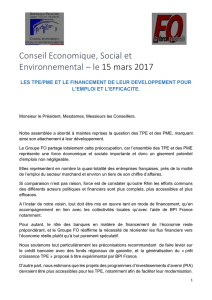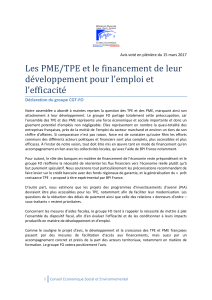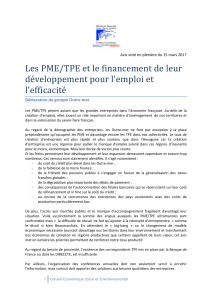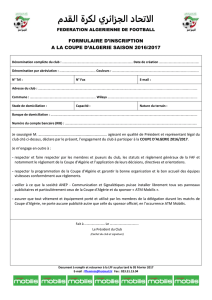ROLE DE L`ETAT VIS-A-VIS DES TPE/PME DANS UN PAYS

Rôle de l’État vis-à-vis des TPE/PME dans un pays nouvellement
adhérent à l’économie de marché : cas de l’Algérie
Mohamed BOUKHARI
Maître de conférences
Université SAAD DAHLAB de Blida
RÉSUMÉ
Cet article s'intéresse à la promotion de la petite et la moyenne entreprise en Algérie. Pour ce
faire, il se donne pour objectif d'éclairer les institutions publiques sur la nécessité d'une
nouvelle stratégie afin de stimuler l'entrepreneuriat et de diminuer la vulnérabilité des
PME/TPE face à la mondialisation. Aujourd'hui, le rôle des petites et moyennes entreprises
dans la croissance et le développement économique d'un pays est unanimement reconnu.
Toutefois dans les pays du sud nouvellement adhérent à l'économie de marché, à l'instar de
l'Algérie, le tissu des TPE/PME reste peu développé et extrêmement vulnérable aux aléas du
marché. La première cause à évoquer réside dans cette récente transition vers l'économie de
marché mais est-ce la seule raison? Quelle est la politique de l'État algérien pour remédier à
cette situation? Quel en est le constat? Existent-ils d'autres moyens susceptibles d'améliorer la
situation? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.
MOTS CLÉS
PME – Transition - Économie de marché – Entrepreneuriat

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées
scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada
Rôle de l’État vis-à-vis des TPE/PME dans un pays nouvellement adhérent à l’économie de marché :
cas de l’Algérie 2
INTRODUCTION
Après l’indépendance, en 1962, l’Algérie choisit le système socialiste comme modèle
économique caractérisé par un mécanisme de gestion et de coordination de type planifié, et la
propriété publique sur l’outil de production et de distribution. La stratégie de développement
adoptée durant cette période se fonde sur une politique volontariste d’industrialisation, la
politique des industries industrialisantes, financée par la nationalisation de la principale
richesse minière nationale, les hydrocarbures, et l’endettement extérieur. La stratégie des
industries industrialisantes en Algérie vise à faire ériger des industries intégrées en vue d’un
approvisionnement en produits de base et semi-finis à travers des échanges interindustriels
nationaux. A cet effet, de puissantes sociétés publiques sont érigées ayant le monopole dans
les grandes branches industrielles. Cependant le bilan est médiocre, et déjà au début des
années 1980 une nouvelle politique est amorcée celle de la restructuration. Cette nouvelle
politique vise la restructuration organique et financière des entreprises publiques associée à la
gestion autonome. Mais au bout du compte, les résultats restent toujours en deçà des
espérances, les objectifs ne sont pas atteints et l’endettement de ces entreprises devient
alarmant. L’État, lui-même, est endetté, le passif est garni de dettes à court terme. L’économie
nationale est paralysée, les émeutes d’octobre 1988 feront le reste. Le modèle socialiste en
Algérie a vécu.
Une nouvelle phase débute pour l’économie algérienne, celle de la transition vers l’économie
de marché. Contrairement au modèle socialiste, l’État se lance dans la libéralisation des
marchés, l’encouragement de l’initiative privée, l’impulsion de la concurrence et la
privatisation. Cette fois, la stratégie de développement est basée sur la promotion de
l’entrepreneuriat privé par la multiplication des PME/TPE. L’État régule et promeut mais ne
gère plus. La politique économique s’est enrichie en cette dernière décennie, depuis l’élection
du Président Bouteflika en 1999, par une politique de relance de la demande de type
keynésienne. Le plan quinquennal de consolidation de la croissance 2004-2009 est de 150
milliards de dollars américains (le PIB en 2007 est évalué à 135,28 Md. US$).
Néanmoins, à l’heure actuelle, il est difficile d’affirmer que les objectifs retenus par le
gouvernement sont atteints. En examinant les chiffres concernant les créations de nouvelles
entreprises, on se rend compte que le tissu de PME/TPE est peu développé. Selon les chiffres
du Ministère des PME et de l’artisanat algérien, le nombre de PME en 2007 était de 410 959
entreprises pour une population de 33,8 millions d’habitants, soit 1,21 PME pour 100
habitants. Ce ratio est très faible en comparaison avec les pays développés. Calculé pour le
Canada et la France ce ratio représente respectivement 4,28 et 4,19. Cela veut dire qu’il faut
multiplier par 3,5 le nombre de PME en Algérie (une augmentation de 350%!) pour arriver à
une densité similaire à celle des pays développés. Ce simple constat dégage une
problématique évidente : pourquoi le tissu des PME/TPE algérien est-il si peu développé?
Pour répondre à cette question il nous parait judicieux de faire appel à une méthodologie
rigoureuse afin de cerner l’activité entrepreneuriale en Algérie. Pour Alain Fayolle (Fayolle,
2005) les recherches en entrepreneuriat opposent les approches fonctionnelles, sur les
individus et sur les processus (What, Who/Why, How). Thierry Verstraete (Verstraete, 2003)
propose une approche théorique globale sur trois niveaux: un niveau cognitif, un niveau
structural et un niveau praxéologique. Ces approches sont très intéressantes, surtout celle de
Verstraete qui caractérise le phénomène entrepreneurial par rapport aux connaissances de
l’entrepreneur et ses actions, mais aussi par rapport au contexte d’émergence de ce
phénomène. Cette dernière évidence nous paraît primordiale puisque tout phénomène

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées
scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada
Rôle de l’État vis-à-vis des TPE/PME dans un pays nouvellement adhérent à l’économie de marché :
cas de l’Algérie 3
entrepreneurial ne peut se développer dans un contexte défavorable. Toutefois, Thierry
Verstraete (Verstraete, 2003), dans son ouvrage, fait référence au contexte social, qu’il
qualifie d’architecture sociale, sans faire référence au cadre économique en supposant, et c’est
le cas pour la plupart des pays, que l’entrepreneuriat évolue dans un environnement
d’économie de marché. Néanmoins ce n’est pas le cas de l’Algérie, qui vit une transition
économique, cela veut dire qu’elle est en phase de construction de l’économie de marché, qui
est le fondement ou le « terreau » indispensable à l’émergence d’un tissu entrepreneurial. En
effet, il est difficile d’imaginer que l’entrepreneuriat privé puisse se développer dans une
économie planifiée, monopolisée par des entreprises publiques. Cette spécificité de
l’économie algérienne nous pousse vers une approche particulière, celle d’analyser l’impact
de l’environnement de transition et des politiques publiques sur le développement du tissu des
PME/TPE en Algérie. L’étude de l’impact de l’environnement de transition suppose de
répondre à la question suivante : l’Algérie a-t-elle fini sa transition vers l’économie de
marché? S’en approche-t-elle?
De l’autre coté, l’économie de marché n’est pas un mécanisme parfait, pour cela il suffit de
constater la succession des crises économiques après chaque période libérale. C’est pour cela
que l’intervention de l’État est indispensable afin de pallier à l’incapacité de l’économie de
marché à s’autoréguler. Cela veut dire aussi que les politiques publiques de soutien à
l’entrepreneuriat vont de pair avec l’économie de marché et, que l’étude de l’impact de
l’environnement de transition sur le développement du tissu des PME/TPE en Algérie doit
s’accompagner de l’analyse de l’impact des politiques publiques sur le développement de ce
même tissu. Pour ce faire, nous avons choisi de l’aborder sous trois angles essentiels, à
savoir : la formation, le soutien à l’investissement et l’innovation.
Pour les fins de l’étude, la méthodologie descriptive et analytique a été adoptée. Cette
approche nous a permis de décrire le contexte entrepreneurial économique actuel en Algérie
ainsi que les politiques publiques de soutien à l’entrepreneuriat. Elle nous a permis aussi
d’analyser les performances de l’État dans ce domaine à partir des indicateurs économiques
disponibles. Dans cette recherche, qui se situe dans le prolongement des études faites sur les
retombées de l’entrepreneuriat sur le développement économique, nous avons organisé la
communication en trois parties. La première partie se consacre à l’analyse de l’environnement
de transition. La deuxième partie analyse la politique publique de promotion de
l’entrepreneuriat. La dernière partie est consacrée aux ajustements susceptibles d’améliorer le
tissu des PME/TPE en Algérie.
1. L’ENVIRONNEMENT DE TRANSITION
Aujourd’hui, la principale caractéristique de l’économie algérienne est la transition vers
l’économie de marché. Cette transition suppose le passage vers un nouveau mode de gestion
et de coordination de l’activité économique qu’on peut caractériser par trois principes
fondamentaux que nous empruntons à Campbell R. McConnell (Campbell et Stanley, 1988) :
la formation des prix par les marchés, la liberté d’entreprendre et la concurrence.
Afin de concrétiser son souhait d’instaurer l’économie de marché, l’Algérie doit
impérativement enraciner ces trois principes qui s’avèrent indépendants mais qui restent
néanmoins complémentaires. Sinon quelle est l’utilité d’une liberté entrepreneuriale dans des
conditions de concurrence déloyale, et quel peut-être l’arbitrage par les prix si absence de
concurrence et d’entrepreneuriat il y a? Procédons par ordre.

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées
scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada
Rôle de l’État vis-à-vis des TPE/PME dans un pays nouvellement adhérent à l’économie de marché :
cas de l’Algérie 4
1.1. Formation des prix par les marchés
Les marchés sont un lieu d’échange où l’arbitrage entre la demande et l’offre se fait par les
prix. On dénombre essentiellement quatre marchés : le marché du travail, le marché des biens
et services, le marché monétaire, et celui des capitaux. Dans une économie de marché, il est
supposé que les marchés sont libres dans une logique de « laisser-faire » alors que l’État est
dévolu à un rôle de régulateur compensateur des possibles dérives. Le marché des biens et
services est libre en Algérie et s’est développé après la libéralisation du commerce extérieure
qui a été consacrée par l’ordonnance n°03-04 du 19 juillet 2003. Les statistiques des
importations plaident en cette faveur puisque leur volume augmente annuellement. Selon
l'Agence algérienne de promotion du commerce extérieur (ALGEX), le volume des
importations entre 2003 et 2007 est passé de 13533 à 27441 millions de dollars américains
dont 73% sont détenus par le privé, soit une évolution de 102,7%.
Cependant le marché des biens et services n’est pas exempt de distorsions liées aux
subventions étatiques sur les produits de large consommation, à l’instar du pain, du lait ou de
la pomme de terre, mais aussi sur la tarification de l’énergie et de l’eau. La subvention du
pain et du lait est une mesure purement sociale. La fixation des tarifs de l’énergie et de l’eau
sont des mesures initiées afin d’encourager l’investissement. Pour Abdelhamid Temmar,
Ministre de l’Industrie et de la promotion des investissements algérien, la vente du gaz, pour
son utilisation à des fins industrielles, à 10% de sa valeur internationale est un gage de
promotion des investissements étrangers. Cependant la subvention de la pomme de terre est
due à une forte spéculation sur ce produit initiée, selon l’Union des paysans libres (Upal), par
des barrons et de puissants lobbies au sein même de l’État. La bureaucratie et la mauvaise
coordination entre les différentes entités publiques reste néanmoins la piste privilégié. A ce
sujet, l’affaire des fameuses dattes algériennes « DEGLET NOUR » en témoigne. Afin
d’encourager l’exportation de la datte algérienne, les Douanes algériennes ont limité au
minimum les procédures de déclaration à l’export. Au même moment, le Ministère du
Commerce a exigé un contrôle sanitaire strict de ces mêmes dattes qui, de toute façon, sera
réalisé par les services phytosanitaires aux frontières du pays d’accueil. Résultat, les
exportateurs, dégoûtés par les procédures de contrôle sanitaire, se sont retournés au circuit
informel, et la fameuse datte algérienne est exportée par des opérateurs de pays limitrophes
sous leurs labels nationaux!
Le marché du travail en Algérie est quasiment inexistant du fait de sa désorganisation. Ainsi,
l’arbitrage sur le marché du travail en Algérie se fait uniquement par l’offre puisque les
salariés n’ont aucun moyen de modifier le niveau de l’emploi. Deux raisons peuvent expliquer
cette situation : a) L’État principal pourvoyeur d’emploi; b) l’informel. En Algérie l’État reste
le principal pourvoyeur d’emploi, et les statistiques le démontrent si bien. Déjà 2001, avant le
lancement du fameux programme d’emploi-jeune, la Fonction publique, à elle seule, compte
25% de l’emploi structuré. Mais le cœur du problème réside dans le fait que les modèles de
recrutement étatiques, soit au niveau de l’administration soit au niveau des entreprises
publiques, sont très bureaucratisés et sujets au clientélisme. A côté de ce secteur public
bureaucratisé mais sécurisé, coexiste un secteur privé partagé entre le formel et l’informel.
Selon les statistiques de l’OIT, en 2000 le secteur privé offre 28,2% d’emplois salariés mais
aussi 30% d’emplois totalement « au noir ». Cette désorganisation du marché du travail a
conduit à un taux de chômage élevé, même s’il est passé, officiellement, de 30% en 1998 à
12,3% en 2007. En réalité le taux de chômage annoncé par l’Office nationale des statistiques
(ONS) est largement contesté, surtout par les organismes internationaux à l’instar du FMI.
Dans son rapport N° 07/61 de février 2007, le FMI précise que le taux de chômage annoncé

« La vulnérabilité des TPE et des PME dans un environnement mondialisé », 11es Journées
scientifiques du Réseau Entrepreneuriat, 27, 28 et 29 mai 2009, INRPME, Trois-Rivières, Canada
Rôle de l’État vis-à-vis des TPE/PME dans un pays nouvellement adhérent à l’économie de marché :
cas de l’Algérie 5
par l’ONS de 15,3 % en 2005 correspond à un taux saisonnier puisque l’enquête a été réalisée
peu de temps avant le Ramadhan, une période d’activité commerciale intense. Sans cela, le
taux de chômage aurait atteint les 21%. Nous partageons entièrement cette analyse et nous
considérons que le taux de chômage de 12% correspond en réalité au chômage structurel, car
une part importante des emplois crées au travers du plan de relance de 150 milliards de dollars
américains correspond à des emplois temporaires de type emploi-jeune ou pour les besoins de
réalisation de chantiers comme c’est le cas dans le grand projet de l’autoroute Est-Ouest. Le
niveau élevé du chômage structurel en Algérie s’explique par le faible niveau de formation et
de qualification des demandeurs d’emploi qui, de ce fait, se trouvent en déphasage flagrant
avec la structure de l’offre d’emploi.
Afin de réguler le marché du travail, et d’éliminer la dualité entre le secteur protégé et le
secteur précaire, l’État a opté pour la création de l’Agence publique nationale de l’emploi
(ANEM) en 2004. Ses objectifs : faciliter la recherche d'emploi ou de formation, le conseil et
l’aide à l’employeur pour l’embauche et le reclassement des salariés. Même si les chiffres de
l’ANEM paraissent éloquents, nous citons à titre d’exemple la création de 186000 postes
d’emploi en 2008, ils ne concernent en fait que des postes créés dans le cadre du Dispositif
d’insertion professionnelle (DAIP). Ces postes sont en fait des emplois temporaires pour aider
les jeunes diplômés à acquérir une première expérience de travail limitée à trois années. Dans
ce dispositif, l’État prend en charge un salaire moyen équivalent à 83% du salaire minimum
garanti, soit 10000 dinars algérien (136 US$), et exonère de quelques impôts l’employeur
avec des abattements de l’impôt sur les revenus (IRG) et dans la Sécurité sociale.
L’inefficience de l’ANEM a conduit le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Tayeb
Louh, à reconnaître publiquement, le 16 mai 2008, l'existence de problèmes au sein de
l'ANEM concernant le suivi et l'accompagnement des jeunes chômeurs et s’est engagé à
moderniser cette agence pour lui donner plus de rapidité, avant la fin de l'année 2008.
Le marché monétaire est assez développé en Algérie au vu de la couverture nationale totale.
Les principales banques sont publiques dont les plus importantes sont la CPA (crédit
populaire d’Algérie) et la BNA (banque nationale d’Algérie). Ces dernières années des
établissements bancaires et des établissements financiers étrangers ont fait évoluer l’offre et la
qualité des services offerts à l’exemple de la BNP/PARIBAS ELDJAZAIR ou de la
SOCIETE GENERALE ALGERIE. Malgré l’évolution qualitative, l’accès au crédit reste un
vrai parcours de combattant pour les entreprises algériennes. Les banques étrangères se sont
focalisées sur les grands comptes, les opérations du commerce extérieur et le juteux créneau
du crédit à la consommation évitant ainsi le risque entreprise. Quant aux banques publiques,
elles, souffrent d’une gestion héritée de l’époque socialiste, même si elles restent les premiers
pourvoyeurs financiers des entreprises. En effets les règles d’octroi de crédit sont opaques et
n’obéissent pas à la logique commerciale. Pour preuve, sur les 2500 milliards de dinars (34,5
Md. US$) de crédits alloués aux entreprises, la moitié a été destinée au secteur public soit
autant qu’au secteur privé. Le secteur des PME/TPE, lui, n’a été financé qu’à hauteur de 450
milliards dinars (6,2 Md. USD), soit seulement 18% de l’ensemble des crédits alloués aux
entreprises. Lors du Colloque maghrébin sur le financement de la PME organisé par
l’Association des banques et des établissements financiers (Abef) et l’Union des banques
maghrébines à Alger le 11 mars 2009, le Ministre des finances algérien, Karim Djoudi, a
signalé que les PME/PMI n’ont pas la cote en Algérie. Les principaux reproches faits par les
chefs d’entreprises au système bancaire, lors de ce colloque, mettent en exergue les
dysfonctionnements, les lourdeurs et les excès des banques et leur impact dépressif sur
l’activité réelle : garanties excessives, délais de traitement des dossiers de crédit trop longs,
taux d’intérêt trop élevés, l’accueil de la clientèle est insuffisant, les relations avec l’étranger
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%