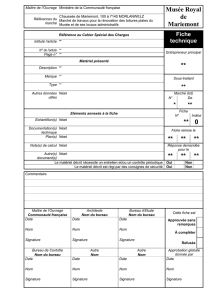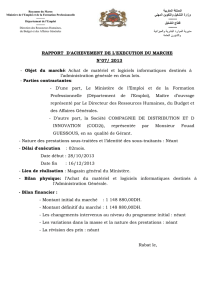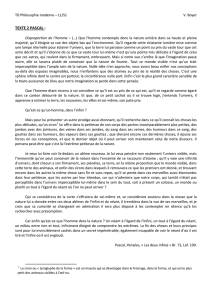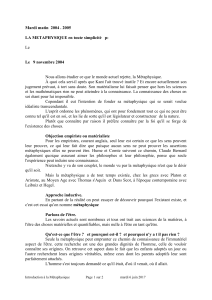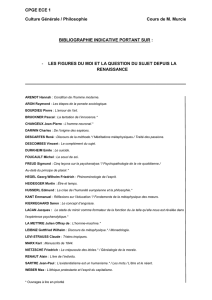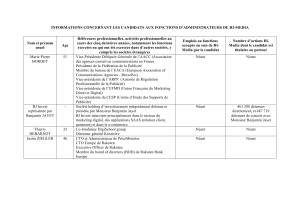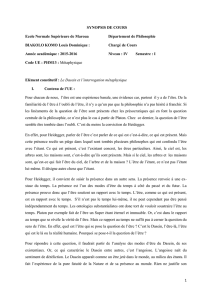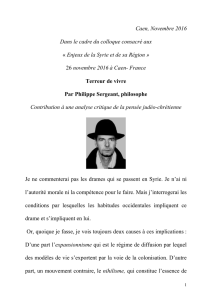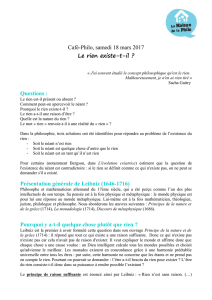Le Monde selon Etienne Klein

Le Monde selon Etienne Klein
par Etienne Klein
le jeudi de 7h17 à 7h24
7 minutes
POURQUOI Y A-T-IL QUELQUE CHOSE
PLUTOT QUE RIEN ?
20.06.2013 - 07:17
La fin de l’année scolaire approchant, nous sommes tous un peu fatigués et c’est
pourquoi j’ai décidé de ne plus traiter dans mes prochaines chroniques que de questions
faciles, voire triviales…
Par exemple, aujourd’hui, de celle-ci :
D’où vient l’univers ?
Et surtout, d’où vient qu’il y a un univers ?
Prendre cette question de l’origine au sérieux, c’est-à-dire saisir le mot « origine » dans
son sens le plus radical, ne consiste pas seulement à tenter de décrire les phases les plus
anciennes de notre univers, ce que les physiciens font d’ailleurs de mieux en mieux :
c’est d’abord s’interroger sur le passage de l’absence de toute chose – le néant – à la
présence d’au moins une chose (ou d’au moins un être) ; c’est donc affronter le mystère
du néant et de ses métamorphoses possibles : comment le néant a-t-il pu cesser d’être le
néant ? Ça part fort, alors je récapitule : penser le commencement de l’univers revient
rigoureusement à penser son absence et à penser comment son absence a pu se
transmuter en présence. Comment le rien qui n’était rien s’est-il débrouillé pour faire
tout un monde ?
La question ainsi posée, on devine mieux la difficulté de la tâche et je me dis déjà que
j’aurais dû choisir un autre sujet. La difficulté tient en grande partie au fait que l’idée de
néant, d’absence de toute chose, de rien absolu, a un statut bizarre. C’est en effet une
idée destructrice d’elle-même, au sens où dès que le concept de néant nous vient à

l’esprit, le mouvement de notre pensée le transforme en autre chose que lui-même : on
en fait quelque chose de particulier, une sorte de vide auquel on attribue
subrepticement un corps que le néant ne saurait posséder sans entrer en contradiction
avec sa définition. C’est ainsi qu’au lieu de lui ôter jusqu’au moindre semblant d’être,
l’activisme intellectuel le projette dans l’ontologie et ainsi le trahit : l’absence devient
présence de quelque chose, le non-être s’habille d’être et c’est la pagaille garantie dans
les concepts.
Tel est le paradoxe du néant : penser le rien n’est jamais penser à rien ; en affirmant
l’existence du rien, on le substantifie et, ce faisant, on le perd.
Les récits cosmogoniques qui décrivent la naissance de l’univers ne s’y sont d’ailleurs
pas trompés : ils ne décrivent jamais le monde originel comme une émanation du néant
pur. Au commencement, il y a toujours, disent-ils, quelque chose, un lieu sombre, sans
lumière. En somme, d’après eux, à l’origine de l’univers, il y a toujours un vide noir qui
grésille, d’ailleurs, c’est l’anagramme... Or un vide noir qui grésille, je ne sais pas si c’est
mieux que rien, mais ce qui est sûr, c’est que ce n’est pas rien et que c’est donc déjà ça.
C’est Leibniz qui, un jour de l’An 1740, posa la question fondamentale : « pourquoi y a-t-
il quelque chose plutôt que rien ? ». Pourquoi y a-t-il donc un monde, un monde
authentique, avec à l’intérieur des choses, des êtres vivants, de l’espace, du temps, des
sentiments ? D’où vient qu’à l’origine ce n’est pas plutôt le néant qui s’est imposé, alors
que, comme le précisait Leibniz lui-même, le néant est certainement « plus simple et
plus facile que n’importe quelle chose »[1] ? En effet, s’il n’existait pas, le monde serait
certainement un peu moins compliqué… Mais alors, d’où vient que c’est le difficile et le
non-simple qui ont gagné la partie ? C’est Cioran je crois, qui disait : « Tout est superflu,
le vide aurait suffi ». Mais on peut aussi penser que la réalité vient au contraire combler
la béance du vide, qu’elle vient remplir l’excès de vide qu’il y a dans le vide, si l’on peut
dire… Et puis bien sûr, on pourrait, à la question « pourquoi y a-t-il quelque chose ? »,
répondre : « Parce que Dieu l’a créé à partir de rien ». Mais ça ne va pas, car Dieu est lui-
même quelque chose. Répondre ainsi, c’est donc un coup à se faire sévèrement gronder
par les métaphysiciens : on ne peut pas se servir de quelque chose pour justifier qu’il y
ait quelque chose...
On voit par là que la question de Leibniz incarne à elle seule toutes les vertus et tous les
péchés de l’interrogation métaphysique, « métaphysique » pouvant aussi bien prendre
un sens dépréciatif (métaphysique, donc frivole) qu’un sens positif (métaphysique, donc
profond).
De nos jours, la métaphysique n’a pas la vie facile. Fille anonyme des Grecs, elle s’est
trouvée malmenée par la philosophie contemporaine qui en dénonça le rationalisme
outrecuidant et le dogmatisme pédant : à quoi bon s’interroger sur la cause de toutes
choses ? À quoi bon couper les cheveux en quatre ? Y a qu’à faire comme si on était
chauve… On a d’ailleurs jamais cessé d’annoncer la mort de la métaphysique, mais sans
vraiment convaincre, car la longueur de l’agonie a fini par rendre le décès suspect.

D’ailleurs, je tiens entre mes mains la preuve qu’elle n’est pas tout à fait morte ou qu’elle
est ressuscitée. Le MENS, le groupe des Métaphysiciens de l’ENS, vient de publier sous la
direction de Francis Wolf un livre justement intitulé « Pourquoi y a-t-il quelque chose
plutôt que rien ? » Une dizaine d’auteurs s’attaquent vaillamment à cette question dont
Francis Wolf dit pourtant qu’elle est « l’Everest impossible à gravir de la métaphysique ».
Cela donne des articles passionnants, certains très difficiles pour un esprit comme le
mien, mais j’imagine que c’est la faute à la question posée.
Je vous le dis, il se pourrait bien que l’heure de la fin de la fin de la métaphysique soit en
train de sonner. Et vous tenez là, un possible livre de plage pour l’été. Sauf si la
métaphysique vous ennuie ou vous agace, auquel cas vous pourriez toujours vous
essayer à la métamathématique. J’ai d’ailleurs deux questions métamathématiques à
vous proposer, en guise de test de votre goût pour la chose :
1) Pourquoi un triangle est-il un triangle ?
2) Est-il envisageable que deux plus deux soit égal à cinq pour les grandes valeurs de
deux ?
Vous avez toute la durée du journal de 7h30 pour y réfléchir. Un temps aussi long pour
traiter deux questions bateau, c’est presque du luxe, je trouve...
[1] G. Leibniz, Principes de la nature et de la grâce fondés en raison, § 7, éd. A. Robinet,
Paris, PUF, 1954, p. 45.
1
/
3
100%