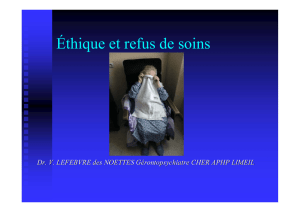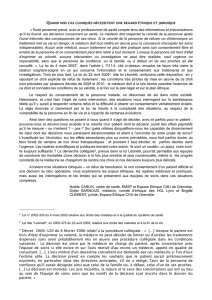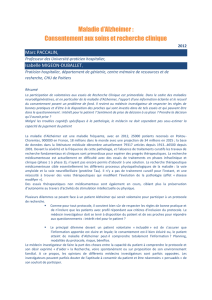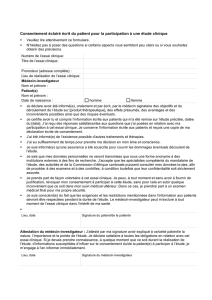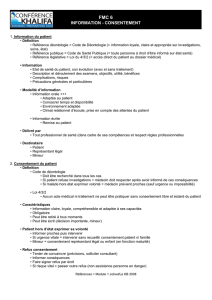1 RECHERCHE BIOMEDICALE SUR LA MALADIE D`ALZHEIMER

David Rodriguez-Arias Janvier Janvier 2008 ©
Cet article est protégé et ne peut être reproduit ou copié sans l’autorisation de l’auteur.
En cas de citation celle-ci doit mentionner : l’auteur (Nom et prénom), le titre, la rubrique du site Internet,
l’année,et l’adresse www.ethique.inserm.fr
1
RECHERCHE BIOMEDICALE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER :
QUESTIONS ETHIQUES
David RODRIGUEZ-ARIAS VAILHEN
Universidad de Salamanca/Université Paris-5
Résumé
Le vieillissement de la population dans les pays technologiquement développés
est une réalité sociale qui n’existait pas il y a 40 ans. La longévité de la
population entraîne nécessairement une augmentation de l’incidence des
maladies propres au grand âge. Le paradigme est illustré par les démences
séniles, et notamment par la maladie d’Alzheimer. Toute solution pour ces
patients doit venir de la main de la recherche biomédicale, ce qui implique de
réaliser des essais cliniques sur les malades. Or, l’inclusion de ces patients
dans des protocoles de recherche est très problématique: même s’il s’agit de
sujets irremplaçables pour tester des thérapeutiques expérimentales, il sont, de
par leur état de santé, par la relation de dépendance qu’il existe entre eux et les
médecins, et par leurs capacités psychiques altérées, des personnes
vulnérables. La recherche clinique sur la maladie d’Alzheimer est à la fois
risquée d’un point de vue moral et nécessaire d’un point de vue scientifique et
social. Dans cet article, les enjeux éthiques posés par la recherche biomédicale
sur les personnes qui ont la maladie d’Alzheimer sont analysés. Il est
argumenté que le respect et la protection de ces sujets participant à la
recherche ne découle pas fondamentalement du respect des principes de
bienfaisance (bénéfice potentiel de la recherche) et d’autonomie (consentement
éclairé), mais du principe de non-malfaisance. En effet, ce qui peut justifier la
recherche sur les malades d’Alzheimer n’est pas le bénéfice potentiel qu’ils
peuvent en tirer -quand ce bénéfice est difficilement mesurable-, ni leur
consentement –lorsqu’il est donné par des patients qui ont perdu leur pleine
compétence- mais la preuve qu’ils ne peuvent subir des préjudices significatifs.
L’absence de risques constitue une condition nécessaire, mais insuffisante. Tel
qu’établi dans la loi française du 9 août 2004, ces recherches se justifient au
regard du bénéfice escompté pour d'autres personnes placées dans la même
situation.

David Rodriguez-Arias Janvier Janvier 2008 ©
Cet article est protégé et ne peut être reproduit ou copié sans l’autorisation de l’auteur.
En cas de citation celle-ci doit mentionner : l’auteur (Nom et prénom), le titre, la rubrique du site Internet,
l’année,et l’adresse www.ethique.inserm.fr
2
Introduction
La maladie d’Alzheimer est une affection dégénérative du cerveau qui atteint
des capacités psychiques, telles que la mémoire, la parole ou le jugement, mais
aussi d’autres capacités motrices limitant de façon progressive l’autonomie du
patient. Son nom est dû à Alois Alzheimer, disciple du professeur Emil
Kraepelin, qui en 1907 décrivit pour la première fois la maladie :
« Les malades régressent mentalement, leur mémoire et leur pensée dépérissent, ils
sont égarés, désorientés, ne sachant plus où ils se trouvent ne reconnaissant plus les
gens. Par la suite ils développent une certaine agitation, transpirent beaucoup,
marmonnent et rient sans raison, courent, se recroquevillent, se mettent à gratter, à
déchiqueter les tissus et deviennent incontinents. Plusieurs désordres asymboliques
apparaissent, les malades ne comprennent plus les demandes ni les signes, ne
reconnaissent plus les objets ni les images. Les troubles du langage sont
particulièrement profonds, jusqu'au mutisme. Ils sont incapables de manger et de
s’occuper d’eux-mêmes, mettent à la bouche ce qu’on place dans leur main et sucent
les objets présentés. Les malades mettent plusieurs années à atteindre le stade final
et la mort est généralement provoquée par une cause extérieure. »1
Il est difficile d’estimer la prévalence de cette maladie, notamment parce qu’elle
est difficile à dépister. Selon quelques estimations, en France, environ 500 000
personnes sont atteintes par la maladie d’Alzheimer2, ce qui représente 60 a 75
% de l'ensemble des démences. L’Alzheimer touche 4,4 % de la population de
plus de 65 ans ainsi que 15 % de celle de plus de 85 ans. Selon certains,
jusqu'à 47% de la population âgée de plus de 85 ans serait atteinte de la
maladie (Evans et al. 1989). Le vieillissement général de la population rend tout
pronostic sur la prévalence de la maladie très préoccupant. En France, le
nombre de personnes en institution à cause de cette maladie pourrait
augmenter de 440 000 personnes en 1999 à 550 000 cas en 2010. Face à cette
réalité, la médecine a le devoir de combattre la maladie sur deux fronts : le soin
et la recherche biomédicale.
L’objectif de cet article sera d’analyser les enjeux éthiques posés par la
recherche biomédicale sur les personnes qui ont la maladie d’Alzheimer.3 On
1 Cité par Lebert, F. Révolution du soin, évolution des mentalités, La Recherche. Hors série.
Alzheimer Cerveau sans mémoire, nº 10, 2003, p. 11
2 Berr, C. Combien de démences dans 20 ans ? La Rechche. Hors série. Alzheimer Cerveau
sans mémoire, nº 10, 2003, 16-17
3 Cette recherche s’est basée sur deux ouvrages consacrés aux problèmes éthiques et légaux
que pose la recherche biomédicale sur l’Alzheimer : Melnick, V. and N. Dubler, Eds. (1981).

David Rodriguez-Arias Janvier Janvier 2008 ©
Cet article est protégé et ne peut être reproduit ou copié sans l’autorisation de l’auteur.
En cas de citation celle-ci doit mentionner : l’auteur (Nom et prénom), le titre, la rubrique du site Internet,
l’année,et l’adresse www.ethique.inserm.fr
3
verra que ces enjeux ont beaucoup à voir avec le fait que ces malades
présentent des difficultés pour donner un consentement libre et informé étant
donné le déclin cognitif progressif que la maladie comporte. Une tension morale
apparaît lorsque le besoin scientifique d’inclure ces patients dans des
recherches pour obtenir les connaissances nécessaires à l’amélioration des
procédures cliniques actuelles compromet les exigences de protection et de
respect à l’égard de ce type de patients, dont le consentement éclairé serait en
partie garant. Mise à part la difficulté à obtenir le consentement éclairé à la
recherche de la part de ces malades, deux spécificités méritent d’être
soulignées:
1. La difficulté technique et scientifique à trouver des modèles animaux
ou à étudier la maladie chez des sujets sains ou aptes à consentir.
Ceci est dû fondamentalement à l’intérêt de connaître l’impact de la
maladie sur la conscience et sur les capacités cognitives et affectives
humaines.
2. La difficulté à attribuer à la procédure expérimentale un bénéfice
individuel direct pour des patients en phase avancée de la maladie,
ainsi que la difficulté qui en découle à prouver une balance positive
bénéfice-risque.
Nous verrons que l’acceptabilité d’inclure ce type de patients dans des essais
cliniques, en particulier lorsqu’ils ne peuvent pas consentir, s’évalue
fondamentalement par l’existence ou non de risques pour le sujet. Notre thèse
sur les circonstances dans lesquelles ce type de patients devraient être inclus
dans des protocoles de recherche se veut une proposition, dont l’objectif est
plus d’aider à formuler des questions qu’à donner des réponses.
L’Alzheimer, un problème de santé publique
L’Alzheimer atteint les capacités psychiques qui sont souvent considérées
essentielles à la condition humaine et à la personnalité. C’est ce qui la rend
dévastatrice, non seulement pour le patient mais aussi pour son entourage
familial. Au fur et à mesure que la maladie s’installe, les soins qu’exige un
Alzheimer's Dementia: Dilemmas in Clinical Research. Clifton, The Humana Press, Berg, J., H.
Karlinsky and F. Lowy (1991). Alzheimer's Disease Research. Ethical and Legal Issues.
Vancouver, Carswell.

David Rodriguez-Arias Janvier Janvier 2008 ©
Cet article est protégé et ne peut être reproduit ou copié sans l’autorisation de l’auteur.
En cas de citation celle-ci doit mentionner : l’auteur (Nom et prénom), le titre, la rubrique du site Internet,
l’année,et l’adresse www.ethique.inserm.fr
4
patient atteint sont de plus en plus importants. Dans les phases les plus
évoluées, le patient finit par perdre aussi des capacités de locomotion, de
contrôle des mouvements et reste au lit dans un état semi végétatif, avec
éventuellement des périodes de répit.
L’augmentation de la durée de la vie est un acquis bivalent de la médecine. Les
personnes veulent à la fois vivre le plus longtemps possible tout en conservant
leur qualité de vie. Le défi de la médecine actuelle consiste justement à tenir en
compte ces deux facteurs. Tant que la médecine ne trouvera pas une solution,
l’Alzheimer poursuivra sa progression, jusqu'à devenir la maladie grave la plus
répandue des pays technologiquement développés.
La maladie d’Alzheimer constitue donc un problème grave de santé publique :
des institutions adaptées à ce genre de patients manquent. Malgré le fait que
ces patients souffrent souvent de douleurs aiguës, ils ne sont pas prioritaires
dans les critères d’hospitalisation des unités de soins palliatifs : leur pronostic
très incertain –il s’agit de patients irréversibles mais pas nécessairement en
phase terminale- est une raison probable à la difficulté pour ces patients
d’accéder aux soins palliatifs. Fréquemment, les personnes démentes sont
institutionnalisées dans des résidences spécialisées.
Les thérapeutiques actuelles pour la maladie ont une portée curative limitée,
car elles servent plus à réduire les symptômes qu’à arrêter le déclin des
capacités cognitives des patients. Beaucoup d’efforts ont été mis dans le
dépistage. Si la maladie est dépistée précocement, elle peut être prévenue
temporairement chez les personnes à risque et peut être également soulagée.
La restitution des fonctions n’est pour l’instant pas à la portée de la médecine,
mais des espoirs sont fondés sur la thérapie génique cellulaire régénérative
issue de la recherche sur les cellules souches. Beaucoup d’espoirs pour trouver
des solutions pour ces patients sont ainsi placés sur la recherche biomédicale,
ce qui implique de réaliser des essais cliniques sur les malades.

David Rodriguez-Arias Janvier Janvier 2008 ©
Cet article est protégé et ne peut être reproduit ou copié sans l’autorisation de l’auteur.
En cas de citation celle-ci doit mentionner : l’auteur (Nom et prénom), le titre, la rubrique du site Internet,
l’année,et l’adresse www.ethique.inserm.fr
5
Cadre légal en France pour la recherche sur des personnes sans capacité
à consentir
Jusqu’en 2004, la recherche biomédicale en France était encadrée par la Loi
n° 88-1138 du 20 décembre 1988 (J.O. du 22 décembre 1988) relative à la
protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales — dite
«loi Huriet-Sérusclat ». Compte tenu de la transposition obligatoire de la
directive européenne relative aux essais cliniques des médicaments, des
modifications de cette loi ont été faites afin de mieux garantir la protection des
personnes et d’organiser une recherche de qualité en cohérence avec les
directives européennes. La loi du 9 août 2004, en vigueur, dans son art. l.
1121-8, concernant les majeurs incapables, établit ce qui suit :
« Les personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection légale ou hors
d'état d'exprimer leur consentement ne peuvent être sollicitées pour des recherches
biomédicales que si des recherches d'une efficacité comparable ne peuvent être
effectuées sur une autre catégorie de la population et dans les conditions suivantes :
- soit l'importance du bénéfice escompté pour ces personnes est de nature à
justifier le risque prévisible encouru ;
- soit ces recherches se justifient au regard du bénéfice escompté pour
d'autres personnes placées dans la même situation. Dans ce cas, les risques
prévisibles et les contraintes que comporte la recherche doivent présenter un
caractère minimal.»
Afin de commenter et d’étudier la signification de la loi dans le cas des malades
d’Alzheimer, on analysera trois aspects : le consentement éclairé, le rapport
entre le bénéfice et le risque de la recherche et le processus de sélection des
sujets de recherche.
Consentement éclairé et compétence
La capacité est une question de degré
La maladie d’Alzheimer n’implique pas nécessairement une incompétence à
décider. Comme il a été signalé, la maladie elle-même comporte une
dégradation progressive et inexorable des capacités cognitives. Le caractère
progressif de la maladie, ainsi que la possibilité de la diagnostiquer de manière
prématurée, oblige à évaluer au cas par cas si le patient est ou non capable de
consentir. Une étude de Kim et al.5 montrait en 2002 que les patients atteints
d’Alzheimer étaient capables de distinguer, pour des situations hypothétiques,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%