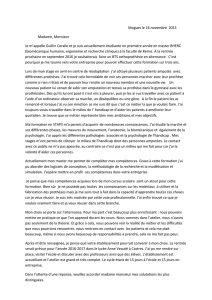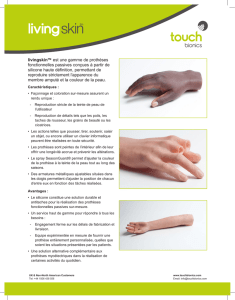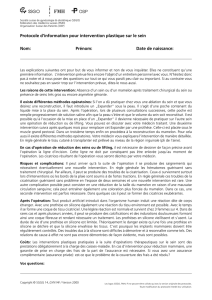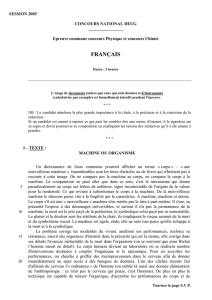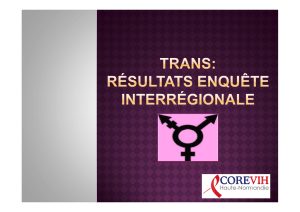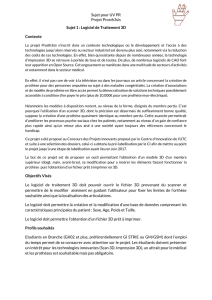Biomatériaux : application aux biomatériels complexes

I. INTRODUCTION
Les biomatériels complexes sont faits de plusieurs
biomatériaux qui peuvent éventuellement être animés de
mouvement pour suppléer à certaines fonctions intermittentes
de l’organisme.
Ainsi, par exemple, le rétablissement de la miction peut
nécessiter soit la confection prothétique d’un nouveau réservoir
vésical capable de se vidanger, soit la restauration de la
fonction sphinctérienne avec une prothèse permettant la
continence des urines et la miction sans résistance urétrale.
Pour ces deux exemples ont été inventées et mises au point de
nombreuses prothèses, ou biomatériels, constituées de très
nombreux biomatériaux :sphincter artificiel urinaire et
également ballons ajustables, enfin vessie artificielle pour
laquelle les espoirs se tournent définitivement vers les solutions
apportées par le génie tissulaire.
D’autres applications urologiques utilisent des biomatériels
complexes: les prothèses d’érection, les prothèses testiculaires
et le remplacement urétéral. Enfin les Urologues disposent
depuis quelques années de dispositifs médicaux implantables
actifs, comme les neuromodulateurs.
II. LES BIOMATERIAUX
Les biomatériaux utilisés actuellement dans ces prothèses
complexes sont majoritairement des polymères. Des métaux
peuvent également entrer dans leur composition.
1. Le silicone
On regroupe sous le nom de silicones,toute une famille de
polymères aux propriétés très variées, dont le point commun est
le motif unitaire siloxane -(SiR2-O)n-. Le polymère de base est
le polydiméthylsiloxane -[Si(CH3)2-O]n- ou PDMS, dont les
chaînes sont naturellement très souples. La grande diversité de
leur propriétés, et par conséquent de leurs applications, dépend
non seulement de la longueur des macromolécules lorsqu’elles
sont linéaires mais aussi du taux de réticulation lorsqu’elles
sont tridimensionnelles. Les élastomères de silicone sont
obtenus par réticulation chimique des macromolécules
linéaires. Pour améliorer leurs propriétés mécaniques, les
élastomères sont renforcés par des nanoparticules, en
particulier de silice. Grâce à ces charges la résistance en
traction passe de 0,7 à 10,3 MPa. La mise en forme s’effectue
généralement par extrusion ou injection à froid. Pour les
implantations prothétiques, les élastomères de silicone utilisés
sont de structure solide ou sous forme de gel. Le terme de
silicone est employé ci-dessous pour désigner ces polymères.
Ce polymère est connu pour sa grande biocompatibilité. Sous
forme de gel, il peut, in vivo,migrer par gravité ou, si les
particules sont de petite taille (< 110 µm), être phagocyté par
les macrophages.
F.S. Kiping est considéré comme le père de la chimie des
silicones. De 1899 à 1944, il publie 54 articles sur le sujet. La
Dow Corning Corporation est créée en 1943, dans le but de
fabriquer des lubrifiants pour avion. En 1945, la gomme de
silicone est mise au point. Dès 1946, elle trouve une application
médicale (création d’un urètre artificiel). En 1956, on l’utilise
pour le traitement des hydrocéphalies. En 1953 J.B. Brown
envisage la possibilité de prothèses sous-cutanées en silicone.
La première prothèse mammaire est implantée en 1962.
En Urologie les premières prothèses en silicone, ont été décrites
en 1966 pour le traitement de l’impuissance et en 1973 pour
l’incontinence [4,53].
Vingt ans plus tard deux articles ont montré que les prothèses
urologiques en silicone solide peuvent se détériorer et laisser
échapper des particules retrouvées ensuite dans les nodules
lymphatiques [6,47]. D. Barrett a mis en évidence ces particules
autour de la prothèse dans 72% des 25 cas de prothèses
(sphinctérienne ou pénienne) retirées entre 2 et 60 mois après
implantation [6]. Y. Reinberg trouve également du silicone dans
la coque péri-prothétique dans les 3 cas de sphincter artificiel
retirés chez l’enfant, 3, 7 et 10 ans après implantation. Ces
particules étaient entourées de cellules géantes formant des
granulomes inflammatoires [47]. Dans l’étude de D. Barrett, 3
nodules lymphatiques inguinaux et 1 nodule péri-aortique, tous
cliniquement pathologiques, ont montré aussi la présence de
granulomes avec du silicone (10 à 30 µm). Tous ces patients
étaient heureusement indemnes de maladie auto-immune
[6,47]. Les prothèses retirées présentaient des particules de
silicone libre à leurs surfaces.
Ces articles sont parus de façon contemporaine au débat sur les
prothèses mammaires et les risques de migration des prothèses
Progrès en Urologie (2005), 15 953-963
Chapitre VI
Biomatériaux : application
aux biomatériels complexes en Urologie
Pierre CONORT, Jean Louis PARIENTE
953

gonflées avec du silicone liquide ou en gel. En effet le PDMS
utilisé dans les mammoplasties pouvaient contenir de 0,1 à 15%
de particules de faible taille, capables d’induire une réponse
immunitaire cellulaire et des anticorps chez le porc [29].
Cependant aucune preuve n’est actuellement établie pour
incriminer les prothèses en silicone dans le cadre de maladie de
système [52]. Les risques juridiques pouvant impliquer les
fabricants ont été tels que le fournisseur principal (Dow
Corning - Midland, Michigan, USA) avait même retiré ses
produits du marché médical, laissant le marché ouvert à des
distributeurs dont la qualité de la poudre de silicone n’était pas
toujours garantie [40]. Cette période du début des années 1990
est heureusement révolue avec l’application en 1992 aux USA
puis en mars 1994 de recommandations de l’AFNOR sur le
silicone médical.
La comparaison avec les prothèses mammaires et les prothèses
utilisées en urologie doit être menée avec précaution. En effet
les anciennes prothèses mammaires présentaient des fuites dans
près de 60% des cas, laissant échapper le silicone de
remplissage. Une des causes retenues étaient la création d’une
coque fibreuse constrictive autour de la prothèse, facilement
exposée du fait de sa topographie au choc, augmentant ainsi le
risque de fuite. Ces phénomènes ont pratiquement disparu
depuis l’utilisation de prothèses dites « texturées », dont la
surface est couverte de polyuréthane. Cet enduit diminue la
formation de cette coque et limite, si besoin, la perte de
particules de silicone en périphérie de la prothèse [54].
Un doute cependant persiste puisque ont été décrits l’apparition
de lymphomes simultanés à l’existence d’adénopathies
contenant du silicone [5,20]. De plus l’exposition au silicone,
répétée ou continue, par exemple en dialyse, a pu être
incriminée dans l’apparition d’hépatite granulomateuse, de
pancytopénie et de splénomégalie [3,10,11]. Enfin le suivi de
cohortes de patients porteurs de prothèses médicales
constituées de silicone (prothèses mammaires, prothèses
péniennes, pacemaker en particulier) permet une meilleure
approche du problème, même s’il est difficile de faire des
comparaisons. S. Greenland poursuit ce projet depuis près de
10 ans en étudiant les données de Medicare sur 52 pathologies.
Les patients implantés sont « associés » à des patients
comparables traités dans la même discipline : par exemple les
prothèses péniennes sont dans le groupe des résections de
prostate. Dans ce dernier groupe, l’analyse faite en 1999,
montre une plus forte proportion de lupus, de neuropathies, de
collagénoses et de scléroses pour les patients avec prothèse
pénienne que pour les autres. S’il est difficile de conclure, il
faut faire preuve de prudence. Toutes ces considérations
doivent d’une part imposer une information complète sur les
risques connus et inconnus des prothèses contenant du silicone,
et d’autre part inciter les fabricants comme les Urologues à
créer des registres non seulement de comptabilité des
implantations, comme cela est le cas pour le sphincter artificiel
urinaire, mais aussi pour le suivi à long terme. La matério-
vigilance est une façon de transmettre à la communauté les
évènements indésirables, même tardifs. L’Urologue et le
médecin référent doivent donc être avertis de la nécessité de
rapporter toute maladie nouvelle de « type systémique ou de
système » apparue chez un patient porteur ou ayant porté une
prothèse urinaire.
Le silicone, non dégradable, décrit comme inerte, n’a donc pas
fait la preuve de sa biocompatibilité parfaite à long terme.
2.Le polyuréthane
Le polyuréthane (PEU) est un copolymère à blocs, composé
d’unités souples et rigides. C’est un élastomère
thermoplastique qui permet de réaliser des implants préformés
qui peuvent être recouverts de mousse de PEU pour mieux
stabiliser la prothèse dans les tissus (pores). Il existe en fait de
nombreux polyuréthanes (polyester, polyéther) en fonction de
différents additifs qui ne sont en règle non divulgués.
Le polyuréthane a d’excellentes propriétés mécaniques,
comparé au silicone, mais par contre est moins stable dans
l’organisme que le silicone, en particulier les formes liées à un
polyester [64].
Il peut être associé à un autre biomatériau, comme par exemple
le silicone comme cela a été proposé pour les prothèses
mammaires dites texturées. La surface de la prothèse en
silicone pur est lisse et entraîne une réaction fibreuse intense
avec formation de coque. Le revêtement en PEU limite cette
réaction.
3. Le Bioflex®
Bioflex®est un brevet de Mentor Corporation, CA, USA. Ce
biomatériau est un polyuréthane combiné avant l’extrusion
avec un méthylène di-isocyanate et un polytétraméthylène-
ether-glycol associé à de l’éthylène diamine, du dioxyde de
silicone et du PDMS. L’éthylène diamine et l’isocyanate
contribuent à la formation du constituant dur alors que
polyéther et isocyanate à celle de la partie molle du co-
polymère. Le Bioflex®est ensuite moulé.
4. Le polytétrafluorouréthane (PTFE)
C’est un polymère thermoplastique, biocompatible largement
utilisé en urologie en particulier pour des traitements de surface
(coating) ; le liant est souvent un polyuréthane [64]. Le PTFE
induit une réaction immunitaire minime. Il peut être tissé ; les
tubes formés, sans couture, ont un aspect ondulé. Les
interstices, plus ou moins fins, sont colonisés par des
fibroblastes, ce qui permet de stabiliser la prothèse dans les
tissus humains. Des interstices trop larges entraînent assez
rapidement une obstruction du canal. Ce matériau est utilisé
depuis longtemps en chirurgie vasculaire, mais il est mal adapté
aux indications urologiques de remplacement canalaire. Il est
possible de l’associer à un autre biomatériau comme le silicone
par exemple.
Il existe une forme particulière, dite expansée (PTFE-e),
connue sous le nom de Gore-Tex®,qui présente des pores de
très petite taille (1 à 60 µm), qui n’autorisent pas le passage
cellulaire, évitant ainsi l’obstruction endo-luminale.
5. Le polyester ou poly(téréphtalate d’éthylène)
C’est un polymère thermoplastique qui peut être tissé. Dans sa
forme expansée les pores sont de taille variable allant de 60 µm
à 1200 µm. Il peut avoir une forme de tube et recouvrir un tube
954

de silicone. Il est différent du polyéthylène autrefois utilisé
pour former de simples tubes.
6.Les hydrogels
Les hydrogels sont utilisés comme revêtement de surface sur
d’autres polymères. Ils permettent de réduire le coefficient de
friction et de limiter l’adhésion bactérienne par rapport aux
polymères hydrophobes qu’ils recouvrent.
Ils sont constitués d’alcool de polyvinyl, d’hydroxy-éthyl
méthacrylate, de polyvinyl pyrrolidone en particulier[64].
7. Les métaux
L’acier est un des composants métalliques des prothèses
complexes. L’argent, l’alliage cobalt-chrome et le titane sont
également utilisés dans certaines prothèses.
III. SPHINCTER ARTIFICIEL URINAIRE
L’objectif du sphincter artificiel urinaire (SAU) est de rétablir
la fonction d’occlusion du sphincter pratiquement au même
niveau anatomique que le sphincter externe volontaire
déficient. L’insuffisance sphinctérienne avec incontinence
invalidante est donc l’indication de ce type de prothèse.
Un des premiers auteurs qui a développé le concept de
compression urétrale est J. Kaufman dès 1968 [36]. Les
résultats étaient décevants [48]. En fait c’est F. Scott W.,
Bradley et G. Timm qui décrirent les premiers le SAU très
voisin du modèle disponible aujourd’hui [53]. Il s’agissait
d’une prothèse implantable, et non pas externe comme F. Foley
l’avait proposé en 1947.
Le principe du SAU, connu sous le nom de AMS 800
actuellement (American Medical Systems – USA) repose sur
l’existence d’une manchette en élastomère de silicone,
préformée pour s’adapter au périmètre du canal urétral,
(éventuellement en péri-cervical, autour de la prostate, dans
certains cas) qui est connectée à une pompe placée en sous-
cutanée (bourse ou grande lèvre) elle-même également
connectée avec un ballon ou réservoir qui donne le niveau de
pression interne du système. Plusieurs modèles de réservoir
sont disponibles selon la pression souhaitée. L’ensemble de la
prothèse est en élastomère de silicone pur. Seuls le mécanisme
de la pompe (resistor) est en acier. Les tubulures elles-mêmes,
afin d’éviter des plicatures bloquant le système, ont été
renforcées, à la fin des années 1980, par une armature de
polyéthylène qui constitue également les connecteurs, ou
raccords, entre tubulures. La pompe dispose d’un relief
palpable au travers de la peau qui permet à l’opérateur de
neutraliser le fonctionnement de la pompe (désactivation) si
besoin. Lorsque le système est activé la pression hydraulique
exercée par le ballon, rempli en per-opératoire de sérum
physiologique isotonique contrasté (repérage du SAU par
rayons X, sauf si intolérance à l’iode), permet de maintenir
occluse la manchette péri-urétrale. Le patient qui ressent un
besoin d’uriner doit donc appuyer plusieurs fois sur l’extrémité
de la pompe pour vider la manchette, envoyant le liquide vers
le ballon ; en 2 à 3 minutes automatiquement la manchette se
remplit. Il s’agit d’un système hydraulique simple et fiable
(Figure 1).Il n’y a pas de modèle avec enduit de protection
contre les infections. Dans d’exceptionnels cas deux
manchettes ont été implantées.
La première publication française rapportait l’expérience sur 15
patients en 1987 [8]. Depuis plusieurs centaines de patientes et
patients, et même d’enfants, ont réellement bénéficié de ce type
de prothèse Le taux de succès (patient sec) est de l’ordre de
61% à 88% des cas selon le sexe (meilleurs chez la femme) et
l’étiologie de l’incontinence [12,13,43,55]. Avec le temps des
complications mécaniques sont apparues imposant des
révisions prothétiques (10%à 15%), correspondant en fait le
plus souvent à des changements de un ou plusieurs éléments du
système [41]. Les révisions doivent être mises au débit de la
biocompatibilité et déclarées en matériovigilance, logiquement.
En effet par principe la biocompatibilité est acquise lorsque le
biomatériel est bien toléré mais aussi lorsque la prothèse assure
sa fonction sans faille ni complication. Le taux de révision des
différentes séries est assez stable, voisin de 20%, avec une
moyenne de délai de révision de 7 à 10 ans [43,62]. La révision
peut être nécessaire également en cas de complications
principales, immédiates et parfois tardives (plusieurs années),
comme l’infection et surtout les érosions. L’infection est
prévenue par une prophylaxie antibiotique rigoureuse.
Cependant les minimes plaies opératoires, ou une érosion
muqueuse, peuvent faire communiquer la prothèse avec
l’extérieur (vagin) ou l’urine (urètre). L’infection déclarée
impose l’ablation de tout le matériel le plus souvent, puisque
tous les éléments du SAU communiquent entre eux par les
tubulures. L’érosion est une complication sournoise qu’il faut
savoir évoquer même en l’absence d’infection. Il n’est pas
exclu que certaines érosions soient le résultat d’une réaction à
corps étranger.Comme l’érosion peut facilement se compliquer
d’infection, la preuve est difficile à apporter.
955
Figure 1 : sphincter artificiel urinaire avec ses 3 éléments connectés
(AMS 800®).

Ces complications, mécaniques ou cliniques, ont amené le
fabricant (American Medical Systems) à apporter quelques
modifications pour fiabiliser l’ensemble des éléments.
Même si le taux de succès est très satisfaisant, avec une
amélioration extraordinaire de la qualité de vie, plusieurs
contre-indications doivent être cependant retenues. Il faut bien
sûr que le réservoir vésical sus-jacent soit compétent (bonne
capacité et bonne compliance), que les tissus où siège la
prothèse puissent être disséqués et puissent cicatriser (pas
d’antécédent d’irradiation, difficulté après plusieurs chirurgies
périurétrales) et aussi que le patient comprenne le mode
d’emploi et ait une dextérité suffisante (problème chez les
patients neurologiques et âgés).
Cette prothèse a une bonne fiabilité mécanique, mais il faut
rappeler qu’elle est constituée de silicone pur et que le
biomatériau peut perdre quelques éléments de sa structure
polymérique avec le temps, parfois en quelques mois [6]. Des
granulomes sur particules de silicone ont été retrouvés dans la
coque péri-prothétique et dans les nodules lymphatiques
inguinaux pathologiques prélevés [42]. La migration de
particules de silicone à partir de la prothèse a deux
conséquences pratiques :
-il faut informer le patient (ou ses parents pour les enfants)
des réserves médicales sur le long terme puisqu’il est décrit
certaines maladies de système, certes rares, et peut-être
trouver d’autres alternatives ou modification prothétiques
pour les plus jeunes ;
-il faut tenir des registres à long terme sur ses patients et
enseigner les référents médicaux pour qu’une déclaration de
matériovigilance soit faite en cas de doute (sclérodermie,
lupus, rhumatisme…)
Les avantages du SAU sont tels qu’il paraît inopportun de faire
une critique plus appuyée de cette prothèse compte tenu des
services rendus. Il faut cependant que la vigilance des
urologues soit constante.
D’autres SAU ont été depuis mis au point et testé. Le principe
des prothèses reposait toujours sur une manchette avec
différents systèmes de pompe et de connexion. Aucune
prothèse n’a eu un développement clinique.
L’AMS 800 a également été utilisé pour occlure des stomies
urinaires pariétales. L’ouverture de la manchette péri-stomiale
autorise le sondage évacuateur [6,47].
IV.PROTHÈSES PÉNIENNES
La dysfonction érectile a fait l’objet de nombreux progrès dans
sa prise en charge depuis 20 ans environ. Les injections
intracaverneuses, les inhibiteurs de la phospho-diestérase, la
dépression péri-pénienne entre autres, ont modifié
sensiblement la place des prothèses péniennes, encore appelées
prothèses d’érection.
L’insuffisance vasculaire des corps érectiles et les échecs, assez
rares, des traitements médicaux restent les indications
principales des prothèses, chez des patients très motivés.
Les prothèses péniennes existent depuis plus de 30 ans. Le
concept repose sur l’implantation, à l’intérieur des deux
caverneux, en épargnant les vaisseaux centro-caverneux, les
nerfs et l’urètre.
G. Beheri décrit en 1966 des cylindres intracaverneux [4].
Simultanément au SAU, F Scott et col décrirent une prothèse
gonflable (hydraulique) alors que M. Small et H. Carrion
proposaient un modèle non-gonflable donc a priori moins
physiologique. En effet l’objectif est de donner une rigidité
suffisante dans l’axe, pour permettre un rapport, puis le retour
àla flaccidité pour le confort et l’esthétique du patient.
A la différence du SAU il existe de nombreux modèles de
prothèse pénienne (PP). Les PP peuvent donc être hydrauliques
ou non, avec un système compact où pompe, réservoir et
cylindre sont un élément unique, ou bien tous les éléments sont
séparés.
Les années 1980 ont vu l’apparition de différents modèles
prothétiques qui ont été peu diffusés comme la prothèse armée
(âme métallique flexible en argent) non hydraulique de U.
Jonas qui publie de bons résultats à long terme dans plus de
90% des cas, 66%seulement pour R. Krane [39]. L’âme
centrale du cylindre s’est compliquée de fracture mais
apparemment aucun corps métallique n’a franchi le manchon
de silicone [45,57]. Une prothèse très simple faite d’un cylindre
étroit en silicone a té mise au point et publiée par L. Subrini
avec plus de 80% de bons résultats [56]. Cette prothèse a été
également proposée pour allonger la verge en vue
d’appareillage avec un étui pénien chez des patients
incontinents. Des cylindres d’autres modèles peuvent être
implantés à cet effet.
Actuellement du fait du nombre réduit d’indications et de la
difficulté de mettre au point une prothèse avec toutes les
garanties exigées par la législation des biomatériaux, il n’existe
que deux fabricants de PP : American Medical Systems (AMS)
et Mentor.
1. Les prothèses hydrauliques
Chacun des fabricants en propose une.
Mentor utilise le Bioflex®,beaucoup plus résistant que le
silicone pure du fait du composant majoritaire en polyuréthane.
Le Bioflex®constitue les parois mono-couches des prothèses.
Pour AMS (Minnesota, USA) l’évolution a été sensible depuis
15 ans. Les premières prothèses avaient un cylindre constitué
d’une seule couche assez fine de silicone, ce qui entraînait
hernies prothétiques et ruptures (Figure 2).
956
Figure 2 : hernie prothétique découverte lors du retrait d’une
prothèse non fonctionnelle.

Actuellement il existe trois couches pour renforcer la paroi qui
doit jouer le rôle d’une albuginée. Le cylindre est composé d’un
cylindre interne de silicone qui est enduit de Parylène®sur ses
deux faces. Ce polymère, d’une épaisseur de 5.10-3µm,
« lubrifie » l’élastomère de silicone et diminue friction et usure
(de plusieurs millions de cycles) [26]. La couche moyenne est
faite de d’un tissage de polyester et lycra, permettant
allongement et augmentation de diamètre. Enfin la couche
externe est constituée de silicone avec Parylène®interne et
éventuellement traitement de surface externe (Figure 3)[26].
Les autres biomatériaux concernés sont le polyéthylène pour
les tubulures et les raccords, comme dans le SAU, et l’acier
dans la pompe. A été récemment ajouté un traitement de surface
sur certaines prothèses afin de diminuer le risque d’infection du
site opératoire, évalué aux alentours de 3% en moyenne (2% à
8%) dans les séries. L’infection est le plus souvent à
Staphylococcus epidermidis. Deux concepts s’opposent pour ce
revêtement prophylactique.
Mentor propose un revêtement avec un hydrogel
(polivinylpyrrolidone) qui permet à l’opérateur de choisir
l’antibiotique dans lequel la prothèse est immergée juste avant
l’implantation. Ce concept s’appelle Resist®.Ceci autorise
donc toutes les variations possibles en fonction de l’écologie
microbienne du moment (Figure 4).
De son côté AMS présente le système Inhibizone®,breveté et
secret, qui recouvre la surface des différents éléments d’un gel
de minocycline et de rifampicine (Figure 5). Ces deux
traitements de surface semblent diminuer par 3 (W. Hellstrom
chez 12 patients) à 6 (R. Darouiche chez le lapin) le taux
d’infection [14,30].
En dehors de l’infection, les résultats à long terme font état de
fuites et diverses pannes mécaniques, assez semblables à celles
du SAU. La différence notable est que tout dysfonctionnement
d’un SAU est rapidement pris en charge et consigné car il
entraîne rétention ou fuite des urines. Pour les PP, la panne ne
force pas toujours le patient à consulter.De plus beaucoup de
prothèses ne sont pas utilisées ou rarement.
2. Prothèses non hydrauliques
Comme la prothèse de U. Jonas, les prothèses non-hydrauliques
actuelles, ou malléables, sont faites de 2 cylindres de silicone
avec une âme en argent gainé de PTFE (Acu-Form®de
Mentor) (Figures 6), ou en acier spiralé et polyester (AMS
600®et AMS 650®), ou encore avec des câbles en cobalt et
chrome avec du polyéthylène de haut poids moléculaire (AMS
Dura II®) (Figures 7). Ces prothèses sont plus simples à
implanter et devraient avoir moins de pannes mécaniques et
donc de révisions. Cependant le problème principal reste la
flaccidité avec parfois un redressement intempestif de la
prothèse [64].
957
Figure 3 : trois couches d’un cylindre d’une prothèse pénienne
constituée d’élastomère de silicone (gris), de Parylène®(bleu), de
Dacron®et lycra (damier gris) et d’une couche (orangée) externe
antibactérienne (Inhibizone®). Vue schématique d’un cylindre et
coupe transversale d’un modèle AMS 700®(American Medical
Systems).
Figure 4 : prothèse pénienne Titan®avec 3 éléments (B= ballon,
P= pompe, C= cylindre) avec une couche périphérique d’hydrogel,
Resist®(Mentor).
Figure 5 : prothèse pénienne AMS 700®avec 3 éléments (B=
ballon, P= pompe, C= cylindre) avec une couche périphérique
Inhibizone®(American Medical Systems).
Figure 6 : prothèse pénienne malléable avec fils d’argent tressés et
hydrogel en surface, Genesis®(Mentor).
Genesis®
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%