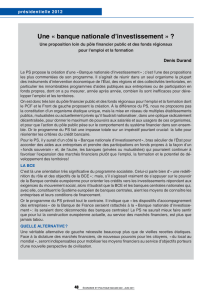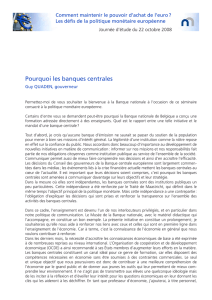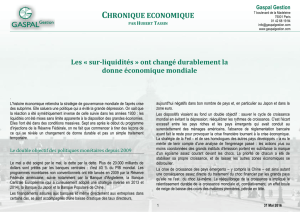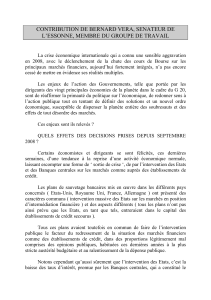La rénovation des politiques monétaires

– 195 –
ComplémentA
Larénovationdespolitiquesmonétaires
MichelAglietta
UniversitéParisOuest,CEPIIetGroupama‐am
Lacrisefinancièremetenquestionbiendesidéesreçues.Lapolitiquemonétairen’yéchappepas.
Parmilesvoixquifontautoritérienmoinsquel’économisteenchefduFMI,OlivierBlanchard1,et
l’anciengouverneurdelaBanquedeFrance,JacquesdeLarosière2,ontrécemmentémisdesvues
convergentes.Ladoctrined’obédiencemonétaristequiaprévaludepuistrenteansdoitêtre
sérieusementréaménagée.
Quelesbanquescentralesn’aientpasréagiàl’orgiedecréditsquiafaitmûrirlacriseestune
évidence.Qu’ellesaientsubilaglobalisationfinancièresanspouvoirmettreenplaceles
coopérationsnécessairespourenmaîtriserleseffetss’estvubienavantlacrise.AlanGreenspana
faitpartdeson«conundrum»,c’est‐à‐direl’insensibilitédestauxobligatairesaméricainsàla
remontéedutauxdesfedfundsàpartirdemai2004.Quantàl’inondationdeliquiditésavantla
crise,quiconqueobservaitlabasemonétairemondialepouvaitvoirsonétroitecorrélationavec
l’accumulationdesréservesdechange.
Ilfautdoncbiencomprendreenquoietpourquoiladoctrinediteduciblagedel’inflationestmise
enporteàfauxparlestransformationsdelafinance.Puisilfautredéfinirlesprincipeset
déterminerlesmoyensdelapolitiquemonétaireenrelationaveclarégulationfinancièrepour
viseràlafoislastabilitéfinancièreetlastabilitédesprix3.
1.Laconceptiondelamonnaieetladoctrinedelapolitiquemonétaire
Lescontroversessurlanaturedelamonnaiesepoursuiventindéfinimententredeuxconceptions
polaires.Pourlesunslamonnaieestexterneaumondedelaproduction.Carellen’exercepas
d’effetdurablesurlesprixrelatifsdesbiensetdesactifs.Sonoffreestexogène.Toutobjectifla
concernantpeutêtretenupourindépendantdetoutautrechoixsocial.Ilestdonclégitimequela
banquecentralesoitindépendantedesautresinstitutionspubliques.Entantquegarantede
l’intégritédubienpublicqu’estlamonnaie,elleénonceunenormed’inflationetutiliseun
instrument,leprixauquelellemetlaliquiditéultime,c’est‐à‐diresonpassif,àdispositiondes
banquespourlafairerespecter.«Uninstrument,unobjectif»estlesloganquirésumeladoctrine
delamonnaieexterne.
Pourlesautres,elleestlacontrepartieducréditquiestindispensableàlaproduction.Elleest
doncinterne.Sonoffreestendogène.Lamonnaieestdoncintrinsèquementliéeàlafinance.Une
économiemarchandeestdoncavanttoutunréseaudeliensdedettes.C’estuncommercede
1OlivierBlanchard,GiovanniDell’AricciaandPaoloMauro,«Rethinkingmacroeconomicpolicy»,IMFStaffPosition
Note,SPN/10/03,February12,2010.
2JacquesdeLarosière,«Towardsanewframeworkformonetarypolicy»,CentralBanking,vol20,n°3,2010
3Lesanalysesetpropositionsprésentéesicisontinspiréesd’uneétudeplusdétailléedeMichelAglietta,Laurent
berrebietAudreyCohen,«banquescentralesetglobalisation»,Expertisesn°7,Groupama‐AssetManagement,2009

– 196 –
promessessurdesbiensfuturs,avantd’êtreunéchangedebiensprésents.Dansleséconomies
monétaires,lepouvoirdecommanderlacréationdemonnaiepermetàladépensed’êtrele
moteurdel’économie.Cepouvoirestauxmainsd’agentsprivés,essentiellementlesbanques,
dansdesprocessusdeplusenpluscomplexesaufuretàmesurequesedéveloppementles
marchésfinanciers.C’estlepouvoirdecommanderlacréationmonétairequifaitdesbanquesdes
acteursspéciauxdelafinanceparcequelesdettesdesbanquessontpostuléesliquides.La
contraintedelaliquiditégarantitquecepouvoirn’estpasillimité.Cettecontraintesereflètedans
leurbilan,danslarelationentreleuractifetleurpassif.Al’actif,lesbanquesfontdescréditsen
tantquefirmesprivéescherchantàmaximiserleursprofits;aupassif,chaquebanquefaitpartie
dusystèmemonétaireetdoitdoncassurerl’équivalencedelamonnaiequ’ellecréeenmonnaie
centrale.Ils’ensuitquelesbanquessupportentdesrisquesqu’ellesnepeuventassumer
individuellementaumêmetitrequ’uneautrefirme.Ils’ensuitquedanslaconceptiondela
monnaieendogène,labanquecentralealaresponsabilitédepréserverlaliquiditédusystème
bancaire,conditionsinequanondelastabilitéfinancière.Mais,commelesbanquesontlepouvoir
delacréationmonétaire,lapréservationdelaliquiditénevapassanscontraintesde
réglementationetdesupervisionsurlesbanques.
Onvoitdoncquelesidéesthéoriquessurlamonnaieetlesprincipesdelapolitiquemonétaire
s’influencentréciproquement.Danslaconceptiondelamonnaieexogène,ditemonétariste,la
banquecentralen’apasàsepréoccuperdecequisepassedanslafinance.Assurerlastabilitédes
prix,c’est‐à‐direcelledelavaleurdel’unitédemonnaiesurunpanierconventionneldebienset
services,estsaseulemission.Lesbilansdesintermédiairesfinanciersnelaconcernentpas.Dans
laconceptiondelamonnaieendogène,lastabilitéfinancièreestunobjectifmajeurdesbanques
centrales.C’estd’ailleursceluiquilesaconstituéescommebanquesdesbanques4.Cetobjectif
n’estenaucuncascontenudanslastabilitédesprixtellequ’elleestdéfiniedanslaperspectivedu
monétarisme.
Oncomprendl’alternancehistoriquedesdoctrines.Lorsqu’unedoctrinedepolitiquemonétaire
inspiréed’unedesdeuxconceptionsdelamonnaierencontredesdifficultéspersistantes
d’application,lebesoindechangerdedoctrinefinitparrameneraupremierplanlaconception
opposée.Maiscen’estpassansdrame.Ainsia‐t‐ilfalluledéveloppementdelacriseinflationniste
danslesannées1970pourquelemonétarismetriompheàlasuiteducoupdeforcedePaul
Volckerenoctobre1979quiaouvertlavoieàlalonguephasederefluxdel’inflation.Lastabilité
desprixafaitavancerlaglobalisationfinancière,aouvertlavoieauxinnovationsfinancièreseta
facilitélesprisesderisqueagressives.Unesériedecrisesfinancièresaémaillécetteépoque
depuislemilieudesannées1990,jusqu’àlacriseglobalede2007‐2008.L’explosionde
l’endettementdanslesannéesquiontprécédécelle‐ci,alorsquelesprixétaient
remarquablementstablesetquelesbanquescentraleslouaientl’excellencedeleurpolitiquequi
avaitpermis«lagrandemodération»,montrentàquelpointladoctrinediteduciblagede
l’inflationétaitenporteàfauxavecladynamiquefinancière.
Ilestvraique,danscettepériodedetrenteans,ladoctrinemonétaireaconnudes
aménagements.Dèslesannées1980,lademandedemonnaiedevintinstablelorsqueles
innovationsfinancièressemirentàproposerdeprochessubstitutsauxcomposantesdel’agrégat
monétairesuiviparlesbanquescentrales.C’estlanotionmêmedequantitédemonnaiequi
devientflouelorsqu’enconcurrenceaveclaliquiditébancaire(lesdépôts)sedéveloppeune
liquiditéfinancière(destitrescapablesdedonnerunaccèsimmédiatauxmoyensdepaiementset
4MichelAgliettaandBenoîtMojon,Centralbanking,in«TheOxfordhandbookofbanking»,eds.A.Berger,
P.MolyneuxandJ.Wilson,OxfordUniversityPress,2010,chap9,pp.233‐256

– 197 –
descontratsdérivéstransférantlesfacteursderisqueincorporésdanscestitres)5.L’exclusivitéde
l’objectifdestabilitédesprixestdemeurée,maisl’instrumentdelaquantitédemonnaieest
devenuinopérant.
Sousl’impulsiond’AlanGreenspan,laFedamisenœuvreuneapprochepragmatiquequiaété
rationaliséeparlathéorieaucoursdesannées1990.Leproblèmedelaformationdes
anticipationsd’inflation,c’est‐à‐diredelaconfiancedanslavaleurdelamonnaie,estunjeude
coordinationquiadeséquilibresmultiples.Ilrevientàlapolitiquemonétairedefixerlepointfocal
surlequellesagentssecoordonnentimplicitementenleurdonnantuncadreinstitutionnelqui
permetted’éliminertousleséquilibressaufuneplageétroite.Cecadreserecommanded’une
doctrinemonétairerenouvelée:leciblageflexibledel’inflation6.Lecadreinstitutionnelpeutêtre
définicommeundomained’actiondelabanquecentralequiestunediscrétioncontrainte.La
stabilitédesprixestdéfiniecommeuneplagedeviabilitédestauxd’inflationfuturs,annoncésou
nonparlabanquecentrale,àl’intérieurdelaquellesesactionsbénéficientdelaconfiancedes
agentsprivés,quelquesoitl’objectifquilesmotive.L’annonce,c’est‐à‐direlefameuxancrage
nominal,n’estpasnécessaire.Undegrésatisfaisantdestabilitédesprixs’observesuruncycle
entiersilesagentséconomiquesnemanifestentaucuncomportementdeprotectioncontre
l’inflation,sansqu’ilyaitbesoind’annonceruneciblequantifiée.
Cecadrepermetunediversitéconsidérabledespolitiquesmonétairesdanslapratique.La
préoccupationdeGreenspanpourle«riskmanagement»,devenuecélèbre,louéepuisdécriée,
s’yestglisséesansdifficulté.CarGreenspanétaitconvaincuquelapolitiquemonétairepeutavoir
deseffetsréelsdurables,parcequel’économieestconstammentsoumiseàdeschangements
structurels,dontladétectionestincertainedesortequelesanticipationsd’inflationnes’ajustent
quelentementàlaperceptiondeceschangements.Parmiceschangementsilyalesinnovations
quin’ontévidemmentpasdeprécédenthistoriquepouryappliquerdesmodèlesstandardde
valorisation.Lesmarchésfinancierssontsaisisparune«exubéranceirrationnelle»contrelaquelle
ilestbiendifficiledelutter.
Cetteincertitudeestaussil’environnementdelabanquecentrale.Labanquecentraledoitdonc
gérerlerisquemacroéconomiqueenenvisageantunspectredescénarios.Aprèsavoirexaminéla
balancedesrisques,ilfautchoisirunepolitiquequidonneuneassurancecontredesévénementsà
probabilitébasse,lorsqueleurréalisationestsusceptibledeprovoquerdesperteséconomiques
sévères.
Cetteattitudeconduitàprendreencomptelastabilitéfinancièredanslesobjectifsdelapolitique
monétaire7.Pourtant,aprèsavoirdénoncél’exubéranceirrationnelle,Greenspans’estconvertià
l’optimismeambiantselonlequellesinnovationsfinancièresrendaientlesmarchésplusefficients
etpluscomplets.Commelesautresbanquierscentraux,ilestdemeuréinsensibleàtoutesles
alertes,notammentlesmisesengardedelaBRI8,quipointaientlafragilitécroissantedesbilans
desintermédiairesfinanciers:rythmed’expansionducréditdivergeantdeceluidelacroissance
économique,augmentationsuspectedulevierd’endettementdesintermédiairesfinanciersde
marché,écrasementdesspreadsdecrédit,spéculationàsensuniquesurlesprixdesactifs
5GOODHARTC.,1993,Lapolitiquemonétairedanslesannées1990:objectifsetmoyensd’action,BanquedeFrance,
CahiersEconomiquesetMonétaires,n°41,p.5‐20.
6BERNANKEB.etMISHKINF.,1997,Inflationtargeting:anewframeworkformonetarypolicy,JournalofEconomic
Perspectives,vol.11,n°2,p.97‐116.
7GreenspanAlan(2004),Riskanduncertaintyinmonetarypolicy,AmericanEconomicReview94,MayPP.33‐40.
8BorioC.,FurfineC.andLoweP.,2001,Procyclicalityofthefinancialsystemandfinancialstability:issuesandpolicy
options,BISPapers,n°1,Marspp.1‐57..

– 198 –
emportésparun«momentum»9.Finalementle«riskmanagement»aprisl’allured’uneaction
énergiqueetàsensuniquedeprêteurendernierressortpouréviterlesrépercussionsrécessives
delachutedesprixdesactifssurl’ensembledel’économie.AlanGreenspanagénéralisélerôledu
prêteurendernierressort,dusoutiendelaliquiditébancaireàceluiduprixdesactifs.Parsa
conceptionasymétriquedu«riskmanagement»,ilaprocuréuneassurancegratuiteàl’ensemble
dusystèmefinancier,unesortede«put»généralisédontlaprimeétaitnulle,sourceinépuisable
d’aléamoral.Aprèslui,l’ensembledesgrandesbanquescentralesoccidentalesontprolongéla
mêmepolitiqueàuneéchelleinconnuedansletempsetdansl’espaceàpartirdudéclenchement
delacrisefinancièreenaoût2007.C’estbienpourquoilapriseencomptedelastabilitéfinancière
danslapolitiquemonétaireestàrepenserentièrement.Pourlefaire,ilfautd’abordrésumerles
transformationsdelafinancequiontgrandementfragilisélesbilansdesintermédiaireshorsde
toutcontrôleprudentieletquiontcréédenouveauxcanauxdurisquesystémique.
2.L’instabilitéfinancière:unepréoccupationinévitable
DanslesdernièresannéesduXXièmesiècle,lafinanceaassimiléuneinnovationradicalequia
combinétroisingrédientspermettantdedissocierlerisquedecrédit,del’évaluerselonune
méthodestatistiqueetdeletransférer.Cesontlesdérivésdecrédit(creditdefaultswapsouCDS),
lesmodèlesdevalue‐at‐risketlacomptabilitéenvaleurdemarché.Cetteinnovationadonnéun
essorextraordinaireàlatitrisationdescréditssousl’égidedesbanquesd’investissement.Un
énormeélargissementdelagammedesactifsfinanciersdemarchés’estainsiouvert,n’importe
queltypedecréditpouvantdésormaisêtretitrisé.Ilaétépostulésansexamenpartousles
régulateursfinanciersetparlesbanquescentralesquecesvéhiculesrendaientlesmarchésplus
completsetdisséminaientlesrisques,conduisantainsiàunefinanceplusrobusteenmêmetemps
queplusefficiente10.Lesbanquescentralessesentaientconfortéesdansleurdoctrineden’avoirà
s’occuperquedel’inflation.
Orlastabilitédel’inflationestpropiceàl’instabilitéfinancière.Lastabilitédesprix,coupléeàla
libéralisationfinancière,entraîneunbascoûtducréditquifavoriseunboomdelaconsommation
etdesprixdesactifs.Lacrédibilitéacquiseparlapolitiquemonétaire,dufaitdelacroyancedans
lediscoursmonétariste,mêmelorsqu’ellen’estpourriendanslesraisonsquimaintiennentune
inflationbasse,influencelesanticipationsd’inflationquideviennentpeusensiblesauxfluctuations
cycliquesdelademande.Unedesgrandescaractéristiquesdurégimedesprixissudela
globalisationestquelesvariationsdel’inflationsont,nonseulementd’ampleurréduite,mais
retardéesdanslecycledesaffaires.Seulesleshaussesentretenuesdematièrespremières,donc
unemodificationdesprixrelatifs,peutentraînerunrelèvementlimitédutauxd’inflation.Hormis
cettecirconstance,vis‐à‐visdelaquelleellesnepeuventpasgrand‐chosepuisqu’ilnes’agitpas
d’uneinflationd’originemonétaire,lesbanquescentralesn’ontpasderaisondedurcirlapolitique
monétairesileurobjectifépouselarègledeTaylor:maîtriserl’inflationtoutenfacilitantla
croissanceauvoisinagedupotentiel.
9Dansleurarticle“ReturnstoBuyingWinnersandSellingLosers:ImplicationforStockMarketEfficiency”publiéen
1993dansleJournalofFinance(vol.48,pp.699‐720),N.JegadeeshetS.Titmanmontraientqueleslestitresqui
s’étaientappréciésaucoursdes3à12derniersmoisavaientdeforteschancesd’êtredestitresgagnantslorsdes3à
12mois,etquesymétriquementlestitresenbaisseaucoursdelapériodedetempsavaientdeforteschancesd’être
perdantsdansles3à12moissuivants.Lemomentumdésigneainsiunepoursuitedetendanceanticipéeparles
investisseurs:cesderniersachètentlestitresdontilsanticipentquelahaussevasepoursuivreetvendentceuxdont
ilsanticipentlapoursuitedelabaisse.
10FryeJ.(2003),«Afalsesenseofsecurity»,RISKmagazine,August,p63‐67

– 199 –
Danscesconditions,l’aversionpourlerisquedanslesmarchésducréditbaisseàlafoischezles
demandeursetlesoffreursdecrédit.Lesmarchésducréditdeviennentfragilesdansla
méconnaissancedesacteursquipensent,aucontraire,quelerisqueestminimalpuisqueles
profitssonthauts,l’inflationbasseetlecoûtducréditbonmarché.Cequ’ilfautcomprendre,c’est
pourquoilesmarchésducréditsontincapablesdes’ajusterauxdistorsionslatentesquimûrissent
dansl’indifférencegénéraledesindicateursobjectifsdeladétériorationdesbilans,oùlepoidsdes
dettesmonteinexorablement.
Rappelonsquelatitrisationpermetdeconvertirlescréditsenactifsquisontacquispardes
investisseursdansunelogiquedeportefeuillesansaucuneconnexionaveclesemprunteurs.Cela
permetauxoffreursdecréditdenepassepréoccuperdurisquedesemprunteurspuisqu’ilssont
rémunérésauvolumeparlescommissionsdelareventedescréditsauxbanquesd’investissement
quiconstituentlespoolsàtitriser.Deleurcôté,enaccordaveclesagencesdenotation,ces
banquesconsidèrentquelerisquedupoolesttrèsfaibleparrapportàceluidescrédits
constituants.Mêmesiellesconserventunmontantdetitresémisdanslestranchessubordonnées,
ellessontprotégées,pensent‐elles,parlavaleurducollatéral.
Danscesconditionslesdéterminantsdel’offredecréditn’ontplusgrand‐choseàvoiravecceux
descréditsindividuelsquedesbanquesfontàdesemprunteurspourfinancerleuractivitéetqu’ils
portentjusqu’àl’échéance.Danscecas,l’évaluationindividuelledurisquedecrédit,c’est‐à‐direle
fluxactualisédesrevenusfutursdel’emprunteur,déterminelaqualitéducrédit.Lecréditcontre
collatéral,aucontraire,dépenddel’anticipationduprixd’unactif,doncdel’anticipationdes
autresoffreursdecréditquivontcollectivementpousserleprixàlahausse.C’estunprocessus
auto‐référentiel.
L’offreetlademandedecréditsontdoncétroitementcorréléespositivement,puisqu’elles
dépendenttoutesdeuxd’unmêmedéterminant:l’anticipationdelahausseduprixdesactifs
financésparlecrédit.L’expansionducréditvalidelahausseduprixdesactifs.Celle‐cientraîne
l’économiedansuncercleoùtouteslesinteractionsserenforcent.Ledéplacementversladroite
delafonctiondedemandedecréditserépercutesurl’offredanslemêmesens.L’offredecrédit
progressantenétroitecorrélationaveclademande,letauxd’intérêtrestestable;cequiempêche
l’ajustementparlecoûtducrédit.L’offreetlademandedecréditnecessentdesedéplacerversla
droiteetdevaliderl’anticipationdelahausseduprixdesactifs.Cecercleauneapparence
vertueuse,maisildevientsubrepticementvicieuxaufuretàmesurequelabullespéculativese
renforceetquelafragilités’insinuedanslesbilansdesemprunteurs.Ledérapagen’apasde
contrepoidsendogènesdanlaphaseeuphoriqueducyclefinancierpuisquetousles
enchaînementsdynamiquesserenforcentmutuellement.
Laphased’essorengendredoncdescomportementsquifragilisentlesystèmefinancier.La
détériorationdesconditionsducréditestdissimuléeauxacteursparl’euphoriedesmarchés
d’actifsdufaitdesonexpansion.Lafragilités’insinueparcequelesemprunteurs,quiperçoivent
desopportunitésdegainsencapitalsurlesactifs,toutensous‐estimantlesrisques,recourentau
levierdel’endettementpourmaximiserleursgains.Ils’ensuitquelamargedesécuritédes
emprunteursencasderetournementbrutaldesprixd’actifs,oudereversdansl’évolutionde
leurspropresrevenus,s’amenuiseaupointdedisparaître11.Deleurcôté,lesprêteurssont
aisémentmystifiésparlasoliditéapparented’uneconventionhaussièredanslesmarchésd’actifs,
lorsqueceux‐cisontdansunephasedehaussesenchaînedesprix.Ilspensentquelavaleurdes
actifsquiconstituentlecollatéraldeleursprêtsvas’apprécieretgarantirleurscréances.Ilssont
11KregelJ.(2008),Minsky’scushionsofsafety,PublicPolicyBrief,n°93,LevyEconomicsInstituteofBardCollege.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%