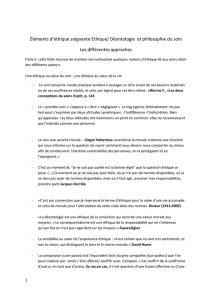Synthèse de la conférence de Claude De Jonckheere

Synthèse de la conférence
ETHIQUE ET ACTIVITÉ DANS LE TRAVAIL SOCIAL
présentée dans le cadre d'une journée de travail d'AvenirSocial
(10.11.2006)
Claude de Jonckheere
Introduction
La question traitée dans ce texte est de savoir si nous pouvons développer une
conception non normative de l’éthique énonçant des « règles d’actions
obligatoires » et si elle peut représenter un apport intéressant pour les diverses
pratiques de travail social. Pour traiter ces questions, nous tenterons de
comprendre quelle est la conception de l’éthique que l’on peut qualifier de
normative et pour quelles raisons il importe de la renouveler. La philosophie de
Spinoza nous permettra d’esquisser ce que peut être une éthique non normative
ou éthique de l’immanence.
Une éthiqu e normati ve
Beaucoup de questions posées aux travailleurs sociaux par les situations dans
lesquelles ils sont impliqués sont d’ordre éthique. Ce sont des questions
concernant ce qu’ils appellent eux- mêmes « le sens » de leurs interventions
envers autrui. Dans les professions de l’aide, l’éthique prend des acceptions larges
et variées. Mais, le plus souvent, elle est conçue comme une morale proposant à
l’agent des normes d’action. L’éthique est alors ramenée à l’énoncé de principes
ou de maximes que le sujet doté, comme chez Kant, d’une volonté bonne, met en
acte. Elle est censée donner des devoirs permettant de mener une vie méritante et
vertueuse en regard de valeurs transcendantes.
L’éthique normative et, par extension la morale, sont fondées sur une liberté
abstraite qui voudrait que nos actes soient pleinement désintéressés et
uniquement déterminés par un sujet autonome, c’est- à- dire imperméable à ce qui
provient du monde extérieur et doté d’une « volonté bonne ». L’une et l’autre
énoncent des principes, ce que Kant appelle des « maximes », et présupposent
que nos actes pourront les suivre. L’impossibilité dans laquelle les humains se
trouvent souvent à les mettre en application ne remet pas en question les
principes eux- mêmes, mais est comprise comme l’expression de la faiblesse de la
nature humaine. Dès lors, l’éthique normative peut être comprise comme
proposant un idéal, par nature inaccessible, mais servant en quelque sorte de
point de fuite qu’il s’agit de viser tout en sachant qu’il ne pourra jamais être
atteint à moins d’accéder à une forme de sainteté. Le problème est que
l’impossibilité de suivre les normes éthiques ou les maximes morales ne peut que
conduire les humains se définissant en tant que sujets moraux à développer des
sentiments d’impuissance et de culpabilité.

É TH I Q U E ET A C T I V I TÉ D A NS LE T R A V A IL SOC I A L
Une éthiqu e de l’immanen ce
Si l’on ne veut pas réduire l’éthique à la volonté des sujets de mettre en
pratique des normes renvoyant à un humain idéal, il est nécessaire de poser le
problème en d’autres termes. De même, si l’on se refuse à entrer dans un
relativisme absolu dans lequel tout est possible et tout est permis, il importe de
se donner des repères. Pour mener ces tâches, Deleuze (1981) à la suite de
Spinoza, propose de concevoir l’éthique comme une véritable anthropologie, voire
une éthologie s’intéressant aux actions des humains dans les conditions où elles
s’effectuent. L’éthique s’intéressant aux humains tels qu’ils vivent et à leurs
actions situées dans un milieu social et culturel doit alors permettre de décrire les
problèmes qu’ils rencontrent et de leur apporter des solutions. Se situant sur le
plan de la vie, sans qualifier a priori la qualité de cette vie, elle peut être appelée
une « éthique de l’immanence ».
La tâche de l’éthique de l’immanence consiste à décrire la manière dont les
humains vivent et à poser les questions qui se posent à eux par le simple fait de
vivre. Cependant, pour pouvoir traiter les questions de l’existence, nous devons
transformer ces questions en problèmes sur lesquels il est possible d’opérer. Le
passage de la question au problème requiert des concepts, c’est- à- dire des points
de vue à partir desquels il est possible d’organiser les événements de l’existence
afin de pouvoir les penser et, si cela s’avère nécessaire, intervenir. Dès lors,
l’éthique prend la forme d’une « pratique de mise en problèmes ».
D’un point de vue spinoziste, l’humain est dépendant du monde dans lequel il
habite et la volonté, pour autant que l’on veuille garder ce terme, est sous
influence. Il est donc nécessaire de décrire ces influences ou, en d’autres termes,
la manière dont le monde extérieur s’active à l’intérieur de l’individu. Les
concepts « affection » et « affect » proposés par Spinoza permettent de rendre
compte de ces influences et de développer une éthique qui répond bien à la
définition d’une anthropologie.
Chez Spinoza, le vivant est défini comme un « mode ». Un mode est un
ensemble de rapports entre divers éléments et en ensemble de mouvements qui
animent les éléments et les rapports. Ces modes, c’est- à- dire les rapports et les
mouvements sont susceptibles d’être modifiés sous l’effet de forces provenant de
l’extérieur. Ces modifications sont ce que Spinoza appelle les « affections ». En
fait, les affections sont ce qui arrive au « mode ». Mais les modes sont aussi
capables de modifier, c’est- à- dire d’affecter d’autres modes. Dès lors, les modes
ont un caractère passif, car ils peuvent être affectés par d’autres modes et un
caractère actifs, car ils peuvent affecter d’autres modes. Comme le dit Deleuze, le
mode est « un rapport complexe de vitesse et de lenteur, dans le corps, mais aussi
dans la pensée, et c’est un pouvoir d’affecter et d’être affecté, du corps ou de la
pensée » (1981, p. 166). Il importe de préciser que Spinoza réfute toute distinction
du corps et de l’esprit. Ainsi, le mode définit les rapports et les mouvements dans
le corps et dans l’esprit et dans l’être considéré comme totalité corps et esprit.
Le mode s’oppose à la nature ou à l’essence des êtres. Il est, non une chose en
soi, mais l’ensemble des rapports qui caractérisent un être. Il n’est pas un corps
ou un esprit, mais des rapports entre le corps et l’esprit, dans le corps et l’esprit
et entre le corps et l’esprit et le monde naturel et social. Le mode étant défini
comme des rapports, l’affection est alors ce qui arrive à ces rapports. Si l’affection
est l’effet d’un mode sur un autre mode qui détermine un état dans ce dernier,
l’affect désigne le passage de l’être d’un état à un autre sous l’effet de l’affection.
Ce passage est indiqué par des signes vectoriels ou par des mouvements de
26 / 1 1 / 2 0 0 6 2

É TH I Q U E ET A C T I V I TÉ D A NS LE T R A V A IL SOC I A L
croissance ou de décroissance, des montées ou des chutes, des augmentations ou
des diminutions.
Spinoza franchit un pas supplémentaire et précise que les affections des
modes sont de deux types : la composition et la décomposition. Un mode existant,
défini par son pouvoir d’être affecté, rencontre un autre mode. Lors de cette
rencontre, il peut arriver que cet autre mode se compose avec lui ou, au contraire,
qu’il se décompose. En cas de composition, le mode existant passe à une
perfection plus grande, sa puissance d’agir ou sa force d’exister augmente. En cas
de décomposition, sa perfection ou sa puissance d’agir diminue. Lorsqu’il y a
augmentation de la force d’exister, le mode existant, en tout cas s’il s’agit d’un
être humain, éprouvera de la joie, il ressentira de la tristesse lorsqu’il y a
diminution de cette puissance. Joie et tristesse sont donc, non des états, mais des
passages d’un état à un autre, c’est- à- dire ce que Spinoza appelle des affects.
L’état actuel de notre corps n’est pas séparable de l’état précédent dans lequel il
était, c’est pourquoi « à toute idée qui indique un état de notre corps est
nécessairement liée une autre espèce d’idée qui enveloppe le rapport de cet état
avec l’état passé » (Deleuze, 1968, p. 200). Les affects, joie et tristesse, sont donc
variations des états du corps et les idées de ces variations.
Tant bien même que le résultat en soit la joie, Spinoza ne se satisfait pas de
cette augmentation de la puissance d’agir. Cet accroissement, en effet, est la
marque même de notre impuissance, car il dépend de la puissance d’un corps
extérieur. Nous éprouvons certes de la joie, mais une joie- passion et cela tant que
« la puissance d’agir de l’homme n’est pas augmentée jusqu’au point qu’il se
conçoive lui- même et ses actions de façon adéquate » (Spinoza, E, IV, 59, dém.).
Pour Spinoza, se concevoir soi- même et concevoir ses actions de façon adéquate
consiste à rejeter les illusions que nous pouvons avoir à propos de notre libre
arbitre, des causes qui produisent nos actions ou de la destinée qui les animerait.
La connaissance adéquate est celle qui nous met en contact avec nos expériences.
La joie- passion est nécessaire dans le sens ou elle détermine notre
« conatus », on pourrait dire notre appétit ou notre puissance désirante. Elle nous
pousse à désirer, « à imaginer et à faire quelque chose qui découle de notre
nature » (Deleuze, 1968, p. 219). La joie passive, bien que dépendant d’autrui ou
de l’environnement, détermine néanmoins notre désir à désirer ce qui est utile ou
bon pour nous. Elle reste une passion, mais elle enveloppe au plus haut degré
notre puissance d’agir. Le désir qui caractérise l’existence et que l’on peut définir
comme la tendance ou l’effort pour la préserver est aidé ou augmenté par la joie.
Si, dans la rencontre avec un autre corps, un autre esprit, les rapports ne se
composent pas, alors se produit une affection passive dont le signe perceptible
est un sentiment de tristesse. Cette tristesse- passion diminue la puissance d’agir
et le sentiment de tristesse est la seule manière permettant de savoir que l’autre
corps ne convient pas à notre nature.
La complexité des rapports que nous entretenons avec d’autres corps a pour
effet que les affections joyeuses et tristes interfèrent constamment. Un même
corps, un même objet ou un même être humain, peut toujours être cause de joie
ou de tristesse et en vertu de la complexité des rapports qui nous composent
intrinsèquement nous pouvons aimer et haïr à la fois un objet ou un être. La
complexité des rapports, les idées que nous formons à propos de ces rapports,
peuvent aussi nous amener à nous réjouir d’avoir détruit ce que nous haïssons.
« Celui qui imagine ce qu’il a en haine comme affecté de tristesse se réjouira », dit
Spinoza (E, III, 23, prop.).
26 / 1 1 / 2 0 0 6 3

É TH I Q U E ET A C T I V I TÉ D A NS LE T R A V A IL SOC I A L
Les concepts « affection » et « affect » permettent de comprendre ce qui arrive
dans l’immanence de la rencontre avec autrui ou plus généralement avec le
monde naturel et social dans lequel nous vivons. En ce sens, ils fournissent une
description sans que rien de l’expérience ne soit exclu au nom de valeurs ou de
principes. Par exemple, des mouvements comme la haine, le dégoût de l’autre,
l’absence de compassion, la cupidité qui seraient bannis ou jugés comme étant
répréhensibles dans une éthique normative sont nécessairement présentés et pris
en compte dans une éthique de l’immanence. Les concepts spinoziens obligent,
non à juger, par exemple, la haine en référence à une valeur comme le bien ou le
mal, mais à examiner les passions tristes qu’elle produit, tant chez la personne
haineuse, que chez la personne haïe.
Les propositions de Spinoza ne sont pas si éloignées de celles que Foucault
exprime avec le concept de « souci de soi » (1984). Le souci de soi, qui est la
création de rapports humains avec soi- même est, dit Deleuze, une « politique du
moi » (1988, p. 10). Il est politique, acte de citoyenneté, car il instaure l’acte de
s’affecter soi- même comme « contre- capture » (Jonckheere de, 2001) s’opposant
à la capture de soi par les autres. Il est une forme de lutte contre toutes les
dénominations de notre être par autrui et contre la réduction de notre être à des
catégories préétablies. Une politique du moi s’instaure lorsque l’individu
rencontre ses propres conditions d’existence et sa propre puissance. Le souci de
soi comme éthique, revêtu de ce nouveau sens de politique du moi, décrit ce qui
arrive dans l’acte risqué au cours duquel l’individu définit lui- même ce qu’il est et
ce qu’il veut.
Ethique et activité
Définir le travail social comme une activité impose de s’intéresser à
l’agencement de forces, ou au champ des contraintes, qui constitue la situation
dans laquelle l’agir s’active. Dès lors, la volonté est elle- même affectée par la
situation dans laquelle elle s’exprime et ne peut être comprise comme la cause
suffisante de l’action. L’activité peut donc être définie comme un ensemble
d’actions situées dans un environnement humain et non humain. Pour qu’un
ensemble d’actions puissent être considérée en tant qu’activité, il est nécessaire
qu’elles soient coordonnées et dirigées vers un but. La nécessité d’introduire une
coordination et une visée dans l’activité ne signifie pas qu’il soit nécessaire de
faire intervenir la volonté des agents. En effet, la coordination est une forme
d’autorégulation qui se créée au sein même de l’activité et dans laquelle
interviennent, certes les acteurs en présence, mais également les diverses règles
sociales et institutionnelles et des éléments non humain comme les lieux et les
objets en présence. De même, les visées de l’activité ne peuvent pas être rabattues
sur la volonté de l’agent, mais dépendent d’un collectif ou, plus largement d’une
société, qui institue plus ou moins formellement ces visées comme étant valides.
Ainsi, dans le travail social, les buts d’autonomisation, de responsabilisation, de
socialisation, d’intégration des bénéficiaires de l’action sociale ne tiennent pas à
un agent particulier et sont constitutifs de l’agir collectif et organisateurs des
institutions et des pratiques. En tant que tels, ils ne peuvent être remis en cause
sans conséquences sur l’ « identité » professionnelle des agents.
Dans l’analyse de l’activité, la distinction opérée entre l’activité prescrite et
l’activité réalisée implique que tant les diverses règles qui tendent à produire une
coordination de l’activité que les visées elles- mêmes ne sont pas nécessairement
réalisées dans les diverses actions qui constituent l’activité. Dans la perspective
26 / 1 1 / 2 0 0 6 4

É TH I Q U E ET A C T I V I TÉ D A NS LE T R A V A IL SOC I A L
adoptée, le décalage entre prescription et réalisation n’est pas compris comme le
signe d’un quelconque échec ou de l’impuissance des agents, mais bien en tant
qu’élément constitutif de l’agir. C’est bien parce que les agents ne font pas
exactement ce qu’on leur demande de faire ou ce qu’ils ont prévus eux- mêmes de
faire qu’ils peuvent effectivement agir et faire preuve de créativité pour
« vaincre » ou « contourner » la résistance du réel. Ainsi, dans l’activité, la
coordination et les buts sont sans cesse en cours de création afin que la tâche
puisse se réaliser au mieux.
Les règle s et les maxime s morales sont - elle prescripti ves ?
Les règles morales sont une réponse à la question « que dois- je faire ? ». En
tant que réponse à une telle question, elles concernent l’agir. Cependant, la règle
morale ne prescrit pas strictement une tâche singulière comme le fait une
prescription dans un cadre de travail, mais elle prescrit plus largement ce qu’il
convient de faire pour mener une vie digne.
Les règles morales se présentent sous la forme de principes d’action que la
volonté autonome met en œuvre. La morale a ainsi pour tâche d’indiquer le
contenu de ce que l’on devrait faire sans se soucier du fait que, ce qu’il paraît à
notre raison bon ou juste de faire, n’est pas toujours, ou même pas souvent, ce
que nous faisons effectivement. Dans le domaine du travail social, l’éthique
normative ou, comme le dit Taylor, l’« éthique de l’action obligatoire » (1998, p.
113) fondée sur l’autonomie de la raison et la maîtrise de l’agir ne tient pas
compte des contradictions irréductibles dans lesquelles s’exerce l’activité d’aide
psychosociale. En effet, des contraintes parfois antinomiques affectent les
pratiques en mettent les agents dans des dilemmes parfois insolubles. Par
exemple, le travail social que est traditionnellement une pratique d’accueil de
l’altérité d’autrui est aussi, en même temps, une forme d’intervention relevant des
technologies de contrôle et de normalisation des vivants, de ce que Foucault
appelle la « biopolitique » (Foucault, 2004).
Les codes de déontologie qui sont censé régir l’agir des travailleurs sociaux
contiennent des règles que l’on pourrait qualifier de morales car ils renvoient à
une idée de ce qu’est la vie digne. Ces règles sont situées dans une société, dans
une profession et dans des institutions. Elles expriment les valeurs dominantes
d’un groupe humain dans une période donnée. L’idéal de l’humain et de l’action
que l’on trouve dans la morale est, dès lors, rabattu sur la réalité d’une société. Un
code de déontologie, même s’il se réfère à un idéal de l’humain et à un idéal de
l’action est, encore plus nettement qu’une règle morale, le résultat d’une
délibération entre des acteurs représentatifs d’une profession. Il exprime ce qui
paraît acceptable pour les praticiens d’une profession et ce qui est communicable
au monde social qui constitue l’environnement de cette profession.
Dans le travail social, comme dans toutes les professions dans lesquelles il
s’agit d’agir envers autrui, et pour autant que nous acceptions de nous y arrêter,
l’humain, tant dans la personne du travailleur social, que dans celle du client,
n’est pas cet humain idéal, rationnel, autonome, contrôlant ses passions, bon
envers les autres visé par une éthique normative. Nous avons affaire, en nous-
mêmes comme en autrui, à un humain que les idéaux d’une éthique normative
nous obligerait à considérer comme faible, impuissant, incohérent, en en mot,
incapable de suivre les règles qu’il s’est prétendument donné à lui- même. Le
concept d’ « activité située » nous impose de reconsidérer l’humain idéal et
l’action idéale afin de « faire exister » un humain réel et des actions réelles.
26 / 1 1 / 2 0 0 6 5
 6
6
 7
7
1
/
7
100%