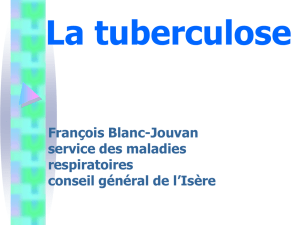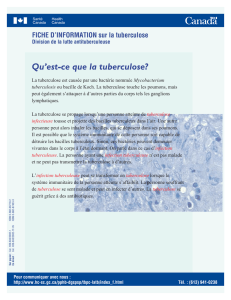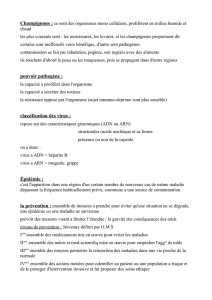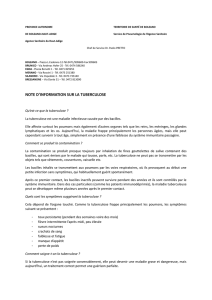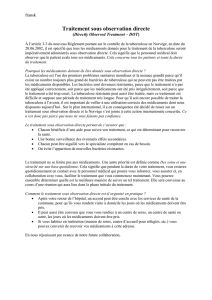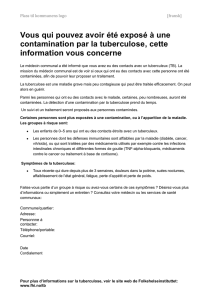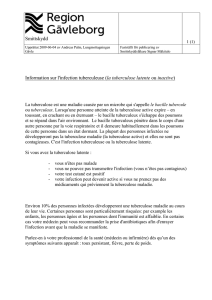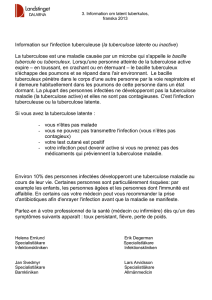Histoire Naturelle et Evolution - Bienvenue sur Mon Site à Moi

Tuberculose pulmonaire et Pr Marquette et Pr Lafitte
primo-infection tuberculeuse
PLAN
Epidémiologie p 2
Histoire Naturelle et Evolution p 4
Intradermo réaction (IDR) à la tuberculine p 6
Presentation(s) clinique(s) de la tuberculose pulmonaire p 9
Diagnostic de la tuberculose pulmonaire p 12
Traitement de la tuberculose p 14
Prévention de la tuberculose p 20
Texte sur fond grisé ⇒ « les bases à connaître »
Texte sur fond blanc ⇒ « en savoir plus »
PRINCIPALES SOURCES DE DOCUMENTATION
• Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue Française sur la prise en charge de la tuberculose en France.
Conférence d’experts – texte court (Rev Mal Respir 2004 ; 21 : 414-20) et texte long (Rev Mal Respir 2004 ; 21 : 3S2) sont
accessibles sur le site de la SPLF : www.splf.org/bbo/revues-articles/RMR/accesLibre/RMR2004_21_414RecosTub.pdf
• Les infections à mycobactéries tuberculeuses et non tuberculeuses. Revue des Maladies Respiratoires, vol 14 Décembre
1997. N° spécial
• WHO Report 2002. Global Tuberculosis Control (http://www.who.int/gtb/publications)
• Tuberculose. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. N° spécial. Décembre 1994
• Institut National de Veille Sanitaire. Epidémiologie des maladies infectieuses en France. Maladies surveillées par le
Réseau National de Santé Publique. Situation en 1996 et tendances évolutives récentes
(http://www.invs.sante.fr/beh/default.htm)
• Diagnostic Standards and Classification of Tuberculosis in Adults and Children. American Thoracic Society. Am J Respir
Crit Care Med 2000; 161: 1376-l395
• Treatment of Tuberculosis and Tuberculosis Infection in Adults and Children. American Thoracic Society. Am J Respir Crit
Care Med 1994; 149: 1359-1374
• A. Infuso, D. Antoine et P. Barboza, EuroTB, pour les correspondants nationaux des pays de la région Europe de l'OMS
participant au projet EuroTB. Surveillance européenne de la tuberculose en 1999 et tendances récentes. BEH 2002 ;16-
17 :66-67
• Corbet E. et al. The Growing Burden of Tuberculosis. Arch Intern Med. 2003;163:1009-1021
Les documents suivants sont téléchargeables en ligne sur le site du ministère de la santé l’adresse suivante :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/tuberculose/sommaire.htm
- Prévention et prise ne charge de la tuberculose en France. Synthèse et recommandations du groupe de travail du Conseil
Supérieur d’Hygiène Publique de France (2002-2003). Rev Mal Respir 2003 ; 20 : 7S3-7S4
- Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France relatif à la revaccination par le BCG
- Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France Section maladies transmissibles relatif au traitement de la
Tuberculose-infection
- Avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France relatif au choix d'un masque de protection contre la tuberculose
en milieu de soins

Année Universitaire 2006-2007 Tuberculose –Pr Marquette et Pr Lafitte
I EPIDEMIOLOGIE
I-1 HISTORIQUE :
La tuberculose existe au moins depuis 120 siècles ; elle était reconnue par les médecines grecque, chinoise,
égyptienne et indienne. Dans la ville d'Alexandrie on savait que les migrants étaient des personnes souvent
malades. On a retrouvé sur des momies des séquelles de mal de Pott. Hippocrate décrit des tubercules, des
ulcérations et des pleurésies ainsi que les premiers « traitements ».
Les idées se développent vers le 18ème siècle. Il persiste une confusion nosologique mais on connaît déjà l'intérêt
d’éloigner les patients des villes vers la campagne
Au 19ème siècle les connaissances sur la tuberculose évoluent grâce à Laennec, Villemin, Koch, Röentgen,
Béclère, Landouzy, Calmette, Guérrin, Vaskman, à qui on doit les descriptions anatomo-cliniques, la découverte
de la contagion inter humaine, la découverte du germe, la découverte des Rayons X, les descriptions cliniques, le
vaccin BCG et la Streptomycine
A partir du début du siècle avec l'apparition de l'hygiène dans les pays industrialisé, on voit décroître le nombre
de tuberculose. Cette décroissance s'accélère avec l'apparition de la streptomycine et des antituberculeux
laissant croire à la fin de l'endémie tuberculeuse pour les années 1980
En 1863, Graves décrit en Angleterre 60000 DC/an. La ville de Lille dénombrait plus de 1000 DC par an en 1945.
En 1992 il n'est déclaré dans la région Nord pas de Calais que 1,7cas de décès par tuberculose pour 100000
habitants.
I-2 HISTOIRE NATURELLE: la transmission se fait à partir d'une personne présentant une tuberculose pulmonaire
bacillifère (contagieuse). L'homme est le réservoir naturel du germe) La transmission inter-espèce est
exceptionnelle. L’infection de la personne en contact réalise la primo infection tuberculeuse ; il apparaît une
certaine immunité qui permet à la personne de ne pas développer la maladie ; il s'ensuit une phase de latence,
puis une phase de maladie avec réactivation des germes ou ré-infection exogène; la personne développe la
maladie et devient éventuellement bacillifère. L'évolution spontanée se fait vers le décès dans (≈ 50%des cas), la
guérison spontanée (≈ 30%) ou la chronicité (≈ 20%).
Une personne à frottis positif infecte 10 personnes par an pendant une moyenne de 3 ans (durée de l'évolution
spontanée). Durant sa vie de contagieux, le tuberculeux infecte 30 personnes, dont 1 deviendra elle aussi
contagieuse.
Il y a rupture de cet « équilibre » :
1. dans un sens favorable à l'espèce humaine : avec l'apparition de l'hygiène et les traitements antituberculeux
à partir de 1945 et, dans les pays industrialisé, le traitement rapide des patients contagieux
2. dans un sens défavorable à l'espèce humaine avec l' apparition du VIH, la difficultés d’accès aux soins de
populations marginalisées, l'accroissement des migrations....
I-3 INCIDENCE DE LA TUBERCULOSE:
La tuberculose est la 5ème cause de décès par maladie. L’incidence de la maladie varie de moins de 10/100 000
(amérique du nord) à plus de 300/100 000 (Afrique sub-saharienne). Elle croît avec le niveau de pauvreté et
l’incidence de l’infection par le VIH.
2

Année Universitaire 2006-2007 Tuberculose –Pr Marquette et Pr Lafitte
Evolution de l’incidence de la tuberculose en France
En Europe sur la période 1995 - 1999,
l’incidence est < 20 cas pour 100 000
habitants. Ces taux sont stables ou en
diminution dans la plupart des pays
d'Europe de l'Ouest. En Europe centrale,
les taux de déclaration se situent entre
20 et 40 cas pour 100 000 ; ils sont en
diminution dans tous les pays à
l'exception de la Roumanie (120) et de
la Bosnie Herzegovine. Dans les pays
de l'ex-URSS, les taux de déclaration
sont supérieurs à 50 cas pour 100 000,
en augmentation très nette (+50% en 5
ans). Les données représentatives sur
les antibiogrammes en début de
traitement montrent un niveau de
multirésistance primaire inférieur à 1%
en Europe de l'Ouest et du Centre (18
pays) et très élevé dans les pays Baltes
(8-17%).
L'incidence de la tuberculose en France
était de 11,2 cas pour 100 000 habitants
en 2000 et ne diminue plus depuis 1997.
La situation épidémiologique de la
tuberculose est principalement
inquiétante en Ile-de-France où
l'incidence est plus du double de
l'incidence nationale. Elle atteint 50 cas
pour 100 000 dans la ville de Paris.
La part du VIH est de moins en moins
importante. Les personnes en
provenance d'un pays d'endémie
tuberculeuse ont un risque multiplié par
8 par rapport aux nationaux et plus
particulièrement les adultes jeunes. Les
situations de précarité économique et
sociale contribuent également à cette
situation.
Incidence de la tuberculose en France selon l’age et la nationalité
I-4 DISTRIBUTION EN FONCTION DE L'AGE
Dans les pays industrialisé : la tranche d'age des personnes malades est de plus de 55 ans car ce sont des
personnes qui ont pu être infectés lors de la période d'endémie de ces pays (une part non négligeable des ces
tuberculoses-maladie actuellement diagnostiquées sont des réactivations de tuberculoses-infection) et les jeunes
actuellement ont moins de risque d'être infectés compte tenu de la faible incidence de la maladie
Dans les pays en développement : il existe une prédilection pour les personnes jeunes , en pleine période
d'activité sociale entraînant des perturbations sociales, d'autant que en général ces pays sont aussi touchés par
le VIH
I-5 INFECTION TUBERCULEUSE
L'OMS, en1990, a estime supérieur à 1,7 milliard le nombre de personne infectés soit le 1/3 de la population
mondiale (c'est à dire le nombre de personnes ayant fait une primo infection et qui sont asymptomatiques). Les
chiffres les plus élevés sont dans le pacifique ouest et les plus faibles dans la méditerranée orientale
La distribution selon l'age diffère selon les régions : en Afrique et en Europe où l’incidence est la même (30%),
80% des infectés ont moins de 50 ans en Afrique alors qu'en Europe la majorité des infectés a plus de 55 ans et
représente le reliquat d'une cohorte qui a été contaminée dans leur jeune âge, au moment où la tuberculose était
endémique en Europe.
Le risque annuel d'infection (RAI) est le taux qui donne la proportion de personnes qui au cours d'une année sont
infectées par le bacille tuberculeux ; il est évalué par un échantillon représentatif de la population, de même age,
non vacciné et pour lesquels sont effectués des test tuberculiniques : 1% de RAI correspond à 50 nouveaux cas
de tuberculose à frottis positif (estimations effectuées avant l'épidémie de VIH)
Chiffré, dans les pays industrialisés entre 5 et 10% entre 1920 et 1930, le RAI commence à baisser de 4 à 5%
par an avant 1945, en raison de l'amélioration des conditions de vie (pays occidentaux). Le niveaux le plus bas
est atteint aux Pays Bas, en Suisse, en Norvège et dans certaines province du canada: 0,01%; avec l'espoir à
l'époque d'atteindre une phase d'élimination (1/100000 frottis positif) et éliminée (1/1000000)
Dans les pays en voie de développement le RAI reste élevé (Afrique et Asie) supérieur à 2%
3

Année Universitaire 2006-2007 Tuberculose –Pr Marquette et Pr Lafitte
I-6 ROLE DU VIH
L' impact est double :
- direct avec un risque accru pour les séro-positifs de s'infecter
- indirect puisque les VIH infectés deviennent rapidement malades et représentent des sources
supplémentaires de contamination
Dans les pays en voie de développement où il existe une épidémie de VIH, un excès de tuberculose est noté ; il
est noté un doublement de l'incidence de tuberculose dans les pays où la prévalence des 2 infections est
importante
II HISTOIRE NATURELLE ET EVOLUTION
La tuberculose est le plus souvent due aux mycobactérie du complexe tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis
et beaucoup plus rarement à Mycobacterium Africanum ou Mycobacterium Bovis). L’agent de la tuberculose ou
bacille de Koch (BK) se transmet quasi exclusivement par voie aérienne. Les gouttelettes infectantes sont
produites sous forme d’aérosol par les patients contagieux lors de la toux, la parole ou les éternuements. Ces
gouttelettes (1 à 5 µ) restent en suspension dans l’air ambiant. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des particules
mises en suspension sont inactivées dès leur émission et seul une fraction de 1 % survit pendant quelques
heures. Les patients contagieux génèrent aussi des particules de plus grande taille, riches en BK, qui
n’interviennent pas dans la transmission car elles ne restent pas en suspension dans l’air, et même si inhalées,
n’atteignent pas l’espace alvéolaire. Les particules de plus de 5 µ sont arrêtées au niveau des voies aériennes
supérieures, de la trachée ou des bronches. Elle sont alors remontées (escalator mucociliaire) vers le pharynx où
elles sont dégluties puis inactivées dans le tube digestif.
C’est la déposition alvéolaire de quelques bacilles (1 à 3) et leur multiplication, qui va être à l’origine de la primo-
infection tuberculeuse (PIT).
II-1 PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE (PIT) ET TUBERCULOSE "MALADIE"
Les quelques bacilles infectants déposés au niveau des espaces alvéolaires distaux (foyer primaire, encore
appelé chancre d’inoculation, le plus souvent dans les zones pulmonaires moyennes ou inférieures qui sont les
plus ventilées) sont phagocytées par les macrophages alvéolaires (MA) au sein desquels ils peuvent se multiplier.
Les bacilles sont alors drainés par les MA vers le ganglion hilaire satellite du foyer primaire où ils continuent à se
multiplier. L’association foyer primaire et adénopathie (ADP)satellite (le plus souvent asymptomatique) est
appelée complexe primaire et peut être mise en évidence sur le cliché de thorax ou le scanner thoracique.
A partir du foyer ganglionnaire un certain nombre de bacilles peut disséminer dans la circulation à travers tout
l’organisme (foyers secondaires). Cette phase de bacillémie est le plus souvent asymptomatique.
Au cours des 2 à 10 semaines qui suivent cette infection initiale se développe une réponse immune à médiation
cellulaire accompagnée d’une hypersensibilité au dérivés du BK (se traduisant par la positivation de
l’intradermoréaction à la tuberculine). Cette réponse immune suffit en général à limiter la multiplication ultérieure
du BK et l’hôte infecté reste asymptomatique. Au niveau du foyer primaire et des éventuels foyers secondaires, la
réponse immune se traduit par l’accumulation de cellules monocytaires d’allure épithélioïde entourées d’une
couronne de lymphocytes. Au centre de ces lésion peut apparaître une nécrose à riche contenu lipidique
(nécrose caséeuse). Ces lésions histologiques, appelées granulomes ou follicules épithélio-giganto cellulaires
avec nécrose caséeuse sont quasi pathogneumoniques, en France en tous cas, de lésions tuberculeuses. Après
quelques mois (3 mois), si la réplication bacillaire est inhibée, les lésions peuvent se calcifier. Elles contiennent
alors un faible nombre (< 105) de bacilles dits "quiescents" en position intra-cellulaire ou au sein du caséum
solide. A n’importe quel moment de cette phase de primo-infection puis au delà de cette phase, les bacilles
"quiescents", présents au niveau partir d’un ou de foyer(s) secondaire(s) ou, plus rarement au niveau du foyer
primaire, peuvent se multiplier et être alors responsable d’une "tuberculose maladie" qui s’exprime alors
cliniquement et/ou radiologiquement. On estime qu’environ 5 % des patients développent une "tuberculose
maladie" dans l’année qui suit leur PIT et qu’environ encore 5 % des patients développent une "tuberculose
maladie" au delà de ce délai (le risque de passage de la tuberculose-infection à la tuberculose-maladie est plus
important chez l’enfant et varie en fonction de l’âge. Il est estimé à 43 % avant l’âge d’un an, 24 % entre 1 et 5
ans, 15 % entre 11 et 15 ans, alors qu’il est chez l’adulte de 5 à 10 %). Ces chiffres sont la base de la chimio-
prophylaxie proposée dans certains cas de PIT. Certaines situations facilitent le passage rapide à la tuberculose
maladie: âge inférieur à 4 ans, importance de l’inoculum de BK transmise. La tuberculose maladie par
réactivation d’un foyer quiescent s’observe surtout chez les sujets âgés. L’immunodépression est un facteur
majeur de réactivation. La malnutrition, l’alcoolisme, les situations de précarité, la toxicomanie intraveineuse, la
promiscuité, le diabète, l’insuffisance rénale avancée sont autant de situations qui favorisent le passage du stade
d’infection tuberculeuse quiescente à la tuberculose-maladie.
On appelle primo-infection maladie les tuberculoses maladies qui apparaissent au cours ou au décours immédiat
de la PIT. On appelle tuberculose-infection latente les primo-infections sans localisation ou expression clinique
patente (simple virage des tests tuberculiniques). On appelle tuberculose-infection patente ou primo-infection
patente toute primo-infection accompagnée de signes radiologiques et/ou généraux (doit être considérée comme
une tuberculose-maladie et traitée comme telle). L’immunité conférée par une PIT ou une "tuberculose maladie"
est en général suffisante pour protéger l’individu d’une infection par une nouvelle souche de bacilles "exogènes".
Ainsi donc, la grande majorité des "tuberculoses maladies" procèdent du réveil d’une population de bacilles
4

Année Universitaire 2006-2007 Tuberculose –Pr Marquette et Pr Lafitte
quiescents à partir d’un foyer préexistant. Cependant, dans de rares cas, des réinfections exogènes ont été
documentées chez des sujets ayant un antécédent d’infection tuberculeuse.
Localisations pulmonaires
Les localisations pulmonaires constituent la grande majorité des cas de tuberculose maladie. Au cours de cette
forme habituelle de tuberculose, encore appelée tuberculose pulmonaire commune, ou tuberculose
secondaire, les lésions développées à partir d’un ou de foyer(s) secondaire(s) ou, plus rarement à partir du foyer
primaire, prédominent dans les régions supérieures et postérieures des champs pulmonaires. La tension partielle
en oxygène est plus élevée dans ces zones, ce qui inhibe partiellement les mécanismes de défense vis à vis du
bacille tuberculeux. Le caséum se ramollit et se liquéfie, aboutissant, après fistulisation à l’arbre bronchique, à la
formation d’une cavité (caverne) contenant une très grande quantité de BK viables (108 à 1010). A partir de ce
foyer excavé les bacilles peuvent disséminer au reste du poumon par voie bronchogène. L’atteinte pleurale
(pleurésie), le plus souvent unilatérale, peut survenir à tout moment après la PIT. Chez l’adolescent et l’adulte
jeune elle est en général concomitante ou suit immédiatement la PIT. Elle est liée à l’effraction de la plèvre à
partir d’un foyer parenchymateux sous-pleural. Elle réalise le plus souvent une pleurésie exsudative, contenant
de très rares BK avec une plèvre tapissée de follicules tuberculeux. Plus rarement elle se traduit par un empyème
(caséum liquide), riche en BK. La pneumonie aiguë tuberculeuse fait suite à l’ensemencement massif de
parenchyme sain à partir d’un foyer excavé. Ceci se traduit par une réaction inflammatoire très intense
responsable d’une alvéolite aiguë parfois extensive, riche en BK. Tuberculose médiastino-hilaire : chez l’enfant
ou l’adolescent la réaction ganglionnaire satellite du foyer primaire peut prendre une allure "explosive" sous la
forme d’adénopathies volumineuses, comprimant l’arbre bronchique et se fistulisant parfois dans la lumière
trachéo-bronchique. Il s’agit là stricto sensu d’une forme clinique de primo-infection maladie.
Localisations extra-pulmonaires
Les tuberculoses disséminées (poumon, moelle, foie, rate, rein, méninges) surviennent lors de la phase de
bacillémie initiale (cf. supra) ou plus tardivement (chez le sujet âgé en particulier) par dissémination hématogène
après érosion vasculaire, à partir d’un foyer de nécrose caséeuse. Les lésions histologiques (granulomes
épithélio-giganto cellulaires avec ou parfois sans nécrose caséeuse, au moins au début) sont de petite taille (0,5
à 2 mm, réalisant un aspect radiologique en "grain de mil"), raison pour laquelle ces formes disséminées de
tuberculose sont appelées miliaires tuberculeuses. La méningite tuberculeuse résulte de l’effraction de
l’espace méningé à partir d’un foyer cortical cérébral. Ces formes graves de tuberculose (miliaire et méningite)
prédominaient auparavant chez l’enfant. Actuellement dans les pays riches, elles sont le plus souvent
rencontrées chez les sujets âgés, où le diagnostic, faute de suspicion clinique, est souvent tardif. Plus rarement
les lésions extra-pulmonaires concernent les os et les articulations (abcès froid tuberculeux), le rein et les voies
excréto-urinaires, ou les organes génitaux.
Primo-infection
Développement d’une immunité
à médiation cellulaire solide
Développement d’une
hyperréactivité
vis à vis de la tuberculine
(
IDR +
)
x = multiplication
x de bacilles quiescents
caséum liquide, excavation
⇒ tuberculose secondaire
! Pulmonaire ⇒ contagiosité
! (ou extra-pulmonaire)
Infection contrôlée
Caséum solide, calcification
Rares bacilles quiescents
Infection non contrôlée
tuberculose primaire
Foyers
secondaires
dissémination hématogène
(poumon, foie, rate, os, séreuses, méninges)
Infection contrôlée
Caséum solide, calcification
Rares bacilles quiescents
ADP satellite
x bacillaire
Foyer primaire
x bacillaire + libération de bacilles
A
bsence de x intra
macrophagique
Sujets IDR -
Macrophages alvéolaires
Inhalation de bacilles en
suspension dans l’air
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%