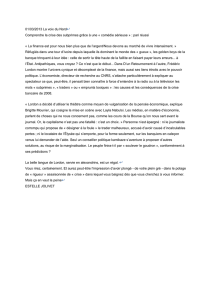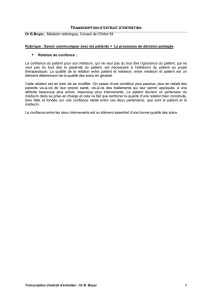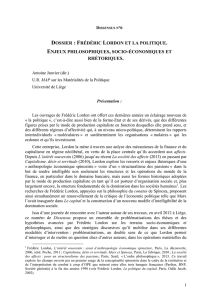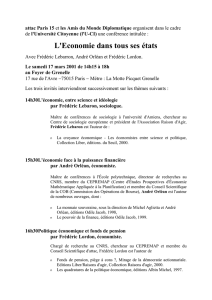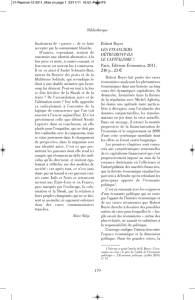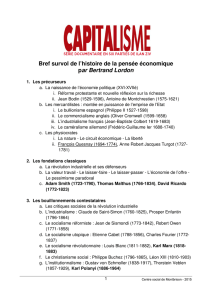La dynamique des régimes de politique économique aux Etats

1
Contribution au Colloque AFEP 2013
POLITIQUE ECONOMIQUE : UN ESSAI D’INTERPRETATION A
PARTIR DE LA REGULATION ET DES MEDIATIONS POLITIQUES
Eric Lahille
Université Paris-Est/ESIEE PARIS et CEMI-EHESS
PLAN
Introduction
1. Théorie de la régulation et politique économique : du rejet critique de l’approche
fonctionnaliste à la recherche d’un nouveau statut.
1.1. De la critique de la politique économique …à l’indétermination de sa place et à
l’hétérogénéité de son statut.
1.2. Quels rôles pour la politique économique ? Des divergences d’interprétation à l’origine
de difficultés théoriques et empiriques
1.3. Critiques et tentatives de dépassement.
2. Vers une économie politique régulationniste de la politique économique.
2.1. La politique économique vue sous l’angle des structures sociétales et politiques
2.2. La politique économique insérée dans les rapports Etat-économie
2.3. L’approche constructiviste de la politique économique : entre retour aux sources et
limitation méthodologique et prescriptive.
2.4. Inclusion de la politique économique à la TR et affirmation de son rôle singulier dans la
régulation.
2.5. Conclusion provisoire : une vue d’ensemble des processus complexes de détermination
de la politique économique.
3. La place et le rôle du politique dans la TR : pluralité d’approches, évolutions et
enjeux théoriques
3.1. L’ontologie sociale du politique dans la TR
3.2. Le politique dans la TR1 : son application à la crise.
3.3. TR étendue : entre primat du politique et autonomie relative de l’économie.
3.4. Quelques hypothèses sur les interactions Economie/Politique
3.5. Eléments de caractérisation du politique à partir du concept de mode de régulation
politique.
3.6. La nécessaire intégration de la dimension d’Economie politique internationale
4. Régulation politique et politique économique : quelques hypothèses de travail pour ne
pas conclure
Introduction
Aujourd’hui, les politiques économiques sont vues par la théorie standard sous un angle
étroitement normatif et de façon purement technique. En fait, cette démarche dominante de la
politique économique est la conséquence de la séparation ontologique de l’économie et du

2
politique qui structure la doctrine libérale depuis ses origines et dont le projet est d’imposer
un primat de l’économique sur l’ensemble du système social.
Cette instrumentalisation pose une série de problèmes épistémologiques et méthodologiques,
de macroéconomie appliquée, ou encore relatifs à la régulation et à l’accumulation. C’est
notamment le cas de l’Union Européenne et de la zone euro où l’acharnement à conduire des
politiques budgétaires et fiscales de plus en plus restrictives aggrave la crise globale au lieu
d’en contrecarrer les effets conjoncturels récessifs.
Une des explications les plus couramment admises consiste à faire état du caractère hautement
performatif des théories « néolibérales » qui servent de fondements à la mise en œuvre de
telles politiques. Pourtant, à l’heure de l’extension et de l’aggravation des politiques
d’austérité, cette thèse nous paraît insuffisante. En effet, l’enfermement dans de telles
logiques ne fait même plus consensus au sein du courant dominant, comme l’attestent les
récentes déclarations de l’économiste en chef du FMI, O. Blanchard, qui admet des erreurs
dans le calcul des coefficients multiplicateurs des dépenses publiques.
Si le cadre conceptuel dominant est à la base de politiques économiques impliquant des effets
conjoncturels mais aussi structurels déstabilisateurs, qui, de toute évidence ont des
conséquences politiques et sociales majeures, on ne peut, en revanche, se satisfaire de cette
seule explication. Sauf à accepter de raisonner dans un cadre simpliste, les choix de mise en
œuvre de politiques économiques (plus ou moins expansionnistes, neutres ou restrictives -
pour simplifier-) ne sauraient donc être abordés simplement sous l’angle unique de leur
conformité vis-à-vis des normes néolibérales. Il convient, à tout le moins, de les juger à l’aune
de leurs résultats macroéconomiques et, surtout, de les inscrire dans le réseau complexe de
détermination économique, sociale et politique dans lequel elles prennent leur source et sur
lequel elles font retour.
Pour dépasser toute vision réductrice évacuant les tenants et aboutissants non économiques de
leur mise en œuvre, considérés simplement comme des perturbations de l’ordre idéal
marchand, il convient donc de penser les conditions sociales et politiques de leur élaboration.
Notre hypothèse de départ est qu’une certaine configuration des rapports sociaux conditionne
très largement la nature des politiques publiques en général et les politiques économiques en
particulier. Aussi est-il fondamental de questionner ces déterminants « cachés » par la théorie
standard en rompant avec l’hégémonie techniciste focalisée sur les seules variables
économiques et le rejet du politique. En écartant cette perspective économiciste, on tente, non
pas tant, de renverser la problématique du côté des seules variables non-économiques, que de
suggérer un autre mode d’insertion de l’économique à la sphère sociale et à l’instance
politique. Ce choix s’appuie sur les travaux de l’école de la régulation pour lesquels les
institutions, dont la politique économique, ont un caractère non économique et principalement
politique (Boyer, 2004).
Pour ce faire, on rappellera, premièrement, les définitions, rôles et statuts de la politique
économique à partir d’une présentation des hypothèses régulationnistes, des origines à nos
jours. On s’emploie, ensuite, à articuler celles-ci avec les différentes approches du politique
que l’on trouve dans la théorie de la régulation (TR). S’il n’y a pas de vision univoque au sein
de la TR, tant au plan des politiques économiques qu’à celui du statut du politique, il est
néanmoins possible d’avancer des éléments de réflexion qui prolongent certaines
conceptualisations régulationnistes. Il s’agit notamment de compléter ces approches en y
intégrant la dimension du rapport international que l’on articule aux logiques spécifiques de la
régulation politique, afin de penser les différentes expériences en cours et d’aboutir à une
étude « terrain ».
A l’heure où de nombreux travaux hétérodoxes restent centrés sur la grande crise du
néolibéralisme et des politiques néolibérales, nous insisterons donc plutôt sur les différences

3
politiques et institutionnelles qui sont directement à l’origine de la variété des régimes de
politique économique qui se traduisent par une hétérogénéité de résultats.
En s’inscrivant dans une perspective d’économie politique, ce travail doit être envisagé
comme une tentative d’incorporation des variables non strictement économiques, et
singulièrement des variables et déterminations politiques, qui, c’est l’hypothèse défendue ici,
jouent un rôle central dans la conformation des régimes actuels de politique économique et
dans leur dynamique macroéconomique, sociale et politique
1
.
1. Théorie de la régulation et politique économique : du rejet critique de l’approche
fonctionnaliste à la recherche d’un nouveau statut.
1.1. De la critique de la politique économique …à l’indétermination de sa place et à
l’hétérogénéité de son statut.
Dès les années 70/80, la critique de la conception fonctionnaliste traditionnelle de la politique
économique apparaît comme un des traits différenciant des travaux régulationnistes par
rapport aux autres approches économiques. Ainsi c’est ainsi une certaine conception
téléologique de la politique économique qui est remise en cause. En effet, pour la TR, celle-ci
ne saurait être simplement le produit d’un acteur omniscient, en l’occurrence l’Etat, qui
mobiliserait de manière intentionnelle ses moyens au service d’une régulation rationnelle du
système économique (André et Delorme, 1983). Pour les régulationnistes la politique
économique n’est, tout au plus, qu’une forme institutionnelle (FI) parmi les autres et seule
leur configuration d’ensemble définit le mode de régulation. La politique économique décidée
par un Etat, à supposer qu’elle soit homogène et cohérente, n’est donc qu’un vecteur de la
dynamique d’ensemble. Ainsi n’a-t-elle pas le même statut que dans les approches standard
ou même dans le keynésianisme et le marxisme, qui lui accordent un rôle absolument central
et des vertus considérables dans la stabilisation et la cohérence économique globale. On
comprend, dans ces conditions, qu’elle mette de côté la politique économique conjoncturelle
(de type keynésienne) de court terme.
Considérée comme un élément intégré dans un ensemble de structures dont la configuration
fonde la dynamique économique d’ensemble, la TR propose un renversement de la
perspective dominante et opère un changement conceptuel profond quant aux places et rôles
de la politique économique. Ainsi, dans un premier temps, un des messages essentiels délivrés
par la TR consiste à pointer les limites des politiques économiques, pensées
fondamentalement comme soumises aux luttes d’influence entre acteurs sociaux et résultant
de rapports de forces et de compromis institutionnalisés. Ce qui revient ensuite à en réduire
singulièrement la portée.
Cependant, un rapide survol des principales analyses régulationnistes en la matière fait
ressortir une pluralité d’approches provenant d’une diversité des angles d’attaque. Le résultat
est alors plus hétérogène qu’il n’y paraît au premier abord et dans cette phase d’émergence de
la théorie plusieurs définitions et conceptions de la politique économique cohabitent entre
elles de manière plus ou moins contradictoire.
1
Cette contribution théorique qui met l’accent sur les interactions signifiantes entre régulation économique et
politique n’est que le 1
er
volet d’une étude ayant pour objet final de s’interroger sur ce qui unit et distingue les
politiques macroéconomiques réellement menées aux Etats-Unis et en Europe depuis les années deux mille. Il
s’agit donc d’esquisser ici une conceptualisation servant de cadre à une analyse comparative des régimes de
politique économique sous l’angle des stratégies politiques des acteurs en concurrence dans les différents
espaces sociaux. Ce travail entend donc avancer une série d’hypothèses nécessaire à une interprétation
sociopolitique non déterministe des tenants et aboutissants des politiques économiques. Dans cet esprit, on essaie
de préciser, ici, les principaux processus d’ordre politique susceptibles de discriminer les trajectoires entre les
espaces sociaux et comment ils opèrent aux différents niveaux considérés.

4
Si l’option la plus répandue est, sans doute, de la considérer comme une FI à part entière,
mais hiérarchiquement dominée par les autres FI et conformée par des structures sociales plus
fondamentales, elle peut aussi être envisagée de manière plus horizontale, dispersée entre les
différentes formes structurelles (monnaie, rapport salarial, etc.) (Benassi, Boyer, Gelpi, 1979).
Enfin, elle s’avère, aussi, emboitée au sein de la FI « Etat » (André et Delorme, 1983,
Delorme, 1995). Elle est ainsi considérée comme un sous-ensemble constitutif d’une FI plus
vaste qui l’englobe. Dans tous les cas, elle est donc située soit en retrait, soit à un échelon
inférieur à celui des principales FI, comme par exemple au sein de « la nature ou des formes
de l’Etat », ou encore à un niveau plus orthogonal aux autres FI, qui relève plus globalement
d’un régime hétérogène de politiques publiques. Son statut n’est donc pas équivalent à celui
d’une FI « classique ».
Cette place secondaire vis-à-vis des autres FI est, cependant, contestée de manière implicite,
par le fait qu’elle occupe une position transverse par rapport aux principales structures
institutionnelles, ce qui lui confère un statut pour le moins spécifique. En effet, en étant
orthogonale aux autres FI, il n’est plus évident que son rôle soit aussi contraint que ne le
postule généralement la TR, car c’est depuis son espace particulier qu’elle est susceptible de
travailler en profondeur les déterminations des autres FI. Il apparaît alors une ambiguïté au
sujet de la place conférée par la TR à la politique économique qui est source de contradiction
et d’une tension logique au sein de son corpus théorique, dans la mesure où elle remet en
question le constat initial sur une place et donc une portée limitées. En effet, ces constats sur
l’absence de vision uniforme du mode d’insertion de la politique économique dans la
régulation et sur la singularité de son positionnement ont évidemment des conséquences
essentielles s’agissant de son degré exact d’influence et sur son rôle.
1.2. Quels rôles pour la politique économique ? Des divergences d’interprétation à l’origine
de difficultés théoriques et empiriques
F. Lordon (1994, 1995, p.200-202) ne recense pas moins de quatre positions régulationnistes
différentes en la matière. Celles-ci vont d’une posture d’arraisonnement de la politique
économique, qui représente le dénominateur commun régulationniste, en s’inspirant de
l’approche poulantzasienne de l’Etat
2
, jusqu’à son « exclusion » pure et simple
3
. Elles
s’opposent néanmoins à des approches moins radicales quant à son degré d’asservissement
structurel et social (Boyer, 1986) et plus classiquement programmatique mettant l’accent sur
la nécessité de politiques économiques structurelles dans la crise (Lipietz, 1984).
Cette diversité des positions qui s’articule partiellement aux différences de statut de la
politique économique dans la TR, est le signe d’une difficulté théorique rendant tout à fait
improbable la définition d’une « politique économique régulationniste » homogène.
En fait, l’hétérogénéité des rôle, place et statut de la politique économique doit être replacé
dans le cadre plus vaste des travaux sur les grandes crises et les changements institutionnels
de longue période, qui constituent le cœur du projet régulationniste. Ainsi la politique
économique est-elle vue, avant tout, sous l’angle des grandes transformations structurelles. A
ce titre, la TR questionne fondamentalement sa conformation à des déterminants historiques et
institutionnels qui sont situés en amont (Théret, 1992). Ce qui débouche, au mieux, sur des
réflexions portant sur les conditions de ses mutations et sur les modalités d’émergence de
nouvelles formes de politiques économiques en relation avec les FI et les régimes
d’accumulation (Boyer, 1986, p. 88-97).
En raison de la nature de son projet initial, qui consiste à prendre à contre-pied les théories
dominantes de la politique économique, la TR insiste principalement sur leurs limites dans la
mesure où celles-ci ne peuvent être pensées indépendamment de la grande crise structurelle
2
Pour quelques précisions sur le sujet, supra cf. 2.3.
3
Cf. infra, 1.3.

5
du fordisme. La question de leur efficacité ne dépend pas tant du choix de bonnes décisions et
d’un fin réglage conjoncturel décrété par l’Etat, mais de leur adéquation avec la dynamique
systémique et l’ordre social. Ainsi, la TR insiste plutôt sur leur caractère potentiellement
déstabilisateur pour le mode de régulation, dont elles sont pourtant l’émanation, si les
régularités socioéconomiques d’ensemble se trouvent modifiées (Aglietta, Orléan, Oudiz,
1980, Théret, 1992, 1999, Boyer, 1986).
Le propos initial de la TR consiste donc en une opposition à la vision techniciste dominante
basée sur la régulation conjoncturelle de la politique économique pour y substituer une
conception structurelle, sociale et historique privilégiant la longue période.
Celles-ci sont donc pensées non pas en tant que composante active et particulière d’un
système économique donné, mais comme un élément plus ou moins « passif » de la structure
socio-économique, sans réelle autonomie (Lordon, 1995). Autrement dit, la politique
économique n’intéresse la TR que du point de vue des vastes recompositions institutionnelles
dont elle est l’expression. Elle est ainsi condamnée à un rôle mineur dans la dynamique du
changement structurel qui s’impose à elle plutôt qu’elle ne l’influence.
Cette motion majoritaire est cependant progressivement amendée. Ainsi R. Boyer (1986)
envisage-t-il la politique économique sous l’angle de son autonomie relative. Cette position
non déterministe qui accorde une place et un rôle à part entière à la politique économique
remet donc en question une vision structuraliste qui surestime le poids et l’effet des structures
sur la dynamique institutionnelle et les décisions des acteurs. Si la politique économique est
posée comme complexe, non univoque et insérée dans une dynamique socioéconomique qui
l’englobe et la dépasse, elle ne saurait donc s’y réduire complètement. Globalement, les
relations de la TR avec la politique économique ne sont donc ni simples ni homogènes et
surtout pas sans ambiguïtés et sans faiblesses lorsqu’il s’agit de définir un modèle cohérent de
politique économique.
1.3. Critiques et tentatives de dépassement.
Cette conception inédite de la politique économique a suscité des incompréhensions et
alimenté les débats internes et les réactions de tous bords
4
. Dès l’origine, la TR a donc dû
faire face à des critiques à la fois nombreuses et récurrentes. En schématisant, on peut dire
que ces critiques sont de deux ordres. D’une part, elles soulignent les difficultés théoriques et
empiriques pour parvenir à inclure pleinement la politique économique à la perspective qui est
la sienne et, d’autre part, elles se polarisent sur la faiblesse et l’hétérogénéité de son
programme de politique économique. Comme le reconnaissent les régulationnistes, ces
critiques n’apparaissent pas toujours complètement infondées.
Un bref rappel des fondements épistémologiques et méthodologiques de la TR et de son projet
initial permet de comprendre les difficultés qu’elle rencontre. De par son épistémologie méta-
institutionnelle et historique, elle privilégie l’analyse des transformations structurelles du
capitalisme en négligeant les dynamiques locales et le temps court. Or on constate
empiriquement que certaines logiques partielles finissent par s’imposer et faire système et que
des décisions de politique économique conjoncturelle peuvent modifier durablement
l’architecture institutionnelle de tout système économique.
La TR semble donc victime de sa prise de distance critique vis-à-vis de la politique
économique traditionnelle. En outre, la dichotomie entre conjoncture et structure sur laquelle
elle fonde sa démarche la conduit logiquement à sous-estimer l’impact des interventions
publiques. On comprend alors les difficultés pour la TR d’investir le champ de la politique
économique. Dans ces conditions, il ne peut exister de programme régulationniste de politique
4
Pour une vue d’ensemble Cf. Boyer (1986).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%