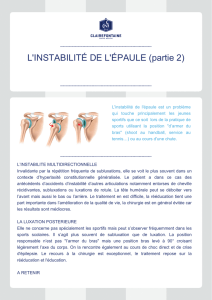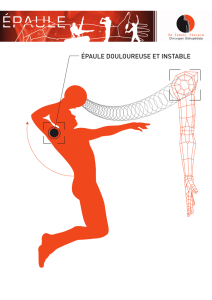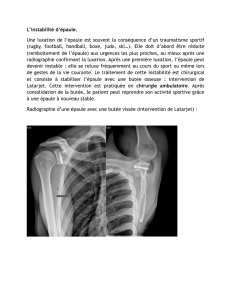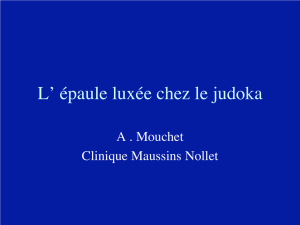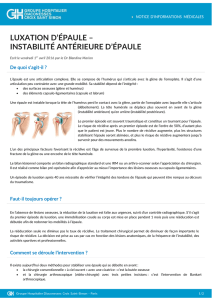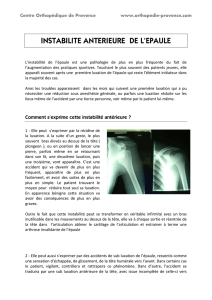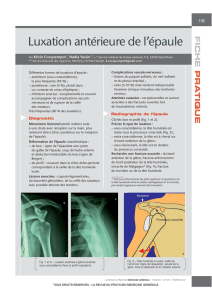Instabilité antérieure de l`épaule

1
La prise en charge d’une épaule instable soulève diffé-
rentes questions auxquelles le praticien devra répondre
dans une démarche systématique :
- Quelles sont les lésions anatomiques en cause dans
cette instabilité ?
- Et comment en apprécier la gravité au moyen des ex-
plorations radiologiques ?
S’il s’agit d’un sportif, d’autres interrogations se posent
alors au praticien :
- Quelles sont les sollicitations de la mécanique spor-
tive qui ont conduit ou contribué à voir s’installer cette
pathologie [1, 2, 3] ?
- Comment apporter une solution thérapeutique qui
autorise une reprise spécifique du sport en fonction
des contraintes qui vont s’exercer sur cette épaule ?
- Peut-on promettre une reprise du même sport, au même
niveau, dans quels délais et à quelles conditions ?
Dans le cadre des instabilités antérieures, les techni-
ques classiques de stabilisation ont traversé les géné-
rations et demeurent les plus couramment utilisés [4,
5, 6, 7, 8]. Leurs résultats ne se limitent plus à la sim-
ple analyse du taux de récidive, mais intègrent désor-
mais la réponse apportée aux exigences mécaniques
et sportives. Le caractère arthrogène à moyen et long
terme doit aussi être pris en compte notamment lors-
que la carrière sportive sera terminée. Notre technique
chirurgicale a évolué vers une approche “mini-invasive”
permettant d’atténuer les séquelles fonctionnelles et
d’optimiser les résultats notamment avec l’avènement
de l’arthroscopie [9, 10, 11].
Lésions anatomiques à l’origine
d’une instabilité de l’épaule
La stabilité mécanique de l’articulation gléno-humé-
rale procède d’une parfaite synchronisation d’éléments
osseux, articulaires, capsulo-ligamentaires et neuro-
musculaires [12]. Ce n’est qu’à cette condition que le
sportif pourra allier performance et indolence dans la
réalisation du geste technique. Si des lésions graves
de ces différentes structures anatomiques et fonction-
nelles sont fréquemment observées par la répétition
des contraintes ou la sévérité des contacts de certains
sports, a contrario, des lésions même minimes de ce
merveilleux appareil peuvent s’avérer sources de déran-
gements internes contrariant la pratique sportive [13] ou
quotidienne alors qu’elles resteraient infracliniques chez
un sédentaire.
Lésions osseuses observées
Le “rebord” glénoïdien est le premier rempart mécani-
que de la stabilité gléno-humérale. Il peut être simple-
ment “éculé” par le passage itératif de la tête humérale
instable ou bien encore fracturé, occasionnant alors
une marche d’escalier sur laquelle la tête humérale
peut s’engager ; elle n’est plus en situation stable telle
une balle de golf sur un tee cassé (fig. 1). Que la perte
de congruence osseuse soit causale ou secondaire,
elle contribue mécaniquement au passage à la chro-
nicité de l’instabilité. L’encoche humérale témoigne
de l’impaction céphalique sous le rebord glénoïdien
lors des épisodes de luxations (fig. 2). Elle peut être
de forme et profondeur variables mais on la retrouve
quasiment systématiquement dans les formes chroni-
ques. Un lien statistique a pu être démontré entre sa
profondeur et le taux de récidive mais il est vrai que
les lésions à haute énergie sont à la fois sources de
lésions capsulo-labrales et osseuses importantes.
Néanmoins, l’encoche de Hill Sachs peut occasionner
une perte de la sphéricité de la tête humérale contri-
buant indiscutablement à une instabilité ressentie ou
réelle de l’épaule (sans doute dans une mesure moin-
dre que l’encoche de Mc Laughlin observée dans les
instabilités postérieures). Elle peut aussi parfois être
“remplacée” par une fracture du trochiter.
Instabilité antérieure de l’épaule :
Rappels anatomocliniques, traitement et
informations demandées à l’imagerie
D. FONTES

D. FONTES
2
Lésions labrales et articulaires
La concavité articulaire de la glène est accrue par la
présence du labrum sur toute sa circonférence, ce qui
contribue à optimiser la stabilité purement osseuse de
l’articulation gléno-humérale (fig. 3). S’y ajoute un ef-
fet “ventouse” de type piston visco-élastique par une
pression négative estimée à -32 mmHg. Cette dispo-
sition n’équivaut néanmoins pas à un emboîtement ré-
ciproque. Le labrum contribue aussi à l’amarrage des
structures capsulo-labrales ainsi que du tendon du long
biceps. Les lésions labrales peuvent être à l’origine de
l’instabilité ou secondaires à la répétition de mécanis-
mes de luxation. Mais, au-delà du phénomène de dé-
rangement interne causé par une lésion du bourrelet,
cette dernière contribue au passage à la chronicité de
l’instabilité. Plusieurs types lésionnels sont observés, de
la simple fissuration partielle à l’anse de sceau complè-
te, aux lambeaux de bourrelet désinsérés, voire même à
sa disparition complète. La lésion, initialement limitée au
labrum antérieur peut se propager au labrum postérieur
sans être pour autant la cause d’instabilité postérieure
associée. L’insertion glénoïdienne du tendon du long
biceps peut être avulsée et constituer de réelles SLAP
lesions, retrouvées dans 23 % des cas. Le décollement
lésionnel peut aussi se propager au col de la glène et
constituer un décollement capsulo-périosté étendu dit
de Broca et Hartman tout aussi classique qu’exception-
nel. Le cartilage articulaire souffre des phénomènes de
luxation, tant sur le versant glénoïdien qu’huméral de
l’articulation et l’omarthrose est souvent le terme évolu-
tif d’un long passé d’instabilité non opérée.
Lésions ligamentaires
La stabilisation capsulo-ligamentaire est assurée par
une nappe fibro-élastique d’où l’on décrit trois struc-
tures possiblement lésées lors des phénomènes d’ins-
tabilité antéro-inférieure (fig. 4). Le ligament gléno-hu-
méral supérieur (LGHS) contribue plus volontiers à la
stabilité inférieure de l’articulation. Le ligament gléno-
huméral moyen (LGHM) est mis en tension en avant
dans un secteur d’abduction compris entre 60° et 90°
alors que le ligament gléno-huméral inférieur (LGHI) est
le principal stabilisateur antérieur au-delà de 90° d’ab-
duction. Il doit constituer un véritable hamac sur lequel
repose la tête humérale lors de l’armer du bras. Il se
désinsère habituellement du labrum antéro-inférieur ou
parfois de l’humérus constituant alors une HAGL lesion
Fig. 1 : Eculement ou fracture de la glène contribuent à la perte de stabilisation
comme ferait une balle de golf sur un tee cassé.
Fig. 2 : Mécanisme de constitution de l’encoche humérale lors d’une luxation.

Instabilité antérieure de l’épaule
3
(Humeral Avulsion of Gleno-humeral Ligament). L’extra-
ordinaire mobilité de l’articulation gléno-humérale tient
à la laxité physiologique des structures ligamentaires
qui en assurent la cohésion. Néanmoins, dans certains
cas, cette laxité constitutionnelle peut sembler exces-
sive et constituer un facteur favorisant de l’instabilité.
On retrouve cette “hyperlaxité” volontiers chez les jeu-
nes et les adolescents et elle se “corrige” souvent avec
l’âge mais elle facilite le passage de la laxité à l’insta-
bilité car les forces nécessaires à la perte de contact
des surfaces articulaires s’en trouvent diminuées, elle
constitue aussi un facteur de récidive postopératoire
important. Au-delà même du caractère constitutionnel
de cette hyperélasticité ligamentaire, certains gestes
sportifs peuvent occasionner, par leur répétition (no-
tion d’“overuse”), une détente progressive d’un certain
secteur articulaire comme on peut l’observer lors de
sports de lancer. L’épaule du pitcher au base-ball en
est l’exemple le plus classique mais de tels phénomè-
nes peuvent aussi s’observer chez certains lanceurs
ou tennismen, pouvant aussi participer d’un syndrome
de conflit postéro-supérieur.
La quantification de cette laxité devra donc être un
temps essentiel de l’examen clinique.
Fig. 3 : Optimisation de la
concavité glénoïdienne par le
labrum circonférentiel (dimi-
nution du rayon de courbure).
Fig. 4 : Structures ligamentaires contribuant à la stabilité gléno-humérale avec effet “hamac” inférieur du LGHI.

D. FONTES
4
Lésions neuromusculaires
Les muscles de la région scapulaire contribuent aussi
à la coaptation dynamique de la tête humérale mais
dans une mesure moindre que les structures précé-
demment citées. Le subscapularis participe à la mise
en tension de la capsule antérieure lors des premiers
degrés d’abduction mais son rôle est essentiellement
proprioceptif car, en position d’armer du bras, il est si-
tué au-dessus de l’équateur de la tête humérale et ne
participe plus à sa coaptation. C’est d’ailleurs dans cet
intervalle laissé vaquant que la tête humérale s’immisce
lors d’une luxation dont le seul frein est alors le LGHI.
Même si le support du système musculaire scapulaire
n’est que contributif, il est démontré que le taux de ré-
cidive est moindre après rééducation correcte dans les
suites d’un premier épisode de luxation. Ils participent
néanmoins au contexte lésionnel, notamment chez les
patients les plus âgés qui ont une rupture transfixiante
de la coiffe des rotateurs associée dans 70 % des luxa-
tions survenant après 60 ans. Pour les patients plus jeu-
nes, des lésions tendineuses partielles (PASTA lesions)
seraient présentes dans près d’un quart des cas (sym-
posium de la SFA). Ces lésions tendineuses associées
sont peut-être des “équivalents d’encoche” où la cor-
ticale de la tête humérale résisterait mieux à l’impact
du rebord glénoïdien que la coiffe elle-même dont les
capacités d’élongation plastique diminuent avec l’âge.
Le rôle stabilisant de la coiffe des rotateurs est plus im-
portant lors des premiers degrés d’abduction, au delà,
elle ne constitue plus probablement qu’un “deuxième
rideau défensif” de résistance précaire. Cette notion a
d’ailleurs été confirmée par plusieurs études expérimen-
tales qui ont montré qu’une lésion tendineuse au moins
partielle de la coiffe des rotateurs devait être associée
à la section de la portion antéro-inférieure de l’appareil
capsulo-ligamentaire pour obtenir une luxation.
Les lésions neurologiques associées sont souvent mé-
connues et des EMG systématiques en démontrent la
relative fréquence. Si la récupération est habituelle, il
peut s’agir de lésions graves, notamment du nerf axil-
laire, qui nécessitent un diagnostic de gravité précoce
et un traitement spécifique adapté. Il arrive encore trop
souvent que les bilans neuro-physiologiques ne soient
faits que secondairement alors que l’examen neuro-
logique et vasculaire doit être systématique dans un
contexte de luxation.
En conclusion, la physiopathologie de l’épaule instable
associe à des degrés divers mais de façon constante :
- une perte de tension du hamac capsulo-ligamentaire
inférieur,
- un défaut de la concavité glénoïdo-labrale antérieure,
ces deux structures constituant le verrou passif de
stabilisation,
- une atteinte du système de rappel dynamique que
constituent la coiffe des rotateurs et son insertion
humérale.
Nous verrons que l’examen clinique et le bilan radiogra-
phique devront s’attacher à préciser l’étendue de ces
lésions et que seul un traitement chirurgical qui prendra
en compte ce double bilan sera à même de garantir une
stabilisation efficace de cette articulation.
Tableaux cliniques de l’instabilité
antérieure, bilan radiographique
Deux contextes cliniques classiques constituent le syn-
drome d’instabilité de l’épaule :
- l’instabilité aiguë lors d’un premier épisode où la perte
de contact articulaire est totale et la réduction pourra
être réalisée par le patient lui-même ou le concours
d’un tiers ;
- le tableau d’instabilité chronique dont on distingue
3 formes (luxations récidivantes, subluxations, épaule
instable et douloureuse). Dans ces deux derniers ta-
bleaux, la tête humérale s’engage dans un mécanisme
de luxation sans pour autant y parvenir, elle empiète
sur le rebord labral antérieur expliquant le phénomène
de dérangement interne et les douleurs caractéristi-
ques du “syndrome du bourrelet”.
L’instabilité aiguë : le premier épisode
Le contexte de survenue est très important pour ju-
ger du caractère traumatique de cet épisode ou de
sa facilitation par un état préalable d’hyperlaxité ou
de lésions micro-traumatiques préexistantes. Parfois,
le premier épisode semble d’origine non traumatique
mais l’interrogatoire retrouve souvent dans le passé un
traumatisme important (accident de moto ou de ski par
exemple) qu’il faut alors prendre en compte. Le méca-
nisme doit être rapporté qu’il soit direct par un impact
scapulaire d’arrière en avant ou indirect, ce qui est le
plus fréquent.
Le diagnostic de luxation est clinique mais doit être
confirmé par une radiographie systématique pratiquée
avant et après réduction, elle permettra notamment de
documenter cet épisode en cas de récidive. C’est à
ce stade qu’il faut aussi s’attarder sur l’examen neu-
rovasculaire simplifié mais systématique. Le délai de
réduction est aussi important à noter de même que
les manœuvres réductionnelles réalisées avec ou sans
sédation. En urgence, l’incidence de face confirme la
vacuité de la glène et la position sous glénoïdienne de
la tête humérale dont on apprécie le contour à la re-
cherche d’une fracture associée. Un complément par
une incidence de profil lève tout doute au moyen d’une
incidence de Lamy ou de Garth.
Après réduction ou au décours d’un épisode d’instabi-
lité, un bilan radiographique standard par des inciden-
ces de face en 3 rotations et des profils de Bernageau

Instabilité antérieure de l’épaule
5
[14, 15] est systématique. Il permet de rechercher des
anomalies osseuses à type de fracture de la glène,
du tubercule majeur, et une encoche humérale de Hill
Sachs. Néanmoins, cet examen radiographique n’est
pas suffisant chez un sportif, qui plus est de haut niveau
et professionnel. En pratique, nous préconisons l’IRM
dans les suites immédiates d’un épisode d’instabilité
du fait de sa nature non-invasive [16]. L’hémarthrose,
présente dans les premiers jours, permet de se passer
d’une injection intra-articulaire et l’œdème de la tête hu-
mérale signe l’épisode d’instabilité auto-réduit, même
en l’absence d’encoche spécifique (fig. 5).
L’instabilité passée à la chronicité
Chaque épisode de luxation doit bénéficier du même
protocole radiographique standard car une fracture
peut survenir à toutes les étapes et chaque réduction
doit être documentée par des clichés systématiques.
Quand le syndrome se manifeste par des subluxations,
il faudra bien les distinguer d’éventuelles subluxations
volontaires déclenchées ou réduites par des contrac-
tions musculaires sur un terrain d’hyperlaxité multi-
directionnelle. Ces pertes transitoires de congruence
articulaire sont volontiers postérieures et suivies de mi-
miques réductionnelles souvent bruyantes et démons-
tratives attirant alors intentionnellement l’attention de
l’entourage sur le jeune patient. Néanmoins, il existe
des formes combinées ou de passage et l’examen cli-
nique devra alors s’attacher à distinguer d’éventuels
signes de laxité pathologique d’une laxité physiologi-
que, fût-elle importante.
L’examen clinique
Plusieurs manœuvres sont ainsi réalisées, de manière
bilatérale et comparative. La recherche d’une grimace
ou de douleur témoignant souvent d’un caractère pa-
thologique. Parfois, le tableau clinique est celui d’une
épaule douloureuse sans luxations vraies que l’examen
rapportera à une réelle instabilité.
L’examen physique, à distance d’un épisode d’instabi-
lité, en dehors de l’examen neurologique, va comporter
trois phases systématiques : la réalisation de tests d’ap-
préhension, le bilan de la laxité scapulo-humérale et la
recherche d’une hyperlaxité multidirectionnelle associée.
Les manœuvres d’appréhension
Elles consistent en la réalisation de contraintes sur
l’épaule créant une imminence d’instabilité (sans pour
autant aller jusqu’à la luxation…!) ce qui occasionne
chez le patient une vive appréhension et la reproduction
de ses symptômes caractéristiques.
- le test de “l’armer du bras” : le bras est porté en hy-
per-abduction-rotation externe tout en exerçant une
poussée postéro-antérieure prudente.
- le relocation test : ce test sensibilise le précédent et
se réalise sur un patient en décubitus dorsal. On réa-
lise le test de l’armer du bras mais en exerçant une
pression d’avant en arrière sur la face antérieure de
l’épaule ce qui doit sécuriser le patient et ôter son
appréhension caractéristique.
- le test d’appréhension inférieure proposé par Itoi est
pratiqué sur un patient debout, bras en abduction.
L’examinateur exerce une pression verticale au niveau
du col huméral ce qui peut produire un sillon sous-
acromial et une appréhension témoignant de la des-
cente de la tête humérale.
Les tests de laxité ligamentaire
Ils sont censés refléter de la résistance ligamentaire
mais prennent aussi en compte le tonus musculaire et
peuvent être perturbés par la pusillanimité du patient. Ils
peuvent néanmoins orienter le diagnostic vers un sec-
teur articulaire anormal ou une hyperlaxité.
- Le sulcus test : le bras est attiré vers le bas par une
traction axiale. Il est positif quand apparaît un sillon
sous-acromial que l’on peut quantifier et surtout com-
parer à l’autre épaule.
- Le test du tiroir : il apprécie, en position assise, la
laxité de l’articulation par la recherche d’un tiroir an-
téro-postérieur en adduction et relâchement du bras
le patient étant penché en avant, le bras pendant.
- Le test de laxité inférieure de Gagey : c’est la recher-
che comparative d’une hyper-abduction passive. Il
est positif si elle dépasse 105° et est supérieure de
20 à 30° à l’épaule controlatérale. Nous notons aussi
dans notre examen la qualité de l’arrêt (dur ou mou) et
l’appréhension que cela génère chez le patient. Olivier
Gagey a montré que ce test signait l’élongation spéci-
fique du LGHI.
Fig. 5 : IRM postcritique mettant en évidence une lésion labrale type
Bankart (tête de flèche) et une contusion œdémateuse de la tête humé-
rale (flèche).
IL MANQUE
LA TÊTE DE
FLÈCHE
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%