L`éthique médicale d`hier, d`aujourd`hui et de demain

L’ÉTHIQUE MÉDICALE D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
Par Heather MacDougall, PhD, and G. Ross Langley, MD
RÉSUMÉ
Objectif
Depuis l’Antiquité, toutes les sociétés ont eu à faire face à des problèmes de santé qui ont mené à la formation de groupes de guéris-
seurs et à l’élaboration de codes de déontologie pour régir les traitements dispensés. Les serments que prêtent les médecins et les
codes de déontologie sont un amalgame des préceptes moraux, des comportements normatifs et des obligations sociales de la civilisa-
tion dans laquelle ils sont appliqués, et ils évoluent parallèlement à l’émergence de nouveaux traitements médicaux et de nouveaux
enjeux sociaux. Le présent document a pour but d’illustrer comment chaque société – de la Mésopotamie à notre société moderne – a
lutté pour élaborer des codes de déontologie pour ses étudiants en médecine et ses cliniciens, et de montrer pourquoi cette tâche est
sans cesse à recommencer.
L’étude de l’histoire de l’élaboration et de l’application des serments ainsi que des codes de déontologie nous permet de comprendre
comment d’autres sociétés ont abordé les questions éthiques. Cependant, pour être en mesure de bien comprendre, il faut recon-
naître les différences sociales, culturelles, comportementales, économiques et politiques qui existent entre le XXIe siècle et les siècles
précédents. Le document est divisé en trois sections, comme suit : « Jeter les bases » qui examine les premières sociétés et leurs tenta-
tives en vue de définir l’enseignement ainsi que l’exercice de la médecine, « La professionnalisation de la médecine et les codes de
déontologie » qui examine le processus de la professionnalisation et comment les médecins du Canada ainsi que leurs associations ont
été influencés par les codes de déontologie britanniques et américains, et enfin, la « Médecine moderne et les questions éthiques »
qui examine la progression de la bioéthique, la sécularisation de la société, le rôle de l’État et la transformation de l’exercice de la mé-
decine sous l’effet des nouvelles technologies, de l’innovation scientifique, du multiculturalisme et du regain d’intérêt du public pour
l’initiative personnelle et les médecines parallèles. Tout comme l’ont fait avant nous les guérisseurs à travers les époques, il est essentiel
de s’interroger sur nos croyances personnelles, de lire la version actuelle du Code de déontologie de l’Association médicale canadienne
(www.cma.ca), puis de discuter avec des collègues, des amis et des patients du rôle prépondérant de l’éthique dans l’enseignement et
l’exercice de la médecine.
Jeter les bases
Chaque société – depuis la Mésopotamie, l’Égypte ancienne, la Grèce hellénique, l’Inde, la Chine, les débuts de l’Empire ottoman et
l’Europe pré-Renaissance – a défini ses attentes face aux comportements des médecins, en s’appuyant sur les croyances religieuses ou
spirituelles, les connaissances médicales et les pratiques de guérison propres à son époque. Ce sont toutefois les Grecs qui ont défini
le plus clairement les principes éthiques dont s’est inspirée la médecine occidentale, qui sont la bienfaisance, la confidentialité et les
mises en garde contre toute action qui porterait préjudice au patient. Le serment d’Hippocrate ne faisait toutefois nullement allusion à
la rémunération des services, car la société grecque vénérait davantage l’honneur personnel que la richesse. De là est née la « dualité
paradoxale du conflit entre l’altruisme et l’intérêt personnel » qui, selon les éthiciens médicaux comme Albert Jonsen, est le fonde-
ment des codes de déontologie occidentaux.
Ce conflit est né de la séparation de l’église et de l’État au Moyen Âge. À cette époque, seules la royauté, l’aristocratie et les classes
supérieures mieux nanties avaient généralement les moyens d’obtenir des services médicaux, tandis que les commerçants de la classe
moyenne, les travailleurs des villes, les ouvriers agricoles, les paysans, les serfs et les pauvres devaient compter sur les remèdes mai-
son, les astrologues, les ramancheurs, les barbiers-chirurgiens ou la charité des praticiens dûment formés. Bien que les ordres religieux
aient commencé à dispenser des soins par charité au début de l’ère chrétienne, ce modèle d’altruisme différait de celui des confréries
médiévales qui dispensaient des soins contre rémunération. La médecine était-elle un métier au même titre que l’orfèvrerie? Quels
fondements éthiques existaient alors, et par qui étaient-ils définis? Était-il tout simplement sous-entendu que les principes chrétiens de
bienveillance et de charité auraient préséance ou existait-il un code de déontologie précis?
La professionnalisation de la médecine et les codes de déontologie
Avec l’avancement scientifique des connaissances médicales durant la Renaissance et le siècle des Lumières, on a commencé à ob-
server une professionnalisation de l’enseignement et de l’exercice de la médecine, laquelle a revendiqué le droit à l’autoréglementation
fondée sur l’expertise. Cette transition, d’un programme d’apprentissage à une formation officielle dispensée dans les universités
ou les écoles spécialisées de médecine aux XVIIIe et XIXe siècles, a amené les chefs de file de la médecine à reconnaître le besoin de
définir les valeurs fondamentales devant guider les praticiens et les étudiants, et cette prise de conscience a mené à l’élaboration des

premiers codes de déontologie officiels par John Gregory (1725-1773) et Thomas Percival (1740 1804). Leurs travaux ont fourni à un
grand nombre de médecins américains et canadiens partis étudier à Edinburgh et à Londres les fondements intellectuels à partir des-
quels ont été élaborés les codes de déontologie des associations médicales américaine et canadienne, créées respectivement en 1847
et 1867. Partant du principe que la médecine était une vocation altruiste, ces codes insistaient sur le concept de l’obligation fiduciaire
et sur le partage des responsabilités entre les médecins, les patients et la société, et ils avaient pour but de définir les comportements
des praticiens et de créer une identité collective cohésive.
Cependant, de nombreux commentateurs considéraient à l’époque, et considèrent toujours, que ces codes étaient des expressions
paternalistes (et souvent misogynes) de l’intérêt personnel, élaborés principalement dans le but de protéger les médecins de la concur-
rence et de la surveillance externes de la part des non-initiés et de l’État. D’autres, au contraire, ont allégué que les principaux élé-
ments de ces codes rappelaient l’insistance accordée à la bonne moralité, au savoir scientifique, aux compétences techniques et à la
compassion dans le serment d’Hippocrate. L’opposition entre ces deux points de vue est clairement apparue à la fin du XIXe siècle,
lorsque l’American Medical Association et l’Association médicale canadienne (AMC) ont toutes deux entrepris d’éliminer les praticiens
sectaires et d’améliorer la formation ainsi que les comportements professionnels. La formation médicale est devenue essentiellement
dispensée dans les universités et, grâce à la recherche qui a permis d’obtenir la prophylaxie, les antibiotiques et les vaccins ainsi que les
nouvelles techniques chirurgicales et technologies diagnostiques, la médecine a acquis au milieu du XXe siècle le statut et le prestige
depuis longtemps espérés. Cependant, tous ces changements ainsi que la mise au jour des horreurs commises dans les camps de la
mort nazis et des expériences japonaises réalisées sur les populations en captivité ont mené à la révision des codes de déontologie, afin
qu’ils reflètent les préoccupations modernes, de même que l’incidence des nouveaux traitements et des innovations technologiques.
La médecine moderne et les questions éthiques
Le succès de la médecine a amené les pays d’Europe de l’Ouest et le Canada à soustraire l’exercice de la médecine du domaine com-
mercial et à en faire une profession régie par des politiques publiques, avec la mise en place d’hôpitaux, de services médicaux et de
services diagnostiques financés par l’État durant les années 1950 et 1960. Seuls les États Unis n’ont pas réussi à établir de programmes
de soins de santé universels pour leurs citoyens. En considérant les services médicaux comme un « bien public », les gouvernements
canadien et européens ont créé un contrat social entre leurs citoyens et la profession médicale. Cependant, de nombreux médecins
ont continué de faire valoir que leur code de déontologie les obligeait à défendre le caractère sacré de la relation médecin patient con-
tre toute intrusion par des tiers, et ceci a mené, durant les années 1960 et 1970, à des grèves et à des arrêts de travail qui ont soulevé
des questions éthiques et mené à d’autres révisions du Code de déontologie de l’AMC.
Le profil ethnique du Canada a lui aussi évolué depuis 1960. Ceci a eu une incidence non seulement sur l’enseignement de la méde-
cine, mais aussi sur les relations médecin-patient, et les codes de déontologie ont commencé à insister sur le consentement éclairé,
sur les communications efficaces ainsi que sur le respect des points de vue des membres de l’équipe, des patients et de leur famille. La
bioéthique est devenue un volet important de l’enseignement et de l’exercice clinique de la médecine, pour répondre aux préoccupa-
tions soulevées par la population et les professionnels au sujet de différents enjeux tels que la santé génésique, l’insuffisance rénale
chronique au stade ultime, la transplantation, la répartition des tomodensitogrammes et des appareils de tomographie par émission
de positons, les soins en fin de vie, le soulagement de la douleur, le commerce des organes humains, l’euthanasie ainsi que les rela-
tions des médecins avec l’industrie pharmaceutique, puis l’AMC et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada ont tous
deux cherché à intégrer les questions d’ordre éthique à l’enseignement et à l’exercice de la médecine. Le présent document traduit
le sentiment selon lequel la compréhension des origines historiques des codes de déontologie modernes permettra aux étudiants et
aux médecins de comprendre leur place dans l’histoire et de reconnaître que la définition des normes éthiques évolue parallèlement à
l’évolution des mœurs sociales ainsi que des nouvelles découvertes scientifiques qui augmentent ou limitent notre capacité de préve-
nir, de guérir ou de soulager des maladies.
La médecine a toujours été au carrefour de la science et de la société, étant pratiquée à la fois comme un art et une profession. Il est
important de débattre et de discuter des considérations éthiques durant la formation médicale et de poursuivre ces discussions tout
au long de sa carrière, car ces considérations sont le fondement de ce qui constitue l’art de traiter avec les patients et d’un exercice
efficace de notre profession. Les codes de déontologie d’aujourd’hui traitent, dans un langage moderne, de bon nombre des enjeux
qui se posaient déjà dans la Grèce ancienne. Ils reflètent également les efforts visant à codifier l’essence de la rencontre clinique entre
le médecin et le patient, tout en insistant sur l’importance de la compassion, de la bienfaisance, de la non-malveillance, du respect de
la personne et de l’obligation de rendre compte.
1
/
2
100%
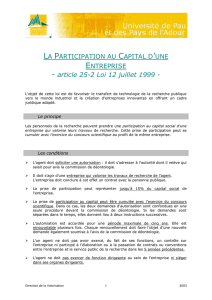
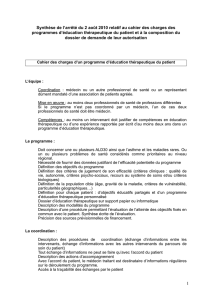
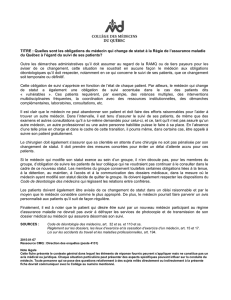

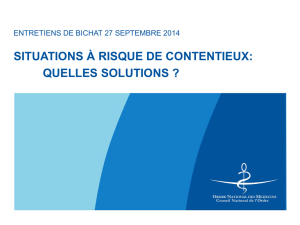
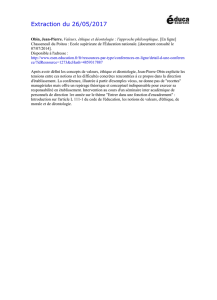
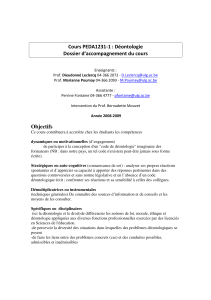
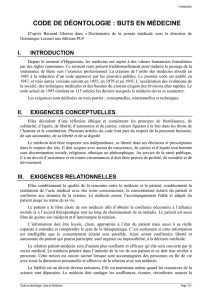
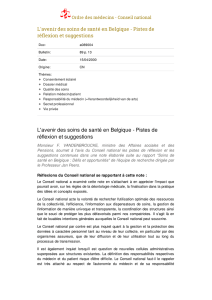
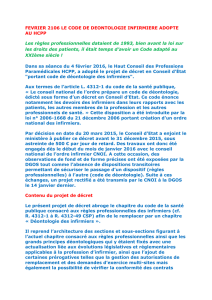
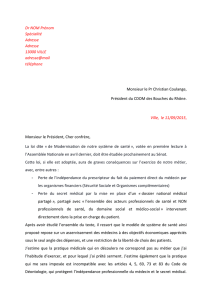
![Définitions Déontologie et éthique[1], définitions[2] Déontologie](http://s1.studylibfr.com/store/data/001335044_1-0083abd339e5282bb622b85ac470652f-300x300.png)