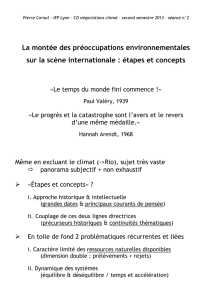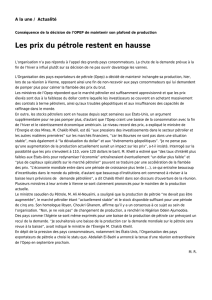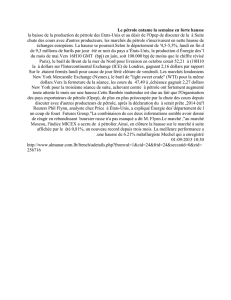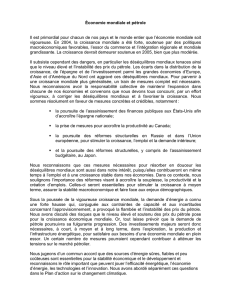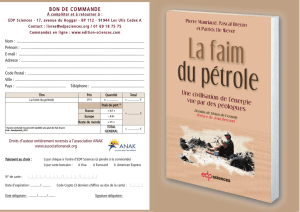GEOECONOMIE DU PETROLE ET MUTATIONS DE L

228
GEOECONOMIE DU PETROLE ET MUTATIONS DE
L'ECONOMIE MONDIALE.
SOUAK Arezki
Maître de conférences
Ecole des Hautes Etudes Commerciales - Koléa
RESUME
Cet article contient une réflexion sur la géo économie du pétrole et les
mutations de l'économie mondiale. Il vise à mettre en rapport les
transformations économiques et géopolitiques et l'analyse géoéconomique.
Depuis 1945, l’économie mondiale a subi des transformations importantes et
davantage avec l'implosion du bloc de l'est (1991) .Le pétrole ayant joué un
rôle important dans la mécanisation de la guerre ainsi que dans la
reconstruction de l'Europe. Il a suscité depuis un intérêt stratégique et
continue de le faire avec la mondialisation .C'est pour cette raison, que le
contrôle de cette ressource reste au centre des relations internationales. Les
USA, en tant qu'hyper puissance, développent une stratégie globale pour
conserver leur hégémonie sur cette ressource, en contrôlant son marché, en
réduisant le poids de l'OPEP, en développant de nouvelles technologies
d'exploration et de production et même en recourant à des moyens militaires.
Mots-clés : Géo économie, Pétrole, rivalités commerciales, OPEP.
Introduction
Après une période de croissance ininterrompue depuis la fin de la 2ème
Mondiale, l'économie américaine est entrée en crise en … 1965.La
reconstruction de l'Europe, selon le modèle keynésien ,la promotion de la
société de consommation et des loisir sont permis une croissance
économique qui s'est essoufflée à la fin des années 1960.La recherche d'un
nouveau modèle de croissance a contraint les grandes entreprises de ces deux
grandes régions à se restructurer pour se concentrer d'abord sur leurs métiers
de base, puis à se redéployer sur de nouveaux espaces de valorisation. Cette
crise constitue nous semble-t-il, le facteur explicatif du passage de la
géopolitique à la géo économie. La fin de la Guerre Froide libère les FMN et
met fin aux zones d'influence économique .Les rivalités économiques
remplacent les rivalités territoriales. Le pétrole constituant un élément
important de la compétitivité, son contrôle donne à son détenteur, un pouvoir
ou plutôt une "carte maîtresse", dans la compétition internationale. Ces
éléments de réflexion seront abordés dans un premier point consacré à
l’analyse des mutations de l’économie mondiale depuis son entrée en crise.
Dans le second point, nous analyserons la stratégie américaine de contrôle
du secteur pétrolier.

229
I - Les Mutations de l’économie mondiale
L’économie mondiale a subi des transformations importantes depuis la fin
de la 2ème Guerre Mondiale. La crise qui l'a affecté, surtout dans les régions
du capitalisme central, a complètement transformé le paysage économique et
social. Cette crise constitue le facteur explicatif du passage de géopolitique à
la géo économie. Ce passage engagé à la suite du 1er choc pétrolier, a été
conforté par la chute du Mur de Berlin en 1989 et l’implosion du bloc
soviétique en 1991.Pour comprendre les mutations de l’économie mondiale
depuis les années 1980, il faut remonter à la fin de la 2ème Guerre Mondiale.
En effet, la reconstruction de l’Europe et du Japon selon le modèle
Keynésien a permis à tous ces pays d’avoir durant 30 ans des taux de
croissance économique atteignant les 6% par an. Cette croissance
économique qui a été encore plus importante aux USA marque le pas dès
1965 dans ce pays et en 1969 en Europe. La stagflation domine les années
70. Un taux de profit en berne avec épuisement du modèle de croissance ne
peut qu’entraîner un ralentissement de la croissance : la seule solution est
d’accumuler moins avant de changer le modèle de croissance. C’est ce qui se
produira durant les années Reagan où les services deviennent un nouveau
relais de croissance au détriment de l’industrie dans le cadre d’une
croissance patrimonialisée pays. Les pays européens ont suivi la même
tendance avec un léger décalage de deux à trois ans. Durant la période qui
suit les années Clinton, on assiste à un redressement du taux de profit, dans
un monde entièrement transformé par ce que l’on va appeler la
"Mondialisation". Rappelons que c'est pour montrer le passage de l'économie
industrielle à celle post industrielle que nous avons consacré les sections 1 et
2, à cette longue période de transformation de l'économie mondiale.
Section 1 - La période des "30 glorieuses" et l'industrialisation de
l'Europe.
"Les 30 glorieuses" décrivent une longue période de croissance
économique qui transforma fondamentalement l’économie française et celle
des principaux pays d'Europe de l'Ouest. La croissance économique était de
l’ordre de 4,1 % en moyenne de 1945 à 1969. Un tel niveau, n’a jamais été
obtenu même pendant la 1ère mondialisation (1870-1914) où elle n’a que
rarement dépassé 2%.Les années de forte croissance sont le produit d’un
ensemble de circonstances exceptionnelles, dont les trois composantes
majeures sont les dépenses publiques, la société de consommation et des
loisirs et la Guerre Froide(1). Tous les pays européens ont connu une
augmentation continue de tous les grands agrégats économiques (PIB ;
FBCF ; croissance du commerce extérieur, plein emploi, croissance
démographique (baby-boom) etc.). Autrement dit, ils connurent le
développement, c’est-à-dire des changements sociaux et culturels qui
1 La 2ème Guerre Mondiale et la Guerre Froide ont renforcé le complexe militaro-
industriel dénoncé par le président Eisenhower.

230
rendent possible l’accroissement des quantités produites sur le long terme. Il
faut rappeler à ce niveau, que cette croissance économique était corrélée à la
consommation d’énergie et particulièrement du pétrole dont le prix était très
bas, du fait de la domination des grandes firmes pétrolières sur l’industrie
pétrolière (Seven Sisters : Exxon, Chevron, Mobil-Oil, Texaco, Gulf-Oil,
Royal Dutch Shell et British Petroleum.).
Pour de nombreux économistes, cette croissance "exceptionnelle" est due
également aux bienfaits de l’ouverture commerciale (approche ricardienne)
et aux découvertes scientifiques réalisées durant la Guerre. En effet,
l’ouverture commerciale dans le cadre des Rounds du (GATT General
Agreement on Tarifs and Trade) a permis un fort développement des
échanges internationaux. . La consommation forte des Trente Glorieuses est
favorisée par la consommation de masse qui est guidée par les entreprises.
JK Galbraith montre que les entreprises jouent sur la consommation car elles
utilisent la publicité, le marketing afin d’influencer le choix du
consommateur.
Section 2 - La période des "30 piteuses " et l’économie postindustrielle
Les années 70 marquent la fin des Trente Glorieuses et l’apparition d’une
crise désignée de "Trente Piteuses" en France. La crise apparaît d’abord
comme une crise classique, c'est à dire une récession qui se traduit par le
recul des productions industrielles, la baisse du commerce international, et
dès 1975 une forte crise dans la sidérurgie causée par une augmentation de
l’offre en provenance des N.P.I.Contrairement à la période précédente celle-
ci se caractérise par une croissance économique molle d’environ 2%, une
baisse de l’investissement, une fluctuation de la demande et l’apparition
d’un chômage de masse. C’est le début d’une crise systémique du
capitalisme plus structurelle que conjoncturelle, avec la progression de
problèmes tels que : le chômage, l’inflation. Nous assistons comme le
montre le graphe suivant aux USA d’abord (1965), puis en Europe (1969) à
une baisse des profits des entreprises qui va durer jusqu’en 1982-1983. C’est
cette baisse importante des profits, une des causes structurelles de la crise,
qui conduit les firmes multinationales à se restructurer en retournant d’abord
à leur cœur de métier en externalisant une part de plus en plus importante de
leurs activités. Cette externalisation a profité d’abord aux pays dont la main
d’œuvre est qualifiée et bon marché. Ce fut d’abord dans les années 1970,
les "dragons" du Sud-est asiatiques (Corée du sud, Taïwan, Hong-Kong,
Singapour) suivi dans les années 1980, par les "tigres" de la même région
(Philippines, Indonésie, Malaisie, la Thaïlande). Depuis les années 1995 ce
sont les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui
apparurent comme pays émergents exportateurs.
Les entreprises vont réduire leurs coûts en commençant par la réduction de
la masse salariale par l'introduction des technologies d’automation.
Mais depuis1980, un phénomène nouveau apparait : le développement de
l’activité des entreprises financières dont les profits augmentent alors que

231
ceux des entreprises industrielles stagnent ou reculent comme le montre le
graphe suivant aux Etats-Unis. Cette évolution montre la financiarisation de
plus en plus importante de l’économie mondiale où les activités financières
s’autonomisent par rapport à l’activité industrielle grâce à la spéculation sur
tous produits financiers mais également sur les ressources naturelles.
Figure 1 - Evolution des profits des entreprises américaines non-financières
et financières en % du PIB depuis 1960
Source: Bureau of Economic Analysis
http://www.bea.gov/industry/gpotabl....
Mais pour la première fois la crise combine le chômage et l’inflation
(>10% en 1975) : c’est la stagflation qui résulte à la fois de la baisse de
l'activité économique et d'une hausse de l'inflation. De plus le système
monétaire international se dérègle et déstabilise l’économie mondiale. En
1971, les États-Unis connaissent leur premier déficit commercial du siècle.
En août 1971, le président Nixon décide de suspendre la convertibilité en or
du dollar. Le dollar est dévalué en 1971 et 1973. Pour lutter contre l’inflation
les gouvernements renchérissent le crédit et alourdissent la fiscalité : la
croissance ralentit. Le dollar baisse entre 1976 et 1980, pour remonter entre
1980 et 1985 et baisser à nouveau depuis. Ce dérèglement du S.M.I. gêne
considérablement l’activité économique et favorise la progression du
chômage. Par ailleurs, les années 1970 ont été profondément marquées par
les chocs pétroliers (2) où tout s’est ordonné autour des pays pétroliers qui
2 La Guerre du Kippour d’octobre 1973 conduit l’O.P.E.P. à quadrupler les prix du
pétrole ce qui ne manque pas d’alourdir la facture des importations et relancer par la

232
grâce à la croissance de leurs revenus sont devenus des acheteurs
internationaux de premier plan.
Mais la reprise fragile de la croissance de l’économie mondiale à partir de
1976, s’accompagne d’un développement de l’endettement : les pays
exportateurs de pétrole placent les " pétrodollars " dans les banques
occidentales qui les prêtent aux PVD. La soudaine détérioration des termes
de l’échange et le recyclage des pétrodollars ont bouleversé les priorités. Les
producteurs du Moyen-Orient, de l’Afrique du Nord, du Venezuela, le
Mexique et l’Indonésie sont devenus les principaux objectifs de la
diplomatie économique. La crise de la dette des PVD d’abord et le contre-
choc pétrolier ensuite, ont engendré dans les années 1980, une grande
réserve vis-à-vis de ces marchés nouveaux considérés comme des marchés à
haut risque. Le contexte des années 1990 est caractérisé par la crise en
Europe donc une contraction des débouchés et par un décollage des pays du
Sud et du Sud-est asiatique ainsi qu’une partie de l’Amérique Latine
destinées à occuper une place de plus importante dans les futurs débouchés.
A ces pays se sont ajoutées les anciennes démocraties de l’Europe de l’Est
qui s’ouvrent à l’économie de marché. Une nouvelle reconversion s’est donc
opérée en direction de ces nouveaux marchés.
Dans les décennies 1980 et 1990 ont avait cru que l’électronique,
informatique, l’automation pouvaient devenir de nouveaux moteurs de la
croissance. Mais avec la conjoncture nouvelle les grandes firmes ont opté
pour des stratégies d’externalisation et un "recentrage sur leur métier" défini
par les compétences distinctives que possède la firme.
Le dernier volet des mutations structurelles du commerce mondial est lié
au développement du commerce et des services, qui prennent une part
croissante. Les échanges de services ont augmenté plus rapidement que les
échanges de marchandises entre 1980 et 2012. En effet, si les échanges de
marchandises ont été multipliés par 911%, ceux des services l'ont été de
1129%.
Tableau 1 - Evolution des exportations mondiales de biens et services
En milliards de $
1980
2007
2012
Exportations de biens
2034
13898
18 528
Exportations de services
365
3257
4120
Source : http://wdi.worldbank.org/table/
Le commerce des services comme celui des produits manufacturés
renforce la position des pays développés qui représentent 50% des premiers
exportateurs et importateurs de services au monde. L’Europe, l’Amérique du
Nord et l’Asie concentrent 92% des exportations mondiales de services" (3).
même l’inflation. Mais en sait aujourd'hui, que le gouvernement américain, devant la
nouvelle concurrence européenne et japonaise, a instruit l'Arabie Saoudite et l'Iran
du Shah pour augmenter, lors de la réunion de l'OPEP à Téhéran, le prix du pétrole.
3 DELAS J.P "Economie contemporaine" Ed. Marketing – Paris 2008 p.356
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%