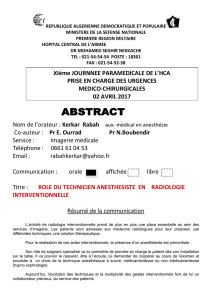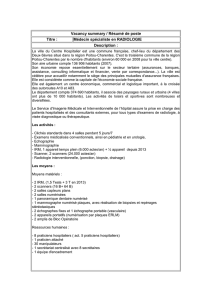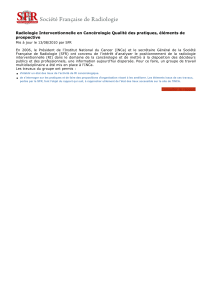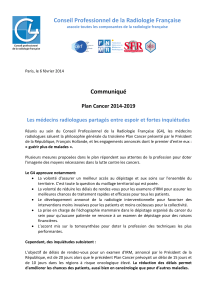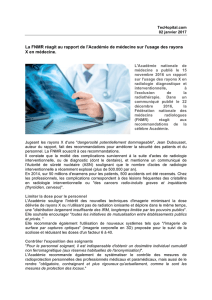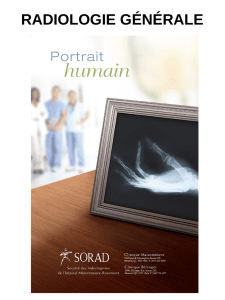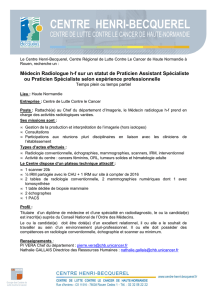Coopération public/privé en radiologie

74
N° 537 - Novembre - Décembre 2010
Réflexions hospitalières
Le pôle imagerie de l’hôpital de
Bayonne comprend un service de
médecine nucléaire et deux
services de radiologie. Le premier est
équipé notamment d’un PET-Scan et d’un
Spect-CT, le second de deux IRM (dont
une en groupement d’intérêt écono-
mique), deux scanners, une unité de
sénologie complète, et un bloc de radio-
logie interventionnelle. Au sein de ce pôle,
quinze praticiens hospitaliers exercent leur
activité: trois en médecine nucléaire,
douze en radiologie.
Les différents groupes de radiologie
libérale du Pays basque et du sud
des Landes exercent en cabinets
privés ou en clinique. Ils sont fédé-
rés, pour les équipements des moda-
lités en coupe (IRM, scanner), en
une société unique : le centre d’ima-
gerie médicale du Pays basque. Le
CIMPB détient les autorisations, à
savoir un scanner et une IRM
implantés à Bayonne, une IRM en
GIE à l’hôpital, et un scanner à Saint-
Jean-de-Luz.
Les échanges entre la direction de l’hô-
pital, les praticiens du service de radio-
logie et les radiologues libéraux sont
anciens, de sorte qu’une relation de
confiance s’est instaurée depuis de
nombreuses années. Ce climat favo-
rable a permis l’élaboration de plusieurs
projets communs.
Cette coopération public/privé s’articule
globalement autour de trois axes: l’uti-
lisation conjointe des IRM, la radiologie
interventionnelle et la sénologie.
Groupement d’intérêt
économique : IRM
Le partenariat entre l’hôpital et le secteur
privé dans le domaine de l’IRM a été
initié en 1992. À cette époque, la
première IRM avait été installée à
Bayonne et l’activité était partagée sur
le mode de la co-utilisation, sous forme
d’une convention entre le secteur libéral
et le service de radiologie hospitalier.
La co-utilisation a depuis été remplacée
par un GIE 50/50. Ce GIE est détenteur
de l’autorisation pour une première
machine. Une deuxième autorisation
est en cours d’instruction. La première
IRM étant une machine standard, il est
envisagé que la seconde soit - sous
réserve d’autorisation - une machine
différente, avec tunnel plus large (claus-
trophobie, pédiatrie…).
L’hôpital détient une autre IRM installée
dans le service de radiologie des
Dr David HIGUÉ
Chef du pôle imagerie
Dr Frédéric MARTINEAU
Président de la CME
Centre hospitalier de Bayonne
Coopération
public/privé en radiologie
Retour d’expérience
du territoire de santé de Bayonne
L’hôpital et les acteurs libéraux du centre d’imagerie
médicale du Pays basque (CIMPB) conduisent depuis 1992
des actions de coopération dédiées au développement
des outils radiologiques. Utilisation conjointe d’IRM,
radiologie interventionnelle et sénologie sont les trois axes
forts de cette coopération public/privé qui garantit
un plateau technique de qualité à la population du territoire
de santé de Bayonne. Trois années de recul
de cette expérience bayonnaise offrent une perception
assez claire des limites et avantages du dispositif. L’activité
s’est développée et, pour chacun des acteurs, les bénéfices
sont réels, sans négliger un certain nombre de difficultés.
56_75_RH_RHF537_ReflexH_RHF 03/12/10 14:18 Page74

75
N° 537 - Novembre - Décembre 2010
Revue hospitalière de France
urgences. Cette IRM va évoluer, et l’au-
torisation de transformation en 3 Testas
(3T) a été validée par l’agence régionale
de santé. Des plages seront proposées
aux acteurs libéraux sous forme de co-
utilisation à l’installation de cette IRM 3T.
Plusieurs avantages et inconvénients
ressortent de ce partenariat.
>> Autorisations facilitées
et accès aux équipements
En matière d’offre de soins, cette poli-
tique de coopération facilite l’obtention
des autorisations auprès des tutelles.
Sur le plan médical, la gestion du
parc IRM permettra à n’importe quel
acteur, radiologue hospitalier ou libé-
ral, l’accès à trois machines diffé-
rentes sur un même plateau (IRM
conventionnelle, IRM avec un tunnel
large, IRM 3T), répondant à des
situations cliniques distinctes. Par
conséquent, n’importe quel patient du
territoire de santé, quel que soit son
point d’entrée dans le réseau local de
radiologie, aura accès à ces diffé-
rentes modalités de prise en charge.
>> Complexité du GIE, code des
marchés et défis techniques
Complexe, le fonctionnement d’un GIE
exige un travail de mise en place très
précis et un travail d’ajustement régu-
lier (lors de l’acquisition d’une nouvelle
machine : processus du choix, d’instal-
lation, définition de l’enveloppe).
Le processus d’acquisition et le code
des marchés relèvent par ailleurs de
deux pratiques différentes, qu’il faut
appréhender et anticiper. Par ailleurs,
des défis techniques sont à relever. Il
s’agit de faire communiquer une
machine avec deux systèmes d’infor-
mation radiologiques, et deux réseaux
d’images. Et l’absence d’identifiant
unique du patient ne permet pas le
regroupement des images au sein d’un
dossier commun partagé.
GCS de radiologie
interventionnelle
À côté du groupement d’intérêt écono-
mique de l’IRM, un groupement de
coopération sanitaire (GCS) a été mis
en place depuis 2008 avec les radio-
logues du secteur libéral.
Sur le plan juridique, ce GCS struc-
ture un partenariat entre l’hôpital et
certains praticiens du secteur libéral,
à titre individuel (et non au titre de la
société dans laquelle ils exercent).
Le primum movens est le suivant: l’hô-
pital détient une salle de radiologie
vasculaire qu’il ouvre à un praticien libé-
ral. Celui-ci retrouve un accès à du
matériel sophistiqué. L’hôpital accroît
son activité, et la salle de radiologie
vasculaire évolue vers un véritable bloc
de radiologie interventionnelle.
Le principe de fonctionnement est
simple : un patient est pris en charge
dans un circuit libéral au sein d’un
réseau multidisciplinaire (chirurgien,
oncologue, radiothérapeute, radio-
logue…). Ce patient est accueilli à l’hô-
pital à l’occasion d’une intervention
radiologique. L’intervention est alors
pratiquée par le radiologue libéral, au
bloc interventionnel de l’hôpital de
Bayonne. Le patient est hospitalisé pour
la durée nécessaire à ce type d’inter-
vention. Les éventuelles complications
sont gérées à l’hôpital, puis ce patient
retourne dans le circuit multidiscipli-
naire libéral qui le suit habituellement.
L’hôpital perçoit la rémunération du
groupe homogène de séjour (GHS). Ce
montant permet de financer les diffé-
rents frais inhérents à la prise en charge
hospitalière. Une partie sert également
à rémunérer le praticien libéral confor-
mément à la cotation CCAM, secteur 1.
>> Frais couverts et augmentation
d’activité pour l’hôpital
Le montant du GHS couvre en général
les frais d’une courte hospitalisation, et
l’hôpital ne perd pas d’argent. À titre
d’exemple, les études médico-écono-
miques réalisées à Bayonne sur les
gestes de radiofréquence et de chimio-
embolisation hépatique montrent que la
recette couvre les frais engagés. En outre,
l’hôpital bénéficie d’une augmentation
significative de son activité et dispose de
plus de moyens pour accompagner le
développement de la radiologie inter-
ventionnelle - ce développement appa-
raissant inéluctable. L’augmentation des
moyens alloués à la radiologie inter-
ventionnelle bénéficie également aux
praticiens hospitaliers exerçant cette acti-
vité.
>> Prise en charge adaptée
du patient
Le patient est aussi bénéficiaire de ce
système: il est pris en charge dans un
service adéquat (service de gastro-enté-
rologie pour une chimio-embolisation
hépatique, service de gynécologie pour
une embolisation de fibrome utérin,
service de chirurgie thoracique pour une
radio-fréquence thoracique…). Les
équipes de soins de ces services sont
formées à la radiologie interventionnelle,
puisque d’autres patients sont pris en
charge par les praticiens hospitaliers
pour ce type de pathologie. Le patient
bénéficie des protocoles mis en place
au sein de l’institution, avec une équipe
médicale et paramédicale adaptée à sa
pathologie. L’hôpital n’assure pas
simplement un hébergement, mais une
véritable prise en charge de ces
patients. Cet aspect est important. Il a
nécessité une information préalable des
médecins responsables des structures
de soins et une adhésion de leur part.
Il n’est bien sûr pas envisageable de
monter un tel projet sans eux.
L’hôpital bénéficie d’une augmentation
significative de son activité et dispose
de plus de moyens pour accompagner
le développement de la radiologie
interventionnelle - ce développement
apparaissant inéluctable.
<<
Coopération public/privé en radiologie
Retour d’expérience du territoire de santé de Bayonne
Librairie Offres
d’emploi Réflexions
hospitalières Droit et
jurisprudence Pertinence
des actes Sur le web Le virage
ambulatoire… Actualités
56_75_RH_RHF537_ReflexH_RHF 03/12/10 14:18 Page75

76
N° 537 - Novembre - Décembre 2010
Réflexions hospitalières
>> Environnement dédié
et rémunération correcte
pour le praticien libéral
Troisième bénéficiaire : le praticien
libéral. Celui-ci peut intervenir à l’hô-
pital avec une rémunération correcte,
à la différence des systèmes de vaca-
tions pour praticiens attachés, mal
rémunérés et non adaptés à une
collaboration privé/public. Ce prati-
cien intervient dans un bloc de radio-
logie interventionnelle, installé dans
un bloc central, avec toute la logis-
tique inhérente. L’accès aux anes-
thésistes est garanti. L’équipe para-
médicale est une équipe dédiée,
formée et rompue aux pratiques de la
radiologie interventionnelle. La table
de radiologie interventionnelle est
très récente avec une technologie
high-tech, scanner rotationnel en
particulier.
>> Activité en augmentation
En termes de chiffres, 148 actes de
radiologie interventionnelle ont été
effectués par les médecins libéraux en
2008, sur les 782 de l’ensemble, soit
19 % de l’activité globale. Les résultats
2009 s’améliorent, avec 1001 actes
au global, dont 29 % pour les libéraux.
Le principe est donc attractif puisque,
d’une part, l’activité des libéraux repré-
sente un pourcentage non négligeable
de l’ensemble et, d’autre part, elle
augmente significativement. On voit
aussi se développer l’activité hospita-
lière (634 actes en 2008, 712 en
2009), ce qui représente une crois-
sance naturelle de la radiologie inter-
ventionnelle.
Un certain nombre de difficultés sont
à signaler, trois années de recul de
cette expérience bayonnaise offrant
une perception assez claire des limites
du dispositif.
>> Déplacements chronophages
Le premier problème est lié, pour le
praticien libéral, à l’exercice d’une
pratique en dehors de son lieu d’exer-
cice habituel. Le praticien se déplace
une première fois pour effectuer l’acte.
Il revient au chevet de son patient le
lendemain, voire une nouvelle fois
pour gérer sa sortie avec les médecins
du service hospitalier. Ces allers-
retours à l’hôpital sont chronophages :
il est beaucoup plus simple de gravir
deux étages dans la clinique dans
laquelle on travaille au quotidien.
>> Aspect concurrentiel
Le deuxième désavantage est lié à l’as-
pect concurrentiel entre secteur privé
et secteur public. Les différents acteurs
de l’hôpital doivent absolument veiller
à ce que le patient, pris en charge
temporairement à l’hôpital dans le
cadre du GCS, regagne le circuit libé-
ral par la suite, au risque de mettre en
péril cette coopération.
>> Engagement du radiologue
libéral et organisation du bloc
Le troisième inconvénient est l’ab-
sence, en tout cas à Bayonne, de défi-
nition d’un engagement minimum pour
le radiologue libéral. Il n’est pas simple
d’organiser une plage dédiée à l’acti-
vité du GCS dans un bloc de radiolo-
gie interventionnelle, qui comporte une
équipe complète paramédicale et une
équipe d’anesthésiste. Si le praticien
libéral se désengage du GCS pour une
raison ou une autre, cette plage reste
vacante.
Co-utilisation d’une table
de stéréotaxie mammaire
Le centre hospitalier de la Côte basque
s’est doté, voici six ans, d’une table
destinée à la réalisation de macro-
biopsies de sein. Il s’agit d’un matériel
coûteux mais indispensable dans l’ar-
senal moderne du diagnostic en cancé-
rologie mammaire.
Là encore, le centre hospitalier s’est
tourné vers le secteur libéral. Les
conventions de co-utilisation signées
concernent des praticiens radio-
logues libéraux de l’agglomération
qui assurent une vacation par
semaine. Cette convention intéresse
également le centre hospitalier de
Dax. Le partage d’équipement a,
là aussi, généré une augmentation
sensible de l’activité, précieuse pour
l’amortissement de l’investissement
initial du matériel.
Cette politique de coopération
permet à l’hôpital de maintenir
l’accès à un plateau performant sur
son propre site. Et la vérité du jour est
aussi celle de la nuit, car ce plateau
joue un rôle majeur dans le cadre de
la permanence des soins. Ceci est vrai
pour l’IRM (AVC) et pour la radiolo-
gie interventionnelle (hémorragie de la
délivrance). Une réflexion est en cours
sur la mise en place d’une astreinte
interventionnelle.
La performance de ce plateau tech-
nique a par ailleurs favorisé le recru-
tement d’une équipe de radiologues
rajeunie et étoffée. Quant aux radio-
logues libéraux, ils bénéficient des
autorisations dévolues aux équipe-
ments lourds, l’autorisation étant
accordée au GIE.
Au-delà de ces aspects stratégiques,
ce rapprochement suscite respect et
confiance entre les acteurs, au même
titre que les réunions de concertation
pluridisciplinaires. Cet aspect participe
de l’ouverture de l’hôpital vers son
environnement médical. ■
Le praticien libéral intervient à l’hôpital
avec une rémunération correcte,
à la différence des systèmes de vacations
pour praticiens attachés, mal rémunérés
et non adaptés à une collaboration
privé/public.
56_75_RH_RHF537_ReflexH_RHF 03/12/10 14:18 Page76
1
/
3
100%