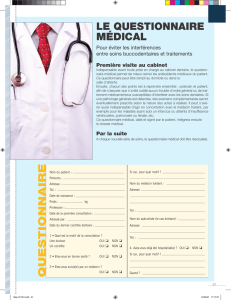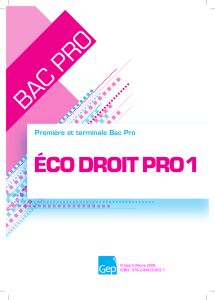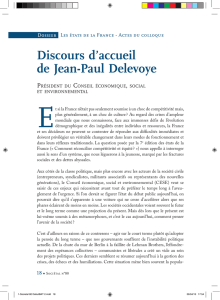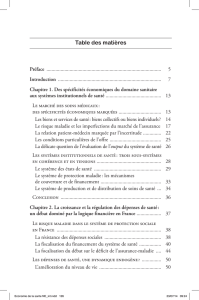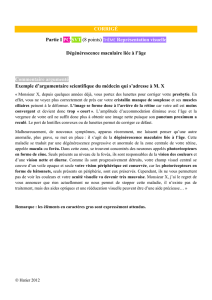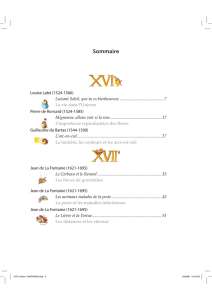Généralités sur les processus

1
Processus dégénératifs
© 2012, Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés
COMPRENDRECOMPRENDR
E
Généralités sur
les processus
1
INTRODUCTION
Ce chapitre, consacré au processus, est conçu à partir de la définition même du terme « pro-
cessus ». Cependant, il importe de préciser dès à présent que le concept retenu intègre les diffé-
rentes étapes d'un ensemble représenté par le schéma ci-dessous ( figure 1.1 ).
DÉFINITIONS
Le terme « processus », du latin pro (pour) et cessus (aller vers l'avant), indique un sens, une
marche en avant qui peut être positive, comme dans le processus d'embryogénèse, ou négative,
comme dans un processus pathologique. Ce terme désigne donc un phénomène évolutif, une suc-
cession de transformations.
Le mot processus, ou process en anglais, est un anglicisme désignant une succession de
phases toutes liées entre elles et qui se reproduisent avec régularité. Connaître le processus de
survenue d'une maladie permet de comprendre pourquoi et comment cette maladie survient, se
développe et évolue.
Conséquences
Impacts Mécanisme
physiopathologique
Axes
thérapeutiques
Un processus
= enchaînement
d’étapes Signes cliniques
= examen clinique
Conséquences
physiopathologiques
Mécanismes
physiologiques
de réparation
Diagnostic = pathologies
caractéristiques du processus
Signes paracliniques
= examens
complémentaires
Facteurs favorisants
Étiologie
Agent causal
Figure 1.1. Éléments structurants d'un processus
COMPRENDRE
0001675657.INDD 10001675657.INDD 1 10/30/2012 4:41:20 PM10/30/2012 4:41:20 PM

2
Généralités sur les processus
1
Au sens large, un processus correspond à un enchaînement organisé et ordonné de faits ou de
phénomènes actifs, répondant à un certain schéma et aboutissant à un résultat déterminé. Au
sens restreint, psychobiologique, il s'agit d'un phénomène biologique, généralement complexe, qui
met en jeu de nombreux éléments moléculaires, cellulaires et/ou tissulaires dans l'organisme. Le
développement d'un processus s'inscrit dans le temps, il est l'objet de nombreuses interactions.
Au contraire d'un mécanisme, l'activité d'un processus ne pourrait être expliquée par la simple
description des éléments matériels en interaction
1 .
Dans le cadre de la médecine, le processus pathologique correspond aux mécanismes anor-
maux impliqués dans les dysfonctionnements des tissus et des organes. Il succède à l'exposi-
tion à des facteurs favorisants (ou étiologie ou agent causal) et déclenche un mécanisme qui
correspond à l'apparition, à l'évolution et à l'enchaînement de différentes lésions élémentaires.
Ces lésions sont des altérations morphologiques responsables de la survenue d'un phénomène
pathologique par transformation et/ou modification des fonctionnalités initiales des cellules, des
tissus, des organes. Ces modifications vont entraîner des conséquences physiopathologiques qui
sont à leur tour responsables de l'apparition de signes cliniques, biologiques (ou autre) qui per-
mettront d'établir le diagnostic. Indépendamment du diagnostic posé, il existe des mécanismes
de réparation qui sont généralement mis en œuvre dès l'apparition des premières lésions.
Une fois le diagnostic posé, un ou des traitements peuvent être entrepris (sauf si l'on sait que
la guérison peut être spontanée) afin de ramener l'organisme à l'état « normal » ou à un état le
plus proche possible de l'état antérieur. Dans la majorité des cas, le ou les traitements mis en
œuvre favoriseront la guérison ou amélioreront l'action du mécanisme de réparation.
Néanmoins, malgré les traitements, certaines pathologies continuent d'évoluer, générant des
complications ou une chronicisation. Il est à noter que certaines complications ne sont pas liées
à la pathologie initiale mais sont consécutives aux traitements.
Cependant, quelle que soit l'origine de la pathologie et/ou des complications, les deux ont un
impact sur les individus. Ainsi, les répercussions peuvent affecter la personne sur les plans
physique, psychologique et social et concernent la collectivité du point de vue de la prise en
charge, que celle-ci soit matérielle, humaine, ou financière. L'ensemble de ces éléments est
déterminant lors de l'élaboration des politiques de prévention, qu'il s'agisse de prévention pri-
maire, secondaire ou tertiaire.
Nous aborderons dans cet ouvrage, les processus dégénératifs. Ces derniers, responsables d'une
dégénérescence, peuvent à leur tour entraîner une défaillance organique. Cependant, toutes les défail-
lances ne relèvent pas de ce processus et peuvent apparaître directement, elles concernent générale-
ment les défaillances organiques aiguës.
FACTEURS FAVORISANTS
Les facteurs favorisants, qui correspondent à la présence de conditions particulières, génèrent
le déclenchement d'un processus appelé le mécanisme physiopathologique et, dans certains cas,
l'entretiennent. Ces facteurs sont classés en deux catégories.
1 Site Internet http://www.psychobiologie.ouvaton.org/glossaire/z-p06.20-glossaire-processus.htm
0001675657.INDD 20001675657.INDD 2 10/30/2012 4:41:24 PM10/30/2012 4:41:24 PM

AGIR S’ENTRAÎNERCOMPRENDRE
3
Les facteurs prédisposants sont liés à la biologie humaine des individus : hérédité, génétique,
facteurs physiologiques propres, mais aussi à la maturation et au vieillissement. Ils prédisposent
la personne à être concernée par le processus.
Les facteurs précipitants sont liés au contexte, à l'environnement, aux comportements et au
style de vie.
Il convient de repérer ces éléments pour agir en amont et éviter l'apparition du mécanisme
physiopathologique par des actions de prévention primaire et secondaire
2 , ou agir en aval et pré-
venir ainsi la récidive du processus : ces actions relèvent alors de la prévention tertiaire.
MÉCANISME PHYSIOPATHOLOGIQUE
Le mécanisme physiopathologique correspond aux phénomènes qui apparaissent dans l'orga-
nisme suite à l'exposition aux facteurs favorisants (étiologie ou agent causal). Les phénomènes
ont pour conséquence l'apparition de lésions au niveau des cellules, des tissus, des organes,
transformations qui aboutiront à l'apparition de conséquences physiopathologiques.
On définit par lésion toute modification non physiologique, macroscopique ou microscopique
d'une cellule, d'un tissu ou d'un organe vivant. La cause d'une lésion peut être multiple, il peut
s'agir du résultat d'un traumatisme mécanique (choc, coupure), thermique (brûlure), électrique
(électrocution), chimique... La lésion peut aussi être le résultat d'un état pathologique lié à un
agent pathogène (infection, parasite) ou à un désordre physiologique (tumeur cancéreuse),
• Exemples de facteurs prédisposants : maladie héréditaire transmise par les parents à un
individu, anomalie génétique, constitution physique, âge...
• Exemples de facteurs précipitants : exposition à des produits néfastes pour la santé,
comportements à risque (exposition déraisonnée et volontaire au bruit, au soleil...).
2 La prévention recouvre l'ensemble des mesures prises pour éviter la survenue d'un accident ou d'une maladie ; la pré-
vention primaire vise à diminuer l'incidence des maladies dans une population ; la prévention secondaire vise à diminuer la
prévalence de la maladie dans une population donnée par des mesures curatives, elle correspond à la thérapeutique.
• M. Po Edgar, âgé de 89 ans présente une presbyacousie. Le vieillissement a altéré
ses cellules, ses tissus et ses organes, les rendant ainsi moins performants. Dans ce
cadre, la dégénérescence est consécutive à son grand âge, la perte auditive est progres-
sive : il s'agit d'un phénomène physiologique lié au rythme de renouvellement cellu-
laire qui décroît tout au long de la vie. L'âge constitue un facteur prédisposant de la
presbyacousie.
• M
lle Roc Gervaise, passionnée de musique, assiste souvent à des concerts et se posi-
tionne le plus souvent dans la fosse juste devant les artistes. Depuis quelque temps,
M
lle Roc parle fort et fait répéter les propos à ses interlocuteurs. Elle consulte son médecin,
et celui-ci décide de lui faire passer un audiogramme. À la suite de cet examen, une
perte auditive est mise en évidence. L'exposition au bruit constitue ici un facteur préci-
pitant (comportement à risque) la perte auditive.
0001675657.INDD 30001675657.INDD 3 10/30/2012 4:41:24 PM10/30/2012 4:41:24 PM

4
Généralités sur les processus
1
métabolique (nécrose par hypoxie), immunitaire (maladie auto-immune). Suivant la gravité et
l'origine, un traitement médical est nécessaire ou non
3 .
Une classification simple des lésions et maladies est fondée sur leur étiologie. On considère
les lésions tumorales, les lésions d'origine inflammatoire, dégénérative, nutritionnelle, méta-
bolique, toxique, infectieuse, physique, chimique, traumatique, génétique, embryologique, etc.
Ces catégories sont loin d'être hermétiques car pour une même lésion, il peut exister de nom-
breuses interconnexions. Ainsi, certaines infections virales peuvent engendrer des tumeurs, et
des lésions dégénératives suscitent souvent de fortes réactions inflammatoires.
Les phénomènes engendrés par la survenue du mécanisme physiopathologique sont respon-
sables de l'apparition de modifications ou de troubles du fonctionnement normal de l'organisme ;
ces phénomènes constituent ce que l'on appelle les conséquences physiopathologiques.
CONSÉQUENCES PHYSIOPATHOLOGIQUES
Les conséquences physiopathologiques sont consécutives à l'apparition de lésions et traduisent un
dysfonctionnement de l'organisme. Elles s'expliquent à partir de l'anatomie et de la physiopathologie.
Elles présentent des caractéristiques spécifiques en lien avec le(s) mécanisme(s) d'action
déclenché(s) et les cellules, tissus et/ou organes concernés. Elles sont responsables de l'appa-
rition des signes et des symptômes.
La physiopathologie s'intéresse au fonctionnement de l'organisme ou d'un des organes quand
celui-ci présente un désordre. Elle permet de comprendre le mécanisme d'une maladie et les
conséquences de ce dysfonctionnement.
Illustration : il est prouvé qu'un des facteurs favorisant la maladie de
Charcot-Marie-Tooth 1A (CMT1A) est une anomalie génétique qui entraîne la dupli-
cation d'un gène, le PMP22
4 . La surexpression de ce gène est responsable de l'accu-
mulation toxique dans les cellules nerveuses périphériques de la PMP22 mutée, ce qui
entraîne une dégénérescence des nerfs périphériques
5 . L'anomalie génétique est un
facteur prédisposant, le mécanisme physiopathologique correspond à l'accumulation
« toxique » d'un composé chimique dans la cellule.
Les neuropathies sensori-motrices héréditaires (NSMH) sont des pathologies dégé-
nératives du système nerveux. Dans ces affections, on distingue la maladie de Charcot-
Marie-Tooth (NSMH de type 1) qui se caractérise par une hypertrophie (grossissement)
des nerfs et par la dégénérescence de la gaine de matière adipeuse (la myéline) qui isole
un grand nombre des fibres nerveuses organiques. Ce type de NSMH est aussi appelé
hypertrophique. Cette dégénérescence occasionne des impulsions de conduction très
lentes dans les nerfs, entraînant un affaiblissement lent et progressif des muscles des
pieds, de la partie inférieure des jambes, des mains et des avant-bras
6 . L'hypertrophie
et la dégénérescence myélinique constituent le mécanisme physiopathologique, et la
baisse de la conduction nerveuse en est la conséquence. Enfin, l'affaiblissement muscu-
laire et les pertes sensitives en sont les signes et symptômes.
3 http://www.arc-cancer.net/Glossaire/Glossaire/Afficher/Chercher-LE9sion/critere-est-excactement/
4 http://www.orpha.net/data/patho/FR/fr-NHPP.pdf
5 http://medias.afm-telethon.fr/Media/1280/avancees_dans_les_maladies_de_charcotmarietooth.zip/files/docs/all.pdf
6 http://www.muscle.ca/fileadmin/National/Muscular_Dystrophy/Disorders/424F_Maladie_de_CMT_f.pdf
0001675657.INDD 40001675657.INDD 4 10/30/2012 4:41:24 PM10/30/2012 4:41:24 PM

AGIR S’ENTRAÎNERCOMPRENDRE
5
SIGNES CLINIQUES
La sémiologie médicale est la partie de la médecine qui étudie les signes afin de poser un dia-
gnostic. Elle s'appuie sur la définition suivante de la maladie : « Altération organique ou fonction-
nelle de la santé considérée dans son ensemble comme une entité définissable
7
. »
Les signes sont recherchés de manière systématique lors de l'examen clinique. Ils sont en lien
avec le mécanisme et les conséquences physiopathologiques. Ils signent le désordre organique.
Les signes sont des manifestations de la maladie qui est constatée objectivement par le
médecin au cours de l'examen clinique. Les signes (hépatomégalie, souffle...) qui aident le
médecin à préciser le diagnostic sont distincts des symptômes qui sont ressentis subjective-
ment et décrits par le malade (douleur, angoisse, anxiété...).
Dans la pratique, signes et symptômes sont souvent considérés comme synonymes et l'on
parle alors de signes organiques (signes objectifs observés à l'examen), de signes fonctionnels
(les symptômes), et de signes généraux (fièvre, sueurs, amaigrissement) qui traduisent le
retentissement de la maladie sur l'organisme
8 .
Le terme « organique » désigne une affection à l'origine de laquelle les examens cliniques puis
paracliniques mettent en évidence une lésion morphologique. À l'opposé, un trouble fonctionnel
ne pourra être rattaché à aucune étiologie.
Classiquement, on distingue les signes cliniques et les signes fonctionnels :
– les signes cliniques correspondent aux signes recueillis sans instrument lourd sauf le sté-
thoscope, l'otoscope, l'ophtalmoscope, le thermomètre, le tensiomètre, le saturomètre... Ils
sont classés en plusieurs catégories :
– les signes généraux, tels que la température, la fatigue, etc.,
– les signes locaux, délimités à une zone, tels les œdèmes des membres inférieurs, la
dureté des globes oculaires...
– les signes physiques qui peuvent se vérifi er à l'examen clinique (ex : l'inspection peut
retrouver un météorisme abdominal, la palpation des orifi ces inguinaux peut rechercher
une hernie, un bruit anormal peut être entendu au stéthoscope lors de l'auscultation, etc.) ;
– les signes fonctionnels sont des signes retrouvés lors de l'interrogatoire, non vérifi ables par
un autre signe clinique (ex : douleurs abdominales, vomissements, arrêt des matières et des
gaz, polydipsie...).
Au cours de la consultation, le médecin écoute le récit du malade qui décrit ce dont il souffre : des
malaises, des sensations anormales, des troubles d'une fonction comme la digestion ou le som-
meil, etc. Ce sont les symptômes qui sont donc subjectifs. Ensuite, le médecin examine le consul-
tant, cherchant des manifestations, des anomalies, des phénomènes qu'il constate lui-même et
que d'autres peuvent vérifier ; il utilise éventuellement des appareils pour obtenir des informations
chiffrées. Ce sont les signes qui sont donc objectifs. Le malade raconte, puis le médecin vérifie et
se renseigne par ailleurs.
Symptômes et signes sont tous les deux porteurs d'informations et sont donc simultané-
ment des signes au sens sémantique et linguistique du terme ; le mot « signe » a donc deux
7 Dictionnaire : Littré
8 À partir du Dictionnaire illustré des termes de médecine , 28 e édition, Éditions Maloine
0001675657.INDD 50001675657.INDD 5 10/30/2012 4:41:25 PM10/30/2012 4:41:25 PM
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%