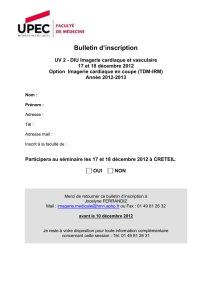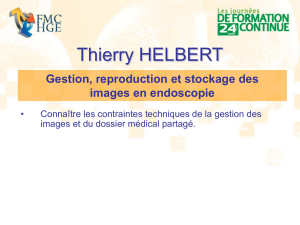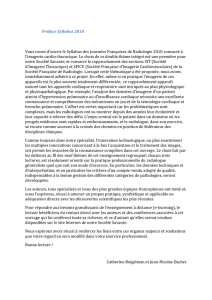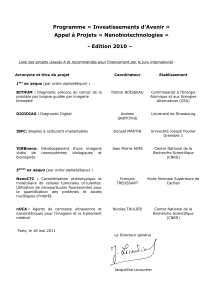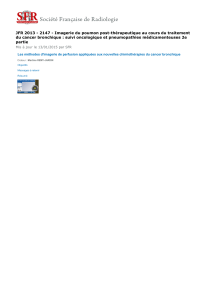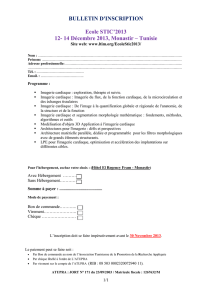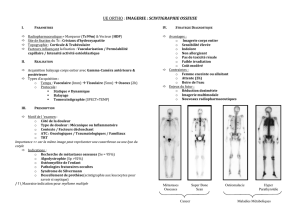imagerie thoracique

Septembre 2008 ; N°17
Editeur / GERI-Communication
4 voie romaine - Bât. G - 33610 Canéjan
http://www.geri-communication.com
IMAGERIE THORACIQUE
Principales causes des examens inutiles
Doses délivrées dans le cadre de radiodiagnostics
Prescription d’un examen d’imagerie
Grossesse et protection de l’embryon et du foetus
5 risques majeurs liés à l’imagerie
Risques estimés, liés à l’imagerie
Remerciements
Relecture par le Pr. F. LAURENT - Imagerie Médicale - CHU Bordeaux.


L’objectif de ce dossier est de présenter en quelques pages les points clés du sujet.
170
DOSSIER : Imagerie Thoracique
Un examen utile est un examen dont le résultat — positif ou négatif — modiera la prise en charge
du patient ou confortera le diagnostic du clinicien.
En imagerie, un examen qui ne répond pas à cette dénition augmente inutilement l’exposition du
patient aux rayonnements ionisants.
Procédé Nombre équivalent de
radiographies thoraciques
Durée équivalente approximative
d’exposition au rayonnement
ionisant naturel
Rayons X
Thorax face 1 3 jours
TDM thorax 10-100
selon les paramètres 1 mois à 1 an
selon les paramètres
Scintigraphie
Ventilation
pulmonaire (Xe-133) 15 7 semaines
Perfusion pulmonaire (Tc-99m)
50
L’angio-TDM est recommandée
chez la femme enceinte car elle
irradie moins que la scintigraphie
6 mois
Os (Tc-99m) 200 1,8 ans
L’IRM ne fait pas intervenir les rayonnements ionisants.
4. Examens prématurés : c’est-à-dire avant que la maladie
n’ait pu progresser ou guérir ou avant que les résultats
ne puissent inuencer le traitement. En ai-je besoin
maintenant ?
5. Informations cliniques inappropriées et mauvaise
formulation des questions : ai-je bien posé le problème ?
6. Multiplication d’examens redondants pour le patient :
les examens sont-ils trop nombreux ?
Principales causes des examens inutiles
Doses délivrées dans le cadre de radiodiagnostics
1. Répétition d’examens déjà effectués : a-t-il déjà été
pratiqué ?
Tout doit être mis en oeuvre pour obtenir les clichés
précédents.
2. Examen dont les résultats ne sont pas susceptibles de
modier la prise en charge du patient : en ai-je besoin ?
3. Examen inadéquat : Est-ce l’examen le plus indiqué ?

171
Prescription d’un examen
d’imagerie
Objectif : obtenir l’avis d’un spécialiste de radiologie ou
de médecine nucléaire.
Méthode :
- Demande complète, précise, lisible
- Motif de la demande
- Détails cliniques sufsants pour que le spécialiste
de l’imagerie identie correctement les problèmes
diagnostiques ou cliniques qu’on espére résoudre par
l’examen radiologique.
Grossesse et protection
de l’embryon et du foetus
Il faut éviter autant que possible l’irradiation du
foetus.
Il peut arriver que la grossesse ne soit pas suspectée par
la femme elle-même et c’est au clinicien qu’il incombe
d’identier ces patientes-là.
Toute femme en âge de procréer qui doit subir un examen
au cours duquel le faisceau incident irradie directement
ou par diffusion la région pelvienne (essentiellement,
tout rayon ionisant entre le diaphragme et les genoux)
ou un examen faisant intervenir des isotopes radioactifs
doit d’abord être questionnée sur une éventuelle
grossesse.
Quand la possibilité n’est pas exclue, il faut déterminer
avec la patiente si elle a un retard de règles.
Si la possibilité d’une grossesse est exclue, l’examen
peut être pratiqué ; si la patiente est effectivement
ou probablement enceinte (retard de règles), il faut
réexaminer l’opportunité de l’exposition et décider
s’il faut reporter l’examen après l’accouchement ou
les prochaines règles éventuelles. Toutefois, un acte
susceptible d’améliorer le tableau clinique de la mère
peut aussi avoir une retombée positive indirecte pour
l’enfant à naître car le fait de retarder un examen capital
peut accroître les risques pour le foetus comme pour la
mère.
Si l’éventualité d’une grossesse n’est pas exclue mais
qu’il n’y a PAS de retard de règles et que le procédé
implique une dose relativement faible pour l’utérus,
l’examen peut être pratiqué. Toutefois, si l’examen délivre
des doses assez élevées son opportunité fera l’objet
d‘une discussion s’appuyant sur les recommandations
locales.
Dans tous les cas, si le radiologue et le clinicien estiment
que l’irradiation de l’utérus gravide ou éventuellement
gravide se justie cliniquement, leur décision doit être
consignée. Le radiologue doit ensuite veiller à ce que
l’exposition se limite au minimum requis pour obtenir
les informations nécessaires.
S’il apparaît qu’un foetus a été exposé non
intentionnellement, en dépit des précautions précitées,
le faible risque encouru ne justie probablement pas,
même à des doses supérieures, d’induire des risques
plus importants en pratiquant des examens invasifs (du
type amniocentèse) ou en interrompant la grossesse.
En cas d’exposition non intentionnelle, le risque doit
être évalué par un physicien médical et le bilan de
l’évaluation discuté avec la patiente.
5 risques majeurs liés
à l’imagerie
Irradiation et cancer : on estime qu’un individu/1000 est
susceptible de déclarer un cancer après une irradiation
de 10mSv (Brenner, 2007) ; mais cela sera difcile à
démontrer du fait du long décalage de temps entre
l’irradiation et l’apparition du cancer. Cette estimation
repose sur les irradiations japonaises des bombes H
délivrées en une fois et non sur les irradiations médicales
cumulées.
Le risque de développement d’un cancer est estimé
comme décroissant de manière exponentielle avec
l’âge. Une diminution très nette est observée après
l’âge de 20 ans.
Il faut être particulièrement attentif aux enfants et aux
organes sensibles (ex : seins chez les jeunes femmes,
très sensibles aux radiations).
Produits iodés et néphropathies induites ; bien
connues immédiatement après l’injection du produit
de contraste, les conséquences rénales à long terme
de ces injections ont été peu étudiées ; une bonne
hydratation du patient paraît essentielle.

172
Le risque augmente avec la dégradation de la fonction
rénale principalement évaluée par la clairance de la
créatinine calculée selon la formule de Cropow. On
estime qu’avec une clairance de plus de 60 ml/min, le
risque est très faible ; une clairance au-dessous de 30
contre-indique l’injection d’iode et entre les 2, le bénéce
est à discuter en fonction du risque.
Risque de décompensation cardiaque chez un sujet
insufsant cardiaque, lié au volume injecté en peu de
temps.
Risque d’acidose lactique chez un diabètique,
diminué par l’arrêt de la metformine le jour même de
l’examen iodé et le lendemain, ainsi que l’hydratation.
Certaines formes de gadolinium et brose
néphrogénique systémique induite :
caractérisée par des rash cutanés, un épaississement
de la peau et des contractures articulaires, elle est
souvent progressive et peut être fatale. Elle n’est
décrite qu’avec certaines molécules et le risque n’existe
qu’en cas d’insufsance rénale avérée (clairance < 30).
Ce n’est pas un risque fréquent même si on en parle
beaucoup.
Echographie avec contraste à microbulles, très
exceptionnelles embolies paradoxales.
Réaction anaphylactoide au produit de contraste. Du
rash cutané au décès en passant par le bronchospasme.
Il n’y a aucun facteur de risque réel sauf un antécédent
d’incident ou d’accident avec un produit de contraste
(PDC) iodé ! Dans ce cas, on conseille une préparation
avec des antihistaminiques et corticoides et, surtout, de
changer de PDC !! (L’allergie est à la molécule porteuse,
pas à l’iode).
Réagissez à ce dossier !
Vous avez une question ? Vous souhaitez faire un commentaire ? info@respir.com
Risques estimés, liés à l’imagerie
néphropathie induite par les produits iodés chez des
malades avec insufsance rénale 1/5
néphropathie chez des sujets avec rein sain 1/50
cancers 1/1000 (ce chiffre paraît très surestimé et souffre des
critiques ci-dessus)
décès par réaction anaphylactoïde 1/130.000
brose systémique chez des patients avec insufsance
rénale impossible à déterminer, les cas décrits étant encore
très peu nombreux
Références :
- Brenner DJ, Hall EJ. Computed tomography - An increasing source of radiation exposure. N Eng J Med
2007;357:2277-84.
- Recommandations en matière de prescription de l’imagerie médicale. Adaptées par des experts représentant
la radiologie et la médecine nucléaire européennes, en liaison avec le UK Royal College of Radiologists. Sous
la coordination de la Commission européenne. 2000.
 6
6
1
/
6
100%