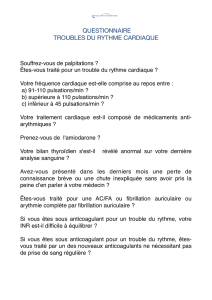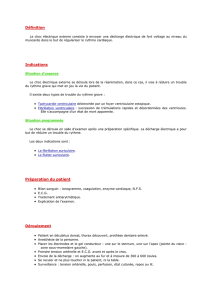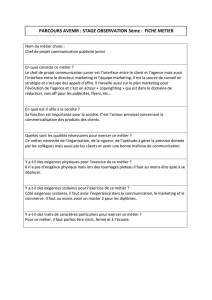Y a t-il un bénéfice à ralentir fortement la fréquence cardiaque des

La fibrillation auriculaire se complique souvent
d’insuffisance cardiaque et d’accidents emboliques artériels.
Si la réduction de l’arythmie n’a pas montré d’efficacité
supérieure à un ralentissement du rythme cardiaque, le
niveau souhaitable de ce ralentissement n’est pas bien connu
aujourd’hui. En particulier, un ralentissement important de
ce rythme cardiaque s’accompagne d’une fréquence élevée
d’effets indésirables des médicaments utilisés. Les auteurs
ont donc mené un essai thérapeutique randomisé contrôlé,
multicentrique pour comparer une stratégie de contrôle strict
de la fréquence cardiaque versus un contrôle modéré.
Trente trois centres néerlandais ont recruté des patients âgés
de moins de 80 ans, avec une fibrillation auriculaire
chronique, soit depuis au moins 12 mois, une fréquence
cardiaque d’au moins 80 bat/min par minute et un traitement
anticoagulant selon les recommandations.
Chaque patient était assigné de façon non aveugle à l’un des
2 groupes. Les médicaments utilisés, en association ou non,
pour réduire la fréquence cardiaque étaient les béta-
bloquants, les inhibiteurs calciques et les digitaliques.
L’objectif de fréquence cardiaque était de 110 bat/min pour
le groupe « contrôle modéré », et de 80 bat/min pour le
groupe « contrôle strict ». Cette fréquence était contrôlée par
un ECG, et un holter cardiaque de 24 heures était réalisé
pour le groupe « contrôle strict » afin de dépister des
épisodes de brady-arythmie.
L’objectif primaire était composé des évènements suivants :
décès d’origine cardio-vasculaire, hospitalisation pour
insuffisance cardiaque, accident vasculaire cérébral, embolie
artérielle systémique, accident hémorragique grave et
complications rythmiques de type tachycardie ventriculaire,
syncopes, effets indésirables graves des médicaments et
implantation d’un pace-maker. Les points de contrôles
secondaires incluaient les points de contrôle primaires, ainsi
que les décès de toutes causes, les symptômes et le statut
fonctionnel. Au total, 614 patients ont été inclus dans l’étude
avec une moyenne d’âge de 688 ans.
Les résultats montraient dans le groupe « contrôle modéré »
une moyenne de fréquence cardiaque de 93 3 bat/minute et
de 76 12 bat/min pour le groupe « contrôle
strict » (p<0,001). Durant le suivi, dans les groupes
« contrôle strict » et « modéré » respectivement, 22 et 18
patients avaient un rythme sinusal (p=0,6). Respectivement
dans les groupe « contrôle strict » et « contrôle modéré », 43
vs 38 patients avaient un critère répondant à l’objectif
primaire, avec une différence non significative entre les 2
groupes. Concernant la prévention de l’objectif primaire, il
n’y avait pas de différence significative entre les 2 groupes
(p=0,001). Il n’y avait pas non plus de différence en termes
de nombre de décès (5,6% à 3 ans dans le groupe « contrôle
modéré » vs 6,6% dans le groupe « contrôle strict »).
Au total, cette étude montre une « non infériorité » d’une
stratégie « contrôle modéré de la fréquence cardiaque » par
rapport à une stratégie « contrôle strict de la fréquence
cardiaque ». Il s’agit de l’une des premières études de grande
ampleur mettant en évidence une telle conclusion. Ce travail
suggère qu’un rythme cardiaque contrôlé jusque 110 bat/min
peut être suffisant pour réduire le risque d’insuffisance
cardiaque par fibrillation auriculaire. D’autre part, près de la
moitié des décès observés dans cette étude étaient dus à une
autre cause que l’arythmie ou l’insuffisance cardiaque. Dans
le groupe « contrôle strict » il est à noter que seulement 67%
des patients avaient atteint l’objectif de fréquence cardiaque,
alors que dans l’autre groupe au contraire, la très grande
majorité des patients avaient atteint l’objectif d’une
fréquence cardiaque inférieure à 110 bat/min. Ceci pouvait
contribuer à l’absence de différence observée en termes de
bénéfice entre les 2 groupes.
Les résultats de cette étude devraient conduire à établir des
recommandations concernant le traitement médicamenteux
des patients porteurs d’une fibrillation auriculaire, avec
vraisemblablement la possibilité d’un contrôle du rythme
cardiaque moins strict que ce qui est réalisé en pratique
aujourd’hui.
Y a t-il un bénéfice à ralentir fortement la fréquence cardiaque des
patients en cas de fibrillation auriculaire ?
Laurent Lechowski,
Hôpital Sainte Périne, Paris
Af 622-2010 ©2010 Successful Aging SA
Van Gelder IC, Groenveld HF, Crijns HJ, Tuininga YS, Tijssen JGP, Alings AM, et al. Lenient versus strict rate control in
patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2010;362:1363-73.
Comparaison des événements à 3 ans de suivi entre les groupes « contrôle modéré » et « contrôle strict » du rythme cardia-
que.
Contrôle modéré du
rythme cardiaque
(n=311)
Contrôle strict du ryth-
me cardiaque (n=303)
Hasard Ratio (intervalle
de confiance à 90%)
Objectif primaire 38 (12,9%) 43 (14,9%) 0,84 (0,58-1,21)
Décès d’origine cardio-
vasculaire
9 (2,9%) 11 (3,9%) 0,79 (0,38-1,65)
Insuffisance cardiaque 11 (3,8%) 11 (4,1%) 0,97 (0,48-1,96)
Accident vasculaire céré-
bral
4 (1,6%) 11 (3,9%) 0,35 (0,13-0,92)
Hémorragie 15 (5,3%) 13 (4,5%) 1,12 (0,60-2,08)
Syncope 3 (1,0%) 3 (1,0%) -
Implantation d’un pace-
maker
2 (0,8%) 4 (1,4%) -
1
/
1
100%
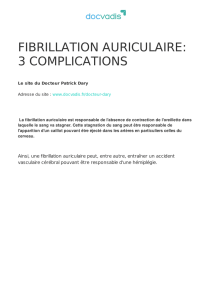



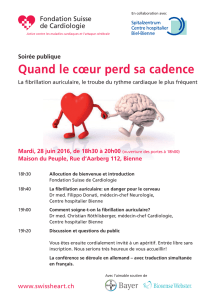

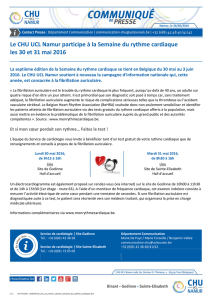
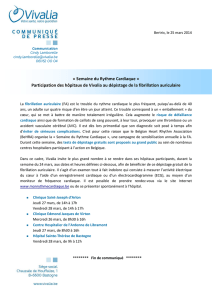
![Traitement :[2]](http://s1.studylibfr.com/store/data/001359805_1-596a0b75a49214019bee38f424564f1f-300x300.png)