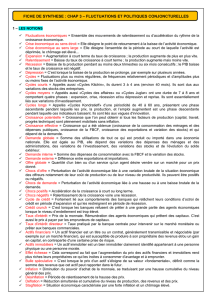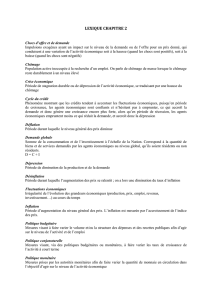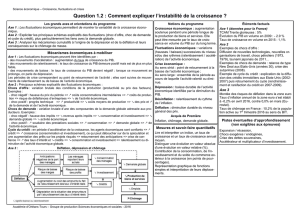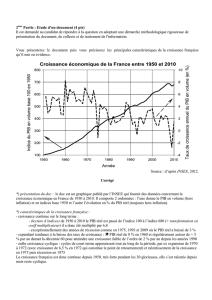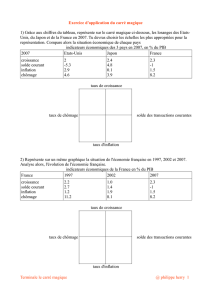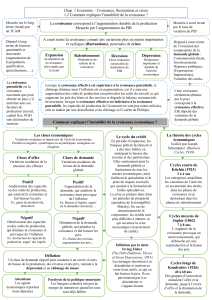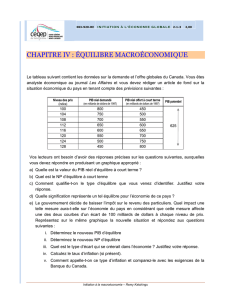CHAP 3 - 31 - Les fluctuations économiques

CHAP 3 – COMMENT EXPLIQUER L’INSTABILITE DE LA CROISSANCE ?
3.1 – COMMENT EXPLIQUER LES FLUCTUATIONS ECONOMIQUES ?
Introduction :
1. La croissance économique n’est pas régulière. A une période d’expansion succède une période de
récession voire même de dépression comme lors de la crise de 1929. Ces fluctuations semblent être une
caractéristique fondamentale de la croissance économique.
2. Les cycles économiques ont été observés par les économistes depuis le XIX° siècle. Depuis les 20
dernières années, les crises se sont succédées et, en 2008, les Etats Unis et sur tout la zone euro sont
entrés en récession à cause de la crise des «subprimes». Les crises financières, bancaires, économiques,
et la crise de la dette souveraine en Europe menacent de plonger le monde dans la dépression. On peut
donc s’interroger sur les causes des variations du rythme de la croissance. Certains mettent en avant le
rôle des chocs, c’est-à-dire des modifications imprévues, positives ou négatives, qui s’exercent sur la
demande. Quel est l’impact de la croissance des pays émergents sur la hausse des exportations des pays
développés ? Quel est l’impact de la hausse des prix du pétrole sur la demande globale ?...
3. D’autres mettent l’accent sur le rôle des chocs d’offre. Quels sont les effets des innovations sur la hausse
ou la baisse de la croissance ? Une baisse des coûts salariaux unitaires peut-elle provoquer un choc de
compétitivité et augmenter la croissance potentielle d’un pays ? Une hausse des coûts énergétiques peut-
elle compromettre, temporairement ou durablement, la croissance ?
4. D’autres, enfin, souligne le rôle des cycles du crédit dans une économie qui s’est largement financiarisée.
L’expansion du crédit bancaire et des liquidités est-elle favorable à la croissance ? Ne risque-telle pas de
provoquer une hausse excessive des prix et des bulles financières et immobilières ? A contrario, un
rationnement du crédit ne conduit-il pas à une baisse excessive de la production qui engendre chômage,
baisse des salaires réels et déflation ?
5. Après avoir mis en évidence les fluctuations et les crises, nous essaierons de les expliquer puis nous nous
interrogerons sur les politiques économiques de lutte contre l’instabilité et sur leur efficacité, notamment
dans la zone euro.
A – La croissance économique s’accompagne de fluctuations
a) – L’instabilité de la croissance
1. L’économie est tout d’abord marqué par des tendances longues (« Trend »). Cela peut être des tendances
irréversibles : ce sont les mouvements lourds que l'évolution économique et sociale ne peut contrer que
ponctuellement. Il s'agit de mouvements quantitatifs (augmentation de la population, augmentation de la
production) et structurels (urbanisation). Mais cela peut être aussi des mouvements réversibles : il s'agit de
mouvements récurrents d'expansion et de déclin comme l'évolution des prix, de l'emploi, des sources
d'énergie et des productions dominantes.
L’évolution du trend de croissance de l’économie française (Taux de croissance annuel moyen en %)

2. De ce point de vue, la croissance correspond à une augmentation durable et à long terme du volume de la
production. Le trend de croissance correspond à la pente ou à la tendance à long terme de la croissance.
Entre 1960 et 1974, le PIB français a augmenté de 5,5% par an en moyenne. Depuis 1974, il n’a plus
augmenté que de 2% par an en moyenne.
3. On peut donc observer deux grandes tendances pour la croissance française que l’on retrouve dans la
plupart des pays avancés :
La croissance baisse au cours du temps, ce qui ne veut pas dire que le PIB baisse mais qu’il augmente de
moins en moins rapidement : 5,2% par an en moyenne pendant la période 1960-1974, + 2,2% par an en
moyenne pour les vingt années suivantes et + 1,5% par an en moyenne pour la période 1994-2011.
La croissance du PIB varie à court terme de façon plus ou moins cycliques avec des phases :
D'expansion : phase du cycle caractérisée par une accélération du rythme de la croissance qui se
traduit par une hausse du taux de croissance. La production augmente de plus en plus vite
(exemple : + 4,5% en 1961, + 6,9% en 1962) et dépasse le sentier de croissance (trend).
De ralentissement : le rythme de croissance décélère et le taux de croissance diminue. La
production continue d’augmenter mais de moins en moins vite (exemple : + 4% en 1978, + 3,2%
en 1979, + 1,8% en 1980 en France). Il y a une baisse de la croissance mais pas de la production.
De récession qui se définit par une contraction de la production d'un pays pendant au moins deux
trimestres consécutifs (exemple : en 1974, en 1993 et en 2009 en France). Le taux de croissance
est négatif et la production recule. La dépression suppose une chute de la production forte et
durable (la crise de 1929 par exemple) qui s’accompagne d’une déflation (baisse des prix et des
salaires).
Taux de croissance du PIB français en volume (en %)
4. La croissance effective est instable : à des périodes de croissance soutenue (expansion), succèdent des
périodes de forts ralentissements, voire de recul de l’activité productive pendant une période plus ou moins
longue (récession ou dépression).
Au sens strict, le terme de « crise » désigne le point de retournement à la baisse de l’activité économique.
La récession survient lorsque la croissance économique est négative pendant au moins 6 mois consécutifs
ou deux trimestres. Lorsque la baisse de la production se prolonge, par exemple sur plusieurs années, on
assiste à un phénomène de dépression économique (La crise de 1929, la crise de 2009).
Au sens large, il désigne l’ensemble de la période au cours de laquelle l’activité est déprimée, le chômage
élevé, etc. La crise se termine alors grâce à la « reprise ».
5. On appelle fluctuations économiques l’ensemble des mouvements de ralentissement ou d’accélération du
rythme de la croissance économique. Le repérage des fluctuations s’opère grâce à des séries statistiques
(annuelles, trimestrielles, mensuelles) qui portent sur le volume de la production, les prix, le chômage, le
niveau des stocks, les carnets de commande des entreprises, etc. (par exemple en France les enquêtes
de conjoncture réalisées par l’Insee).
Expansion
Ralentissement
Récession

Les phases des fluctuations économiques
b) – Peut-on parler de cycles économiques ?
1. Au XIXème siècle et au début du XXème, les économistes s’intéressent beaucoup aux cycles
économiques, car l’économie est rythmée à cette époque, de façon perceptible par une alternance assez
régulière de phases d’expansion et de phases de ralentissement ponctuées par des crises qui reviennent à
intervalle assez régulier. « Les cycles économiques sont des fluctuations plus ou moins régulières, de
fréquences relativement périodiques et d'amplitude plus ou moins fixes de l'activité économique ». Les
fluctuations cycliques sont, théoriquement, telles que le graphique des indicateurs retenus (Taux de
croissance du PIB, taux d’inflation, courbe du chômage etc.) en fonction du temps ait une allure
sinusoïdale.
Les fluctuations de la croissance française (en % - échelle de droite)
2. Schumpeter dans « Business cycles » (Les cycles des affaires - 1939) a abouti à une classification des
cycles. Il prétend que 3 cycles se superposent et expliquent pour l'essentiel l'évolution de la conjoncture :
les cycles courts, les cycles moyens, dits cycles Juglar, les cycles longs, ou cycles kondratiev :
Les cycles courts mineurs, dits aussi cycles de Kitchin, du nom du statisticien Joseph Kitchin, durent 3
à 4 ans (environ 40 mois). Ils sont dus aux variations des stocks des entreprises. En période de
croissance, les entreprises augmentent leur production pour répondre à la demande mais elles
constituent aussi des stocks. En période de récession, elles réduisent leur production et déstockent, ce
qui accentue le ralentissement de l'activité.
Les cycles moyens, également appelés cycles des affaires ou cycles Juglar, ont été mis en évidence
par l'économiste français Clément Juglar. Essentiellement liés aux variations de l’investissement, ils
ont une durée de sept à huit ans et comportent quatre phases : expansion, crise, récession et/ou
dépression et reprise.

Cycle court et cycle des stocks en Europe (A) Cycle moyen et cycle des investissements (B)
Les cycles longs ou cycles Kondratiev, d'une périodicité de 40 à 60 ans, présentent une phase ascendante
pendant laquelle les prix, la production, et l'emploi augmentent et une phase descendante pendant laquelle
ces indicateurs baissent. Pour Schumpeter, chaque cycle s'explique par l'introduction d'innovations
majeures (machine à vapeur, automobile....) qui apparaissent par « grappes » entraînant dans un premier
temps une phase d'expansion. Une fois ces innovations diffusées dans l’ensemble de l’économie, leur effet
dynamique s’épuise et on entre dans une phase de ralentissement prolongé jusqu’à que de nouvelles
innovations provoquent le phénomène de « destruction créatrice » et la reprise de la croissance.
Cycle des innovations de procédés et cycles Kondratiev
Les cycles longs kondratiev : Evolution des prix à la consommation américain (Base 100 = 1970) et courbe idéale du
cycle
3. Schumpeter considérait que ces cycles étaient liés entre eux et que leur superposition provoquait les crises
les plus graves (un Kondratiev était égal à 6 Juglar et à 12 Kitchin). Ainsi, la crise de 1929, retournement
d’un cycle de kondratiev et d’un cycle de Juglar, fut la crise la plus profonde connue. Après une période
d’expansion sans précédent, la crise éclate aux Etats-Unis (krach boursier, crise bancaire, crise
économique) et se répand en occident. Les productions baissent de 30 à 40%, le taux de chômage atteint
27% de la population active aux USA ! La dépression est accentuée par le recours au protectionnisme et
par des politiques déflationnistes. Pour sortir de la crise, le capitalisme devra être totalement modifié après
la guerre (développement de l’Etat Providence).

4. Cependant, la période des Trente glorieuses, a pu faire croire à la disparition des cycles. L’économie des
pays développés étant de plus en plus tertiaire, elle serait moins soumise aux cycles industriels des stocks,
des investissements et des innovations. Pourtant, avec la succession des crises financières de 1987
(Krach des marchés financiers), de 1994 (Crise mexicaine), de 1997 (Crise des économies asiatiques), de
2001 (Krach boursier) et de 2008 (Crise des « subprimes »), l’idée du retour des cycles est devenu un
sujet d’étude pour les économistes. Les cycles économiques seraient plus liés aux crises financières.
c) – Fluctuations, croissance effective et croissance potentielle
1. La croissance potentielle se définit comme la croissance qui résulte de la combinaison de l'offre des facteurs
de production : capital, travail et progrès technique. Autrement dit, il s’agit de la croissance maximale que
peut obtenir un pays lorsqu’il mobilise tous ses facteurs de production (population active, équipement,
productivité) sans déclencher de l’inflation. Les projections de croissance potentielle reposent sur des
hypothèses qui reflètent les tendances passées observées (elles ne constituent donc pas des prévisions) de
3 dimensions :
La croissance de la population active occupée qui dépend de la croissance démographique, c’est-à-dire
de la croissance naturelle de la population (naissance – décès) et du solde migratoire (immigration –
émigration), et du taux d’emploi de la population en âge de travailler.
La croissance du stock de capital fixe dépend du rythme des investissements (achat de nouveaux
équipements durables, de nouveaux bâtiments et de nouveaux logiciels) et du rythme de l’usure et de
l’obsolescence du capital fixe (dépréciation ou consommation du capital fixe).
L’évolution du progrès technique, mesurée par celle de la productivité globale des facteurs, dépend
principalement du rythme des innovations.
Compte tenu de l’évolution passée de ces trois dimensions, la croissance potentielle de la France ne
devrait pas dépasser les 1,5% par an entre 2008 et 2015.
2. La croissance effective correspond à la croissance réellement obtenue par le pays. Elle dépend
essentiellement des variations de la demande globale qui comprend :
La consommation finale des ménages, c’est-à-dire tous les achats de biens et de services opérés par
les ménages à l’exception du logement, qui dépend de l’évolution du pouvoir d’achat des ménages et de
leur propension à consommer (part du revenu disponible qu’ils consacrent à la consommation).
La consommation finale des administrations, c’est-à-dire tous les achats de l’Etat qui ne sont pas
considérés comme des investissements, qui dépend des décisions de l’Etat en matière d’évolution des
dépenses publiques.
L’investissement en capital fixe des entreprises, des ménages et des administrations publiques, c’est-à-
dire l’achat de biens d’équipement durables, de bâtiments et de logiciels, qui dépend de l’évolution de la
demande, des profits réalisés et anticipés et de leur capacité à les financer.
Les exportations qui correspondent à la demande adressée aux pays par des non-résidents et qui
dépendent de la compétitivité des produits nationaux vis-à-vis des produits étrangers et de la croissance
du pouvoir d’achat des non-résidents.
De la variation des stocks : un stockage profite à l’augmentation de la production, un déstockage
contribue à son ralentissement.
Les facteurs qui conditionnent l’offre de produits
Les facteurs qui conditionnent la demande de produits
Facteur
travail
Progrès
technique
Facteur
capital
Croissance potentielle
Croissance effective
Variation de la
consommation
Variation de
l’investissement
Variation du solde
extérieur
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%