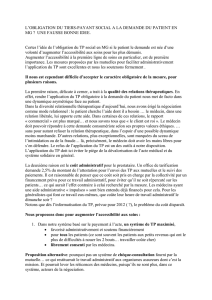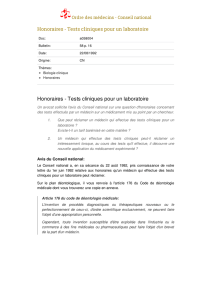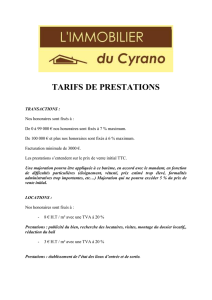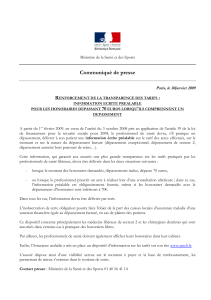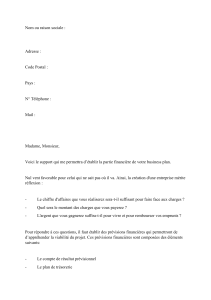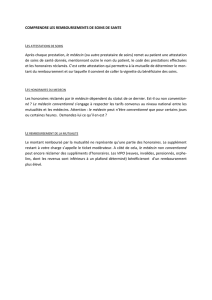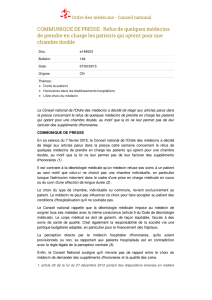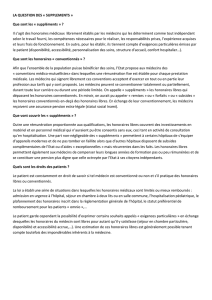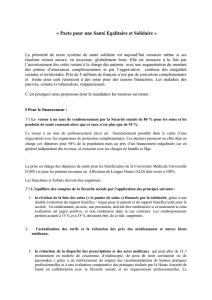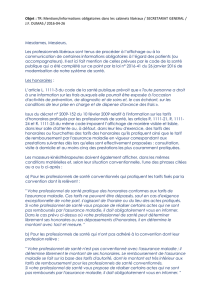La pratique des honoraires libres en médecine

1
LA PRATIQUE DES HONORAIRES LIBRES EN MEDECINE
AMBULATOIRE : LE PRIX SIGNALE-T-IL LA QUALITE ?
Free fees in French ambulatory medicine : a quality process ?
Philippe BATIFOULIER**, Franck BIEN*** et Olivier BIENCOURT****
Résumé : L’article tente de répondre à l’interrogation posée par les nouvelles pratiques tarifaires en médecine
ambulatoire. De 1980 à 1990, les médecins libéraux français ont eu le libre choix de leur secteur tarifaire car ils
pouvaient opter pour le dépassement d’honoraires non remboursé au patient par la Sécurité Sociale. Il semble que les
médecins n’aient pas usé de cette liberté comme le prédit la théorie économique de concurrence parfaite. En effet,
comme l’ont souligné les rares études effectuées, la liberté des honoraires ne peut être interprétée comme un élément de
marché. Il faut alors se tourner vers d’autres approches qui permettent de substituer la notion de règle tarifaire à celle de
prix de marché. La liberté des honoraires peut alors être analysée à la fois en terme de signal de qualité et de convention
de qualité.
Mots-clés : Honoraires libres – qualité – convention
Summary : The article is an attempt to explain the new pratices in French ambulatory medicine. Between 1980 and
1990, the French liberal physicians have had the free choice of their tariff sector. They were free to determine their fees.
Obviously, physicians have not used this liberty, thus contradicting the standard economic theory. Indeed, the liberty of
fees can not be interpreted as an element of market. It is necessary to turn to others approaches that associate the tariff
liberty to a “ quality process ”. This process can be analyzed as a quality signal and as a quality convention.
Key-words : French ambulatory medicine - free fees - quality - convention
**F.O.R.U.M., Université Paris X-Nanterre, 200, av de la république, 92001 Nanterre cedex. E-mail : Philippe.Batifoulier@u-paris10.fr
***THEMA, Université Paris X-Nanterre. E-mail : fbien@u-paris10.fr
****F.O.R.U.M., Université Paris X et Université du Maine, avenue Olivier Messiaen, 72085 Le Mans Cedex 9. E-mail : biencour@univ-lemans.fr

2
Le système de santé français est un système administré où l’autorité de tutelle est notamment compétente en matière de
fixation des tarifs. Aussi, la détermination du prix ne résulte pas de la rencontre d’une offre et d’une demande
médicales. C’est pourquoi même si on évoque souvent le “prix de la consultation”, il ne peut s’agir d’un prix au sens de
la théorie économique. Pourtant, en 1980, une réforme a été entreprise introduisant une relative liberté tarifaire pour la
médecine libérale. Cette réforme offre l’alternative suivante à chaque médecin :
· continuer à percevoir le “prix conventionné”, fixé par l’autorité de tutelle et entièrement remboursé au patient
(aujourd’hui 115 francs par consultation pour un généraliste) ; les médecins appartiennent alors au secteur 1,
· tarifer au-dessus du “prix conventionné”, c’est-à-dire percevoir un dépassement d’honoraire non remboursé au
patient par la Sécurité Sociale ; les praticiens sont membres du secteur 2, ou secteur à honoraires libres.
L'intérêt de cette réforme pour les pouvoirs publics est de satisfaire les revendications de revenu des médecins libéraux
sans alourdir le déficit de la Sécurité Sociale. Chaque année, durant la période 1985 à 1989, 20 % des médecins ont
rejoint le secteur 2. En 1990, cette liberté tarifaire est amendée par une nouvelle convention médicale. Les médecins qui
sont déjà en secteur 2 peuvent y demeurer mais, mis à part les chefs de clinique, aucun nouveau praticien ne peut
désormais opter pour ce système. En d’autres termes, l’attrait du secteur 2 aux yeux des médecins était tel que la
puissance publique s’est crue obligée de le réglementer en gelant le “secteur à honoraires libres”. La part des médecins
en honoraires libres est évaluée aujourd'hui à 25 % sur l'ensemble du territoire national, dont 20 % de généralistes et 33
% de spécialistes. Coexistent donc aujourd’hui deux secteurs dont l’un (le secteur 2) institue une liberté des prix.
A l’exception des prothèses dentaires et de certains produits pharmaceutiques non remboursables, la pratique des
honoraires libres constitue, dans le champ de la santé, le seul domaine où il est a priori possible de raisonner en termes
de prix de marché. Cela ne peut qu’éveiller la curiosité d’un économiste qui doit, dès lors, se demander comment les
médecins, qui bénéficient de la liberté tarifaire, en usent. Autrement dit, le “prix de la consultation” est-il devenu un
prix (résultant de la confrontation entre une offre et une demande) ? Les analyses du secteur 2, dont nous rendons
compte dans une première partie, révèlent que la pratique des honoraires libres en médecine ambulatoire pose questions
à la théorie économique. Pour y répondre, on peut faire appel aux approches qui font du prix une règle (une règle
tarifaire pour le problème qui nous occupe). Ces approches ont en commun de proposer une économie du consensus ou
de l'accord. La règle permet, en effet, d'assurer la coordination entre individus aux objectifs divergeants. Elle résout un
problème de coordination.
Ainsi en est-il des théories qui abordent le prix sous l'angle d'un signal de qualité. Ces dernières prédisent que la liberté
tarifaire donnée aux médecins va être utilisée par eux pour signaler la qualité particulière de leur prestation. Le prix peut

3
donc être appréhendé à partir d’un contrat bilatéral, résolvant les problèmes d'asymétrie d'information et reposant sur les
seules rationalités individuelles. C’est ce que nous développerons dans une seconde partie.
Une autre approche, que nous considérons comme complémentaire, insiste sur la rationalité collective. Elle met l’accent
sur l'existence de pratiques d'honoraires typiques reposant sur un mimétisme des médecins. La règle tarifaire est ici une
convention qui indique à distance la qualité de la prestation médicale. Ce sera l'objet de la dernière partie.
1. Les honoraires libres : un prix de marché ?
La notion d’honoraires libres constitue un terrain fécond pour l’économiste, car il va pouvoir tester ses représentations
habituelles dans un domaine “ neuf ”. Comment interpréter l’introduction d’un concept significatif de marché (le prix)
dans un domaine où la régulation marchande était jusque là secondaire ?
1.1 Un sujet peu étudié directement
Les réponses à cette interrogation stimulante sont pourtant peu nombreuses. Et quand elles existent, elles ne constituent
pas le sujet principal d’étude. En effet, la pratique des honoraires libres est généralement appréhendée au détour d’un
autre sujet d’analyse qui est tantôt l’activité médicale globale tantôt l’effet d’induction.
Un premier groupe de travaux rassemble des analyses statistiques qui nourrissent la réflexion économique en exhibant
des faits stylisés. Ces études rendent compte de la diversité de la pratique médicale libérale. Elles mettent l’accent
notamment sur les déterminants des revenus des médecins libéraux et sont, dans ce cadre, amenées à accorder une
attention particulière à la corrélation prix de l’acte - nombre d’actes. De telles études (6,7,15,19,22,23 par exemple)
apportent des résultats très intéressants concernant la variété des motivations des médecins qui passent du secteur 1 au
secteur 2.
Le deuxième groupe d’études analyse la nouvelle pratique tarifaire au regard du problème séminal des économistes de
la santé : l’effet d’induction. En opposition avec les conclusions de la micro - économie traditionnelle, ce dernier prédit,
en effet, une hausse des prix à la suite d’une augmentation de l’offre, celle - ci générant (induisant) sa propre demande.
Dans cette perspective, il est tentant de lire les honoraires libres comme une augmentation de prix consécutive à la
manifestation du pouvoir discrétionnaire des médecins. Le nombre d’articles consacrés à la vérification de l’hypothèse
de demande induite (liaison positive significative entre activité et densité médicales) dans le cas français est
relativement faible (par rapport à ce qu’il est outre - atlantique). Ces études (3,4,5,9, par exemple) ne permettent pas
toujours de conclure sur la véracité de cette hypothèse mais elles apportent indirectement des éléments explicatifs sur le
comportement des médecins qui optent pour le secteur 2.
Au total, ce sont dans les conclusions indirectes d’études statistiques globales d’une part et dans les analyses
économétriques (in)validant l’effet d’induction d’autre part que nous disposons d’éléments de compréhension de la

4
nouvelle pratique tarifaire des médecins libéraux. Bien que ces travaux ne choisissent généralement pas le thème des
honoraires libres comme sujet principal d’étude, ils convergent pour exhiber deux faits fondamentaux qu’il nous faut
expliquer en mettant la liberté tarifaire des médecins libéraux au centre de l’analyse.
1.2. Deux faits stylisés fondamentaux.
Les études précitées1 mettent en avant l’importance des deux faits stylisés suivants :
(i) Il semble que ce soit la spécialité dans son ensemble, et non le médecin, qui fasse le choix d’un secteur de
tarification. Le passage en secteur 2 n’est donc que très rarement le résultat d’une décision individuelle.
(ii) Il existe en matière de tarification médicale des standards locaux. Dans une zone géographique délimitée, une
même pratique médicale signifie un même secteur tarifaire.
Ces faits stylisés appellent plusieurs commentaires.
(a) Le “secteur à honoraires libres” n’est bien sûr pas homogène (un médecin généraliste peut percevoir 150 francs par
consultation quand l’autre affiche un prix de 200 francs) mais nous faisons implicitement l’hypothèse que
l’hétérogénéité inter - secteur est plus forte que l’hétérogénéité intra - secteur. Ce que nous cherchons à expliquer
c’est le choix d’un secteur tarifaire (1 ou 2) plus que le montant des honoraires à l’intérieur du secteur 2 ; l’inverse
supposerait des données dont il est difficile – pour des raisons de confidentialité - de disposer.
(b) Parmi les généralistes en secteur 2, les médecins en “mode d’exercice particulier” (acupuncture, homéopathie, etc.)
sont massivement représentés (les dépassements d’honoraires proviennent pour 40% de ce type d’exercice, cf. 22).
Ils se considèrent comme des spécialistes et, en conséquence, ils cherchent avant tout à faire reconnaître la
spécificité de leurs pratiques médicales, qu’ils estiment de qualité supérieure. En cela, le passage en secteur 2 peut
être perçu comme un indice de qualité. La hausse du tarif est une réponse à un choix d’une qualité supposée
supérieure de la médecine. Ces pratiques se traduisent par des durées de consultation plus grandes et des visites au
domicile du patient plus rares (ce dernier point est justement une des caractéristiques des généralistes en secteur 2,
23). Or, le revenu des médecins libéraux est négativement corrélé avec la durée de la consultation puisque ces
médecins sont payés à l’acte. Le choix d’une qualité de soins différente implique donc potentiellement une baisse
de revenu horaire que vient limiter ou contrecarrer le passage en secteur 2. Quoi qu’il en soit le dépassement
d’honoraires ne se traduit pas toujours par un revenu annuel plus élevé. En conséquence, l’installation en secteur 2
ne découle pas d’un comportement maximisateur du revenu. Il témoignerait plutôt de la recherche d’un “ revenu -
cible ” : le médecin se fixerait un niveau de revenu et ajusterait son activité, quantitativement comme
qualitativement, en conséquence.

5
(c) Il ne suffit pas de relever que les honoraires sont les mêmes à l’intérieur d’une région, d’une ville ou d’une zone
géographique déterminée. Il faut aussi noter que ce sont dans les régions où les médecins sont les plus nombreux –
par exemple en Ile-de-France ou en Provence - Alpes - Côte d’Azur – que le secteur 2 est le plus développé (15).
Ce n’est donc pas la rareté qui entraîne la hausse des prix.
La suite de l’article cherche à rendre compte de ces deux faits stylisés.
2. Honoraire, différentiation et signal de qualité
Le signal est, depuis Spence (24), un moyen pour l'acheteur d'acquérir de l'information sur la qualité offerte par le
vendeur. Cette notion générale est fréquemment mobilisée par la théorie économique pour saisir une relation bilatérale
en présence d'un problème d’asymétrie sur la qualité.
Appliquée à la relation médecin - patient, le signal peut tout d'abord être assimilé au diplôme de docteur en médecine.
Mais, ce signal est le même pour tous les médecins et ne peut permettre de distinguer la qualité spécifique de l’un
d’entre eux2. De même, la publicité, fréquemment invoquée par la littérature pour signaler la qualité des biens, n'est pas
pertinente en médecine puisqu'elle y est interdite3.
Si le prix ne pouvait pas, non plus, refléter la qualité tant qu’il était administré, il devient légitime de se demander si les
médecins se servent du prix comme signal d’une qualité spécifique.
2.1 La liberté des honoraires
Avec l'instauration du secteur à honoraires libres, la notion de prix comme signal de qualité peut devenir pertinente car
elle introduit les deux éléments suivants:
· Un élément de segmentation. Jusqu'en 1990, les médecins libéraux ont pu choisir entre les deux secteurs. Il
existe dès lors une segmentation tarifaire des médecins de l’ordre de 3/4; 1/4.
· Un élément de marché. En se substituant au droit permanent à dépassement qui était déjà attribué à certains
médecins, la convention médicale de 1980 permet a priori aux médecins d’appliquer le principe déjà mentionné par
Chamberlin (8), selon lequel prix élevé et qualité vont souvent de pair, et de signaler ainsi la qualité particulière de leur
prestation.
1Notre revue de la littérature ne prétend pas à l’exhaustivité.
2Il ne joue qu’un rôle de barrière à l'entrée de la profession en excluant tout ceux qui prétendent soigner comme les guérisseurs. La qualité "générale",
signalée par le titre de “ docteur en médecine ”, n'est suffisante que pour certaines prestations standards comme les vaccinations ou le traitement des
maladies bénignes comme la grippe, qui peuvent être considérées par le patient comme des actes... sans qualité. Dans ces cas précis, les médecins sont
interchangeables.
3Arrow (1) notait d'ailleurs dans son article fondateur de la micro-économie de la santé que l'une des différences essentielles entre le médecin et
l'entrepreneur est la prohibition de la publicité et de la compétition.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%