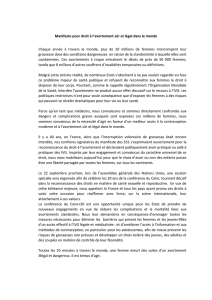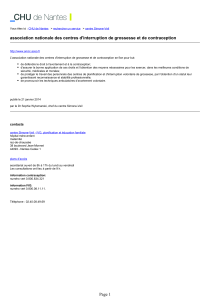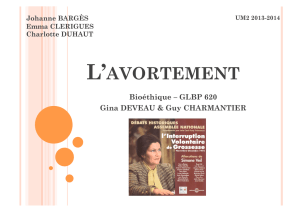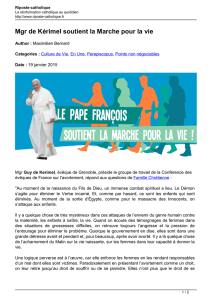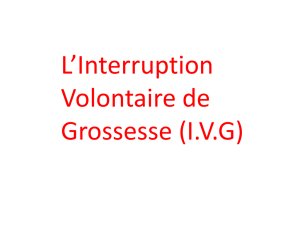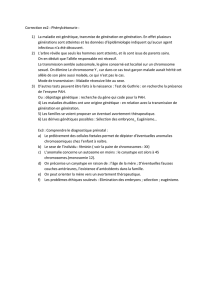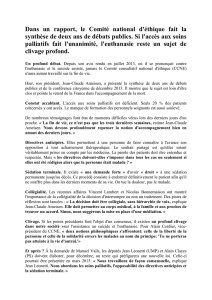2. L`Interruption médicale de grossesse

Master Droit de la famille
Pratique judiciaire
Mort et Science
SOMMAIRE
INTRODUCTION
I- Le combat de la science contre la mort
A- La mort comme condition de vie
1- Qu'est ce que le don?
2- Le problème du consentement
B- Les progrès de la médecine pour la vie
1- La recherche médicale : instrument du progrès
2- L'acharnement thérapeutique : la vie à tout prix
II-La science au service de la mort
A'- La volonté d'une mort digne
1/ L'euthanasie ou comment la science donne la mort
2/ Les soins palliatifs ou comment la science accompagne la mort
B'- La mort avant la vie
1/ IVG
2/ IMG
3/ Eugénisme
BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION
S'interroger sur la mort c'est s'interroger sur la vie.
Or, comme le disait Xavier Bichat, médecin biologiste et physiologiste français, « la vie est
l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort ».
A contrario donc la mort survient quand ces fonctions ont cessé de résister. Autrement dit, la
mort correspond tout simplement à la fin de la vie.
Ce qui nous intéresse ici c'est quand et selon quel critère pour la science, entendue comme la
science médicale, la vie cesse et donc que la mort survient. Notre étude exclue l'approche de
la mort par les autres sciences telles que les sciences humaines. Seule l'approche scientifique
de la médecine sera envisagée.
De façon traditionnelle la mort médicale correspond à un arrêt cardiaque et respiratoire qui se
caractérise par trois critères lesquels sont l'absence totale de conscience et d'activité motrice
spontanée, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et enfin l'absence totale de
ventilation spontanée.
Progressivement cette définition s'est élargie, élargissant par la même occasion le concept
même de mort. Le problème était celui des personnes assistées par ventilation mécanique et
qui ont conservé une fonction hémodynamique. En ce cas la science impose de vérifier le
caractère irréversible de la destruction encéphalique par deux électroencéphalogrammes nuls
et aéractifs effectués à une heure d'intervalle minimal de quatre heures ou par un angiographe
objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique. En effet, la communauté scientifique
s'accorde à dire que la destruction du système nerveux central est un stade irréversible et à
l'heure actuelle aucun médecin n'a jamais pu rétablir une activité cérébrale. Ces personnes ne
vivent plus elles survivent artificiellement. Sans la science et ses techniques la mort serait
survenue naturellement depuis longtemps.
Et donc, si pendant longtemps la définition médicale de la mort était cardiovasculaire, elle est
devenue principalement aujourd'hui cérébrale. En effet, si autrefois c'était le cadavre qui
faisait la mort aujourd'hui ce n'est plus le cas. La mort ne se montre plus, elle se démontre
scientifiquement par un coma dépassé qui traduit la perte totale et irréversible de l'activité du
cerveau et du tronc cérébral. La frontière entre le vivant et le mort s'estompe. Le coeur peut
battre, le corps resté chaud, l'homme est pourtant déjà mort pour les médecins comme pour la
loi. Le critère de la mort par la destruction du cerveau étant aujourd'hui le critère unique et
invariable au sens médicale comme juridique.
C'est pourquoi il faut essayer d'appréhender la mort dans son acception médicale et
scientifique c'est à dire au regard de la façon dont la médecine s'en préoccupe. A cet égard il
faut observer deux courants, deux approches. Une science qui va lutter et combattre cette mort
pour la repousser encore et encore et une science qui au contraire va l'aider, l'accompagner
voire la provoquer.
A ces approches, il faut intégrer nécessairement tous les problèmes moraux posés par
l'avancée de la science, sa capacité à repousser les limites du vivant et du mort.
C'est toute la question éthique qui s'est traduit par une réaction législative sans précédent en
1994 réitérée en 2004. Ces lois dites lois de bioéthiques sont le fruit de l'ensemble des
recherches qui portent sur les problèmes moraux suscités par l'emploi de nouvelles techniques
biomédicales. Les interventions sur le patrimoine génétique, l'euthanasie, les soins palliatifs,
le prélèvement d'organes et l'expérimentation sur l'être humain sont autant de problèmes, qui
nécessite une réflexion pluridisciplinaire, portant sur les pratiques de la biologie et de la
médecine, en vu de leur assigner des limites éthique, qui relèvent donc de l'ordre social de la

morale constituant des règles d'action et des valeurs qui fonctionnent comme normes dans une
société
1
. A cet égard a été crée un comité national consultatif éthique pour les sciences de la
vie et de la santé composé de personnalité éminentes des mondes médical, scientifique,
philosophique et religieux qui émettent des recommandations qui font autorité.
La question qui se pose est alors de comprendre comment la science utilise la mort et plus
précisément comment elle essaie de la combattre pour repousser l'inéluctable (I). Pour ensuite,
voir comment la mort se sert de la science, autrement dit comment la science peut devenir le
bras armé de la mort (II).
I- Le combat de la science contre la mort
Grâce à la science, la mort a pu devenir un allié pour la vie (A) tout en restant l'ennemi de
toujours qu'il faut vaincre (B).
A- La mort comme condition de vie
Par nature la vie n'est pas conditionnée par la mort. La vie procède d'elle-même, même si à
l'origine un matériel biologique est nécessaire, elle n'a besoin que d'elle même pour se
maintenir par la suite. De sa poursuite ne nécessite pas en principe la perte d'une autre vie.
C'est l'homme qui a introduit un tel « échange » en dehors de tout devoir de responsabilité
d'un individu envers un autre. Et si la nature n'exige pas de payer une vie d'une mort, l'homme
a introduit cet enchevêtrement de situations. Ainsi la mort se met au service de la vie au
travers du don d'organes qui a pu se développer grâce aux avancées de la science quant à la
technique de la greffe. Le don ici envisagé est celui qui procède d'une personne décédée pour
une personne dont la vie est en sursis. La mort devenant alors condition de vie grâce à la
science
2
.
1- Qu'est-ce que le don?
D'un point de vu juridique, le droit associe don et donation qu'il définit comme étant un
contrat par lequel une personne (le donateur) transfère la propriété d'un bien à une autre (le
donataire) qui l'accepte sans contrepartie et avec intention libérale. De ce point de vu la
donation peut se faire entre vif, elle est alors conventionnelle et irrévocable ou par testament,
elle est alors unilatérale et librement révocable.
Mais la question qui se pose est comment le droit appréhende cette notion lorsqu’elle
l'envisage dans la sphère de la médecine et de la recherche.
A cet égard le terme de don désigne l'acte de prélèvement d'une partie du corps humain sur
une personne en vue de le transplanter sur une autre. Le don constitue alors un prélèvement.
L'organe étant indispensable à la vie le don d'organe est conditionné par la mort d'un autre
individu. Il était donc indispensable que la société pose un cadre à cette pratique.
1
« A quoi sert la bioéthique ? » Jean-Paul Thomas. Les petites pommes du savoir.
2
« Les éléments du corps humain, la personne et la médecine » Emmanuelle Grand, Christian Hervé, Grégoire
Moutel. L'harmattan.

Gratuité, volontariat, anonymat sont les trois caractéristiques revendiquées par les lois dites
bioéthiques de 1994 pour rendre possible le don d'organe.
La gratuité tout d'abord, qui traduit la volonté de soustraire les pratiques de transplantation du
domaine économique. Il est clair que sont évités ainsi les dérives et les abus entrainé par
l'appât du gain ou l'exploitation de la misère d'individu qui n'aurait comme unique ressource
que leur propre corps.
L'anonymat, ensuite, qui protège les individus de tout abus et tout génération de situation
pathologique consécutive à la douleur d'avoir perdu un proche pour les familles des donneurs
ou à la culpabilité d'avoir bénéficié de la mort d'une personne pour le receveur.
Et pour finir, le volontariat qui pose la reconnaissance de la liberté d'un individu à déterminer
par lui même ce qu'il choisit de faire ou de ne pas faire. C'est ce que certains auteurs appellent
le respect de l'autodétermination du sujet
3
.
Mais, sur ce point la loi se contredit dans ses principes lorsqu'elle substitue à la volonté non
exprimée d'une personne décédée le consentement présumé.
2- Le problème du consentement
En effet, les donneurs d'organes les plus nombreux sont des personnes en état de mort
cérébrale. C'est de leur état que se trouve la source principale de difficultés puisque ces
personnes ne peuvent par essence exprimer aucun consentement.
Cependant, il est un principe posé par la loi Caillavet de 1976 qui veut que toute personne non
inscrite sur le registre national automatisé des refus de prélèvement d'organe est
potentiellement donneurs dés lors que sa mort cérébrale est constatée. Et ce au nom du
principe de solidarité. Ce principe vient empiéter sur les droits fondamentaux de chacun en
déclarant toute personne en état de mort cérébrale consentante.
Mais, il faut noter que la pratique médicale a du mal à se résoudre à prélever sans l'accord de
la famille à défaut de pouvoir obtenir celui du défunt. Mais si ce recours à la famille paraît le
plus direct pour obtenir la position du défunt à l'égard du prélèvement, il n'est pas toujours le
plus légitime, les relations de la personne avec sa famille n'étant pas toujours facile à
appréhender.
Par ailleurs, la famille se trouve dans une situation délicate. En effet, qu'elle refuse ou accepte
le prélèvement elle prend le risque d'aller à l'encontre de la volonté du défunt; et si elle refuse
elle prive un individu d'une chance de survie. Rappelons que cette décision se prend dans un
contexte de douleur et de deuil.
Le problème majeur vient de la définition même de la mort cérébrale, en effet, si elle a
comme principal intérêt de pouvoir prélever des organes pour rendre possible des greffes et
donc pouvoir sauver d'autre vie, elle remet en cause la vision traditionnelle de la mort puisque
la personne respire toujours, son cœur bat encore!!Des questions éthiques se posent alors : à
partir de quand est-il moralement possible au médecin de mettre un terme à la vie du patient
dont le cœur bat encore mais dont le cerveau est définitivement mort ? A partir de quand est-il
moralement acceptable de prélever des organes ?
C’est pourquoi, il semble nécessaire d'informer dans le but non pas d'obtenir des organes à
tout prix mais d'alimenter une réflexion suffisamment documentée pour permettre une prise
de décision face aux dons d'organes bien antérieure au décès. Ainsi, le choix qui serait pris en
amont permettrait aux soignants comme aux familles de se libérer d'un choix à faire en lieu et
place de l'intéressé.
3
« Les éléments du corps humain, la personne et la médecine » Emmanuelle Grand, Chritian Hervé, Grégoire
Moutel . L'harmattan.

Ce qu'il faut comprendre c'est que pour la famille du donneur admettre le prélèvement revient
alors au sens le plus fort du terme accepter la mort de l'être aimé, ce qui expliquerait les
réticences des familles qui viennent d'apprendre le décès d'un proche qui pourtant respire
encore grâce à la technique de la ventilation artificielle mais dont le cerveau est
définitivement mort sans aucun espoir d'amélioration avec le temps.
La difficulté est là, la science permet de maintenir en vie des personnes qui naturellement sans
l'intervention de l'homme serait mort. La science repousse ainsi les limites du vivant mais cela
pose d'innombrable question sur le devenir de ces Hommes. En effet, car même si la personne
est médicalement considérée comme morte, son cœur ne cessera de battre qu'une fois que son
assistance respiratoire sera débranchée. Dans ce cas « débranché quelqu'un » est-ce lui ôter la
vie ? Quelle signification ce geste prend t-il alors ? Tout simplement cela revient à se
demander si maintenir en vie c'est maintenir la vie ?
Ainsi, la science par ces progrès créée de nouvelles situations qui posent des problèmes
auxquels chacun peut avoir sa propre réponse en fonction de ses convictions personnelles.
Mais, il reste indéniable que la mort grâce aux progrès de la science est devenu un moyen de
sauver des vies tout en posant le problème de savoir ce qu'est la vie et quand cesse t-elle ?
Mais la science médicale ne s'est pas arrêté là, elle continue encore et toujours à vouloir
reculer le plus possible le moment de la mort par le biais de la recherche.
B- Les progrès de la médecine pour la vie
Ils sont l'outil premier de l'augmentation de notre espérance de vie. Ils nous permettent de
vivre plus longtemps dans de meilleure condition physique. Mais jusqu'où peut aller la
recherche pour nous sauver chaque jour un peu plus ? Jusqu'où ira t-on ? Jusqu'où avons-nous
le droit d'aller ?
1- La recherche médicale : instrument du progrès
Tout d'abord, il convient de définir exactement ce qu'il faut entendre par recherche médicale.
La recherche médicale est un travail scientifique qui permet à l'homme d'améliorer ses
connaissances dans le domaine de la santé. Mais, ce qui nous intéresse plus particulièrement
c'est surtout la recherche biomédicale qui recouvre tout essai ou expérimentation organisé ou
pratiqué sur l'être humain en vu du développement des connaissances biologiques et
médicales. Le plus souvent cela consiste à observer les effets d'un nouveau traitement par
comparaison avec un traitement classique ou une absence de traitement.
Bien entendu ces essais sont réalisés par l'homme sur l'homme. Dès lors, il faut poser les
limites de ce qu'il peut se faire. Et il semble nécessaire de trouver un juste équilibre entre la
liberté de la recherche, les droits des malades et le respect des valeurs essentielles de notre
société
4
.
C'est ce qui a été recherché dés 1947 avec le code de Nuremberg issus du procès des
médecins nazis qui a introduit la nécessité d'affirmer des principes éthiques clairs qui doivent
s'imposer à tous chercheurs et médecins lors de recherches et ceci en réaction aux
expérimentations faites par les nazis dans les camps qui ont profité de la « chair humaine
disponible à volonté » pour procéder à toutes sortes d'expériences au gré de leurs fantaisies
souvent sadiques qui ont aboutit à la mort ou bien ont fait de la vie de « ces cobayes humain »
un véritable enfer.
4
Http://www.inserm.fr Institut national de la santé et de la recherche médicale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
1
/
35
100%