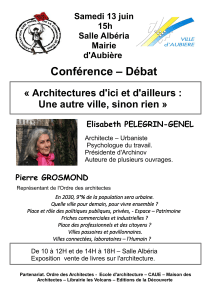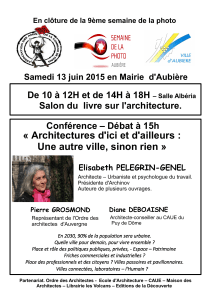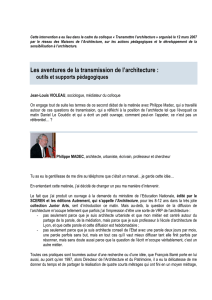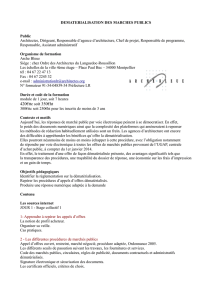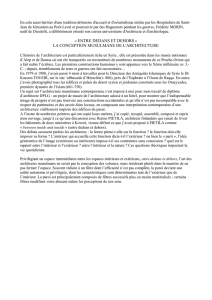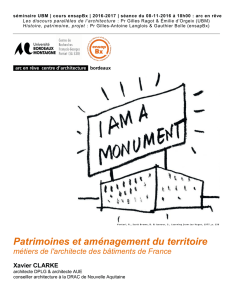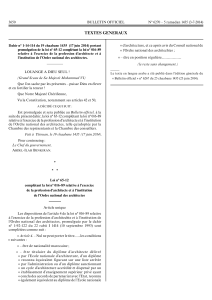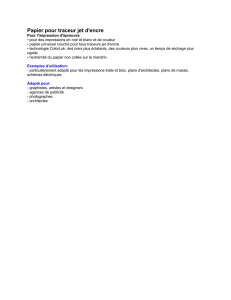Mémoire - Consultation sur la pol. culturelle Août 2016

Construire le patrimoine de demain :
pour une politique culturelle qui défend
la qualité architecturale dans notre société
Mémoire déposé au Ministère de la Culture et des Communications
par l’Association des Architectes en pratique privée du Québec
(AAPPQ)
Consultation publique sur le renouvellement de la politique culturelle du Québec
août 2016

2
Présentation de l’AAPPQ
Organisme à but non lucratif créé en 1977, l’Association des Architectes en pratique privée du Québec
(AAPPQ) représente et défend les intérêts de près de 400 firmes d’architecture de toutes tailles
auprès des pouvoirs publics et des donneurs d’ouvrage.
Sa mission : renforcer le rôle de l’architecte en pratique privée, qui, en tant qu'un des principaux
garants de la qualité du milieu bâti, participe activement au développement économique, social et
culturel de la société québécoise.
Dans le cadre de ses activités, l’AAPPQ collabore notamment avec les ministères (Secrétariat du
Conseil du trésor, Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Ministère de la
Culture et des Communications, etc.), organismes publics (Société québécoise des infrastructures,
Régie du bâtiment du Québec, etc.) ou encore les municipalités, pour améliorer la commande publique
afin de favoriser la qualité des bâtiments au Québec. En participant à des consultations ou à des
groupes de travail, l’AAPPQ contribue à améliorer les collaborations entre donneurs d’ouvrage et
professionnels de l’architecture. L’Association établit également des relations durables et
constructives avec les autres acteurs de l’industrie de la construction (ingénieurs, autres professions
du design, entrepreneurs, architectes des autres provinces canadiennes, etc.) afin d’améliorer la
collaboration dans ce milieu pluridisciplinaire et complexe.
www.aappq.qc.ca

3
En résumé
Le Québec favorise toutes les opportunités de se positionner par la mise en valeur du talent créatif et
de ses innovations dans différents domaines culturels (musique, création numérique, audiovisuel,
édition, etc.). L’architecture - et l’architecte - ne bénéficie pas du même traitement favorable dans les
programmes et politiques publiques, alors que l’architecture est une composante importante de
l’identité culturelle d’une société. Ceci est notamment dû au fait que l’architecture est une discipline
transversale « orpheline », sans réel ministère de tutelle.
L’AAPPQ souhaite donc que la volonté de défendre, encourager et promouvoir l’architecture de
qualité soit inscrite dans la prochaine politique culturelle du Québec, portée par le Ministère de la
Culture et des Communications. Elle doit s’appuyer sur trois grands axes énoncés ci-après, avec des
pistes de recommandations correspondantes :
Favoriser une approche globale et une nécessaire coordination des pouvoirs publics sur la qualité
architecturale
1. Mise en place d’une politique nationale de l’architecture pour encourager les pouvoirs publics à
améliorer la qualité du patrimoine bâti.
2. Création d’une instance de coordination interministérielle pour superviser l’ensemble des
actions, lois et règlements qui régissent le cadre bâti, pour en favoriser la qualité.
Recentrer la commande publique autour de la qualité architecturale
3. Confirmation du rôle central de l’architecte comme concepteur et gestionnaire dans les projets
de construction, en favorisant :
L’attribution de mandats qui permettent une vision continue de l’architecte, depuis la
planification, la conception, la coordination jusqu’à la surveillance ; en évitant de morceler les
mandats en architecture.
Le recours à des professionnels en architecture en amont des projets, dès les étapes de
planification et tout au long du processus.
4. Reconnaissance des architectes en tant que professionnels et créateurs, en :
Revalorisant la portée du travail des architectes par la révision du Décret définissant le tarif
d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes.
Réaffirmant que les ouvrages conçus par des architectes sont protégés par le droit d’auteur.
Encourageant l’apposition du nom des architectes concepteurs sur les bâtiments publics.
5. Mise en place d’instances et d’outils pour accompagner les donneurs d’ordre publics dans la
réalisation de projets de construction.
6. Uniformisation du mode d’adjudication de contrats publics pour services d’architecture avec le
modèle aujourd’hui en vigueur pour les ministères et organismes.
Stimuler la création en architecture pour en faire un levier de croissance économique
7. Ouverture de la commande publique à la relève et l’innovation en :
Favorisant l’organisation de concours d’architecture pour tous les donneurs publics, au-delà
des bâtiments culturels.
Assouplissant les critères de sélection des bureaux d’architectes pour la commande
publique.
8. Favoriser les approches par objectifs dans les codes de construction et simplifier les procédures
de dérogation pour permettre l’innovation
9. Soutenir le recours à des architectes dans tous les projets de construction, en :
Abaissant le seuil de superficie qui rend obligatoire le recours à un architecte.
Simplifiant les démarches administratives pour tout projet porté par un architecte.

4
Introduction
L’architecture est une composante importante de l’identité culturelle d’une société. Parce qu’elle est le
reflet des modes de vie et de leur évolution, elle est l’expression d’un héritage culturel populaire et
durable. Le patrimoine architectural ne concerne pas seulement les édifices à caractère historique : les
constructions d’aujourd’hui sont le patrimoine bâti de demain, avec une durée de vie qui s’étale sur des
décennies, voire des siècles.
L’architecture est omniprésente, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Elle a donc un
impact sur la qualité de vie de tous les citoyens. Si elle est accessible au plus grand nombre, elle
s’impose aussi à tous. En effet, les citoyens choisissent d’aller voir un concert, une exposition ou de lire
un livre : ils choisissent rarement leur environnement bâti : c’est leur cadre de vie.
L’architecture est une discipline multidisciplinaire de création et d’innovation, et l’architecte en est le
pivot. Au cœur de la planification des besoins et de la conception, l’architecte doit être considéré et
valorisé en tant que créateur, et son rôle affirmé au cœur de l’identité culturelle architecturale
québécoise.
L’architecture, c’est aussi une discipline créatrice de valeur économique. Un environnement bâti de
qualité a des impacts sociaux, économiques et culturels importants. La qualité des bâtiments augmente
la valeur économique des communautés et l’attrait des municipalités et des régions (affaires,
touristique, etc.). Elle améliore également la qualité de vie des habitants et la productivité des
travailleurs. Les enjeux environnementaux et énergétiques actuels supposent aussi que les bâtiments
soient durables et innovants.
Si la dernière politique culturelle traitait déjà d’architecture en affirmant son rôle pour la société et en
énonçant de grands principes sur la qualité du cadre bâti, les impacts tangibles ont été timides, se
limitant essentiellement aux équipements du domaine culturel et à la protection du patrimoine
existant. Le renouvellent de la politique culturelle est une occasion unique d’affirmer la volonté du
Québec d’aller plus loin et de considérer les dimensions culturelles et d’intérêt public de l’architecture.
Au-delà de la protection et la valorisation du patrimoine bâti existant, la politique culturelle doit
s’attacher à énoncer les grands principes qui favoriseront le développement qualitatif du patrimoine
bâti de demain, c’est-à-dire des bâtiments fonctionnels, harmonieux et durables. Ils devront s’appuyer
sur :
Une vision collective et une nécessaire coordination entre les différents pouvoirs
publics : ministères, municipalités et organismes publics.
Une commande publique qui favorise la qualité architecturale, valorise et encourage le rôle
central de l’architecte dans tous les projets de construction, pas seulement dans le domaine
culturel ou la protection du patrimoine.
Une reconnaissance de l’importance économique de la création architecturale, en encourageant
des initiatives qui permettent l’innovation, le développement de talents locaux et l’émergence
d’une relève de qualité, dans un marché de plus en plus concurrentiel et international.
Ce mémoire est complémentaire à celui déposé par l’Ordre des architectes du Québec, dont l’AAPPQ
partage la plupart des recommandations. Il se concentre davantage sur les questions économiques et
liées à la commande publique, pour favoriser la qualité architecturale.
L’AAPPQ propose bien entendu son entière collaboration au Ministère de la Culture et des
Communications pour l’étude et la mise en place de ces recommandions, dans le cadre de groupes de
travail ou de consultations ultérieures.

5
L’AAPPQ recommande que la nouvelle politique culturelle fasse mention de la mise en place d’une
politique nationale de l’architecture pour encourager les pouvoirs publics à améliorer la qualité du
patrimoine bâti.
L’AAPPQ recommande la création d’une instance de coordination interministérielle pour superviser
l’ensemble des actions, lois et règlements qui régissent le cadre bâti, pour en favoriser la qualité.
Favoriser une approche globale et une nécessaire coordination des pouvoirs
publics
Une approche globale et cohérente pour le cadre bâti québécois
Le cadre bâti fait partie des réflexions actuelles et futures pour atteindre les objectifs de réduction des
gaz à effet de serre (efficacité énergétique des bâtiments, problématique d’étalement urbain et de la
mobilité, recyclage de bâtiment, etc.) et les pouvoirs publics vont investir des milliards de dollars, que
ce soit au niveau provincial avec le plan québécois des infrastructures ou fédéral avec les annonces
récentes du gouvernement. Il est alors primordial de réaliser tous ces projets avec cohérence et vision
commune, afin d’éviter les erreurs du passé, que ce soit en termes de qualité des infrastructures ou de
planification.
Quelles ambitions a-t-on pour le cadre bâti et les espaces publics au Québec ? Sur quels critères
qualitatifs fonder les bâtiments de demain ? Comment favoriser la qualité en architecture dans les
domaines publics et privés ? Comment allier objectifs de développement durable et nouvelles
constructions ? Comment favoriser les approches multidisciplinaires pour favoriser l’innovation ?
Quelles actions mettre en place pour sensibiliser les citoyens à la qualité de leur environnement bâti ?
Toutes ces questions – et bien d’autres – sont légitimes et nécessaires pour que le Québec ait une
approche globale cohérente.
Comme le préconise l’Ordre des architectes du Québec et comme l’ont fait de nombreux pays dans le
monde, l’AAPPQ est favorable à l’élaboration d’une politique nationale de l’architecture, afin que le
Québec définisse une vision collective de l’avenir de son identité culturelle architecturale. Cette
politique permettrait aussi de préciser de nombreux points que nous abordons dans ce mémoire.
Une meilleure coordination des pouvoirs publics
L’architecture est un domaine transversal et multidisciplinaire, intégré à une industrie de la construction
hétérogène, à la croisée des missions de nombreux ministères et organismes, et dépendantes de nombreuses
normes et lois. Entre le Ministère de la justice pour la loi sur les architectes, le Ministère du travail et la Régie du
bâtiment pour le code du bâtiment ou le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
pour tout le cadre bâti des villes et le Ministère de la Culture et des Communications pour le patrimoine – pour
ne citer qu’eux – l’architecture touche aujourd’hui une douzaine de ministères et organismes publics.
Force est de constater que le cadre bâti souffre d’un manque criant de coordination et de
transversalité entre tous ces acteurs. L’harmonisation entre les lois et normes qui régissent le cadre
bâti est difficile et manque de cohérence. Il est souhaitable de mettre en place une instance de
coordination transversale et interministérielle, afin de favoriser les conditions de la qualité des
ouvrages, y compris l’octroi de contrats dans le domaine du cadre bâti. La Mission Interministérielle
pour la Qualité des Constructions Publiques, créée en France à la fin des années 70 et toujours active,
est à cet égard un exemple intéressant à suivre.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%