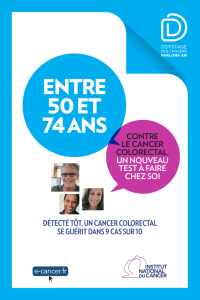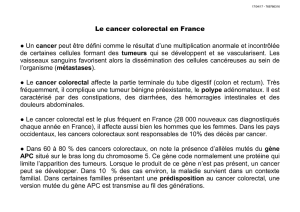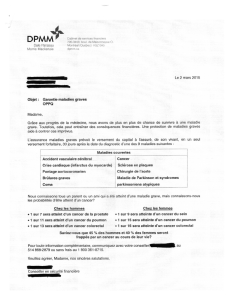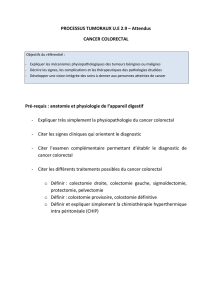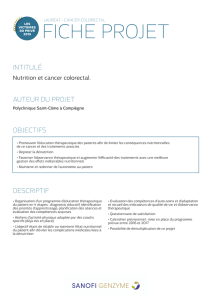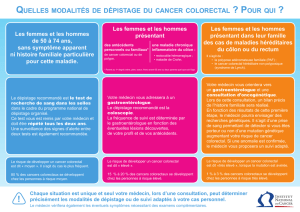Éditorial Le cancer gastrique :une maladie d`origine

>SUPPLÉMENT ÀLA LETTRE DU CREGG
Mai 2005
Assertion éton-
nante s’il en
est,quicependant
semble bien être la
conclusion d’une
étude de Jean-
Marie Houghton
et Timothy C.
Wang (Department of Medicine and Cancer Biology,
University of Massachusetts MedicalSchool,Worcester,
MA 01605,USA) publiée récemment dans lapresti-
gieuse revue«Science»[1].
Ilaété démontréchez l’homme que l’infection à
Helicobacter( H )pyloripouvait être responsable d’une
succession de modifications de lamuqueuse gastrique
avec apparition d’une atrophie,puis d’une métaplasie
intestinale faisant place,à son tour,à une dysplasie pour,
finalement,aboutir parfois à uncancer épithélial. Le pro-
cessus inflammatoirefavorisant l’apparition du cancer a,
par ailleurs,été rapportéà une migration de cellules
dérivées de lamoelle osseuse (BMDCs pour Bone
Marrow-derived cells) dans les tissus périphériques.Une
véritable invasion de BMDCs est même observée dans
les tissus sièges de lésions inflammatoires sévères àl’ori-
gine de phénomènes d’apoptose marqués,les BMDCs
pouvant alors remplacer progressivement les cellules tis-
sulaires «natives» dont le nombre décroît rapidement.
Lebut de l’étude,ici présentée,était de définir le rôle
des BMDCs dans le déroulement de la séquence«gas-
triteatrophique,métaplasie intestinale,dysplasie,can-
cer»associée à une infection àH.felischez la souris
C57BL/6,c
orrespondant au meilleur modèle animal de
cancérogenèse gastrique.
Méthode :Les animaux étaient d’abord soumis à une
irradiation corporelle totale détruisant leur moelle
osseuse,puis bénéficiaient d’une greffe de moelle dotée
d’une enzyme spécifique (la X-galactosidase) repérable
par la coloration bleuecaractéristique qu’elle confèreà
la cellule. Ils étaient alors infectés par H.f
elis .
Résultats :Àlaphaseaiguë,il existait une inflamma-
tion intenseavec apparition de BMDCs mais sans
aucune destruction architecturale significativede la
muqueuse gastrique,ni repopulation par les BMDCs.
Cependant progressivement,avecl’apoptose des cellu-
les épithéliales gastriques débutant entre la 6eet la8e
semaine,les BMDCs les remplaçaient pour représenter,
au bout d’unan,plus de 90% de lamuqueuse gas-
trique. Les cellules métaplasiques quiapparaissaient
Éditorial
Lecancer gastrique:une maladie d’origine médullaire!
o.6
l’actualité en oncologie digestive
ISSN :1261-7458
alors se révélaient êtrecolorées en bleu et doncd’ori-
gine médullaire,tout comme les cellules dysplasiques et
carcinomateuses qui leur succédaient tour à tour.Toutes
ces cellules d’origine médullaire présentaient,celadit,
un phénotype épithélial puisqu’elles se révélaient «pan-
cytokératines» positives en immunohistochimie. Les
auteurs concluaient donc à une différentiation partielle
des BMDCs en cellules épithéliales gastriques puisqu’ils
étaient,par ailleurs,capables d’éliminer,par 3 types
d’arguments,l’hypothèse de leur fusion avec ces derniè-
res.Demanière intéressante,ils notaient également
qu’un ulcère gastrique,induit par injection d’acide acé-
tique ou application d’une cryode,ne s’accompagnait
pas d’une infiltration de BMDCs quiapparaît ainsi plu-
tôt en rapport avec un processus inflammatoire d’ori-
gine microbienne. Enfin,les auteurs purent démontrer
que les BMDCs,ici en cause,provenaient non de pré-
curseurs hématopoïétiques mais plutôt de cellules
médullaires mésenchymateuses.
Ainsi,l’infection àH.felischez la souris pourrait donner
lieu àlaproduction de facteurs chimiotactiles permettant
lamigration de BMDCs qui,progressivement,remplace-
raient les cellules épithéliales disparues par apoptose,et se
différencieraient partiellement tout en gardant une vulné-
rabilité particulière,aboutissant parfois àla transforma-
tion maligne. L’origine médullaire de ces cellules ma-
lignes permettrait ainsi de mieux comprendre leurs
caractéristiquesfondamentales:faible différenciation ou
indifférenciation,résistanceàl’apoptose,facilité de
migration (= pouvoir métastatique),index mitotique
élevé...
Sices notions étaient confirmées,il s’agirait d’un
bouleversement profond de nos conceptions de la
carcinogène d’origine microbienne dans ses phases
d’initiation et de progression avecles probables
implications thérapeutiques qui en découleraient.Le
cancer gastrique était devenu une maladie micro-
bienne,le voilàdoté maintenant d’une possible ori-
gine médullaire.
Référence
[1] HOUGHTON J.-M.et al .Gastric cancer originating
from bone marrow derived cells.Science2004;306:
1568-71
G.LLEDO (Lyon)

Sommaire
Secrétaire de rédaction :
GérardLLEDO (Lyon)
Comité de rédaction :
Antoine ADENIS (Lille),PascalARTRU(Lyon),
DanATLAN (Paris),HervéDAHAN (Paris),
Michel DUCREUX (Villejuif),Jérôme DUMORTIER (Lyon),
Jean-Louis GAUDIN (LePuy-en-Velay),
Rosine GUIMBAUD (Toulouse),René LAMBERT (Lyon),
Catherine LOMBARD-BOHAS (Lyon),
Christophe LOUVET (Paris),
Emmanuel MITRY(Boulogne-Billancourt),
GenevièveMONGES (Marseille),
Bertrand NAPOLÉON (Lyon),
PatricePIENKOWSKI (Montauban),
Christine REBISCHUNG (Grenoble),
Michel RIVOIRE (Lyon),J
ean-Philippe SPANO (Paris),
Julien TAIEB (Paris),EricVAILLANT (Lille)
Lecomité de rédaction de Cancéro digest souhaite recueillir vos
impressions,vos remarques et vos critiques sur cenuméroainsi que
vos suggestions pour les numéros futurs,ceciafin d’améliorer ce
bulletin d’information et de l’adapter au besoin de ses lecteurs.
N’hésitez pas ànous contacter par mail :lledogerard@aol.com
ALN ÉDITIONS 127,RUE SAINT- DIZIER 54000 NANCY
Éditorial
Lecancer gastrique:une maladie d’origine
médullaire!
G.L LEDO
Rapport de congrès
Journées Francophones de Pathologie Digestive
2005:Quoi de neuf en colorectal?
P.A RTRU,G
.L LEDO
Revue de presse:
•Épidémiologie
–Peut-on vraiment guérir d’unadénocarcinome du
pancréas?
E.M ITRY
•Dépistage
–Étude randomisée de différentes stratégies de
dépistage du cancer colorectal
R.L AMBERT
•Chirurgie
–Métastases hépatiques d’origine colorectale :
Résection après chimiothérapie seulement!
G.L LEDO
•Cancer colorectal
–Récidive locorégionale des cancers du rectum:
Quand le polymorphisme du gène d’EGFR s’en mêle !
G.L LEDO
–Fonctions sexuelles et qualité de vie après traite-
ment d’uncancer rectal:Impact de la radiothérapie
néoadjuvante
P.A RTRU
–Syndrome HNPCC et risque de cancers.Ilfaut
aussi surveiller l’intestin grêle
J.-L.G AUDIN
•Cancer de l’œsophage
–Radiochimiothérapie exclusive du cancer
de l’œsophage :L’expérienceallemande
P.A RTRU
•Carcinome hépatocellulaire
–Traitement adjuvant du CHC après transplantation
hépatique
J.D UMORTIER
Thérapies ciblées
–Cancer du pancréas avancé:entrée en scène des
inhibiteurs de tyrosine-kinase!
P.A RTRU
–Avastin®et cancer colorectal:le début d’un long
règne !
P.A RTRU
–Lymphangiogenèse:une nouvelle voie de recherche
dans le cancer colorectal
Christine R EBISCHUNG
–Profils protéomiques et résistances du cancer colo-
rectalau traitement par anticorps anti-EGFR
Christine R EBISCHUNG
–Cetuximab et positivité des récepteurs àl’EGF :la
fin d’un dogme !
GenevièveMONGES,P
.ARTRU
–Nombre de copies du gène d’EGFR: enfin un
marqueur prédictif de réponseaux traitements
anti-EGFR dans le cancer colorectal métastatique?
G.L LEDO,P
.ARTRU
–Diagnosticendoscopique et angiogenèse tumorale
R.L AMBERT
Fiche pratiqueAvastin®
G.L LEDO
Journée de Printemps de la FFCD :
Lyon,10 juin 2005
Mise en page et impression :bialec,nancy
Dépôt légal n° 62835 - mai 2005
ISBN :2-914703-13-9
EAN :9782914703130

CancéroDigest 0.6 - mai 2005 - Supplément àla Lettre du CREGG 3
–Traitement néoadjuvant du cancer
du rectum:résultats de l’essaiFFCD 9203
Si la radiothérapie (RT)adjuvante possède une place
incontestable dans le traitement néoadjuvant des can-
cers du rectum,y compris en cas d’intervention de type
TME, laplace de la radiochimiothérapie (RCT) néo-
adjuvante dans cette indication est restée,jusqu’àpré-
sent,incertaine. Deux grands essais de phaseIII qui
seront complètement présentés àl’ASCO 2005
(Orlando,mai 2005) coordonnés:l’un par la FFCD,
l’autre par l’EORTC, vont cependant permettre de sta-
tuer sur cette importante question. Nous rapportons ici
les résultats du premier essai,déjàdévoilés en grande
partie aux JFPD 2005.
Patients et méthodes:Les patients de moins de
80ans présentant unadénocarcinome rectal prouvé,
accessible au TR, classéT3 ou T4 et résécable,étaient
randomisés,après stratification,entreRT et RCT
néoadjuvantes.L’objectif principalétait de démontrer
un gain de survie à5ans de 10% (52%aveclaRT ver-
sus 62 %avecla RCT). La RT délivrait 45 Gy en 25
fractions et 5 semaines; la RCT ajoutait au même
schémade RT,une chimiothérapie (CT) par FUFOL
(acide folinique:20 mg/m2et 5FU 350mg/m2IV bolus
de J1à J5) aux première et cinquième semaines de RT.
La chirurgie était réalisée 3 à4 semaines plus tard.Tous
les patients étaient censés recevoir 4cycles de FUFOL
adjuvant en postopératoire.
Résultats :Entre 1993 et 2003,762 patients ont été
inclus dont 723 patients évaluables.Un suivi médian de
69 mois aété observé. Plus de 50% des patients pré-
sentaient des tumeurs du 1/3 inférieur,avec une pro-
portion de uN+ de 65%chez les patients ayant bénéfi-
cié d’une échoendoscopie préalable (50% de l’effectif).
La toxicité du traitement RCT a été plus importante
avec15 % de grades 3-4 versus 3% (p <0.05) mais sans
augmentation de lamortalité postopératoire précoce
(< 60 jours):1%versus 2% (NS). Le taux de réponse
complète histologique était significativement augmenté
dans le bras RCT :12%versus 4% (p <0.05). En
revanche,il n’existait pas de gain de conservation
sphinctérienne dans le bras RCT :53%vs 52% (NS).
Les résultats de survie ont étécommuniqués sans test
statistique,selon les recommandations d’uncomité
indépendant de monitorage (end-point,mai 2005),
mais il ne semble pas exister de différence en survie glo-
bale et survie sans rechuteà5ans entre les bras RCT et
RT :respectivement 68% vs 67 %,et 59 % vs 56%.
Cependant,on observeà5ans un taux de rechute locale
inférieur de moitié dans le bras RCT :8% versus
16.5 %.
QUOI DE NEUF EN
COLORECTAL ?
P.ARTRU,G.LLEDO
(Lyon)
Loin des fastes de l’an
passé,où les résultats
d’études internationales
ayant changé notre pra-
tique quotidienne avaient
été présentés,la sélec-
tion de ces JFPD 2005
afait bien triste figure!
Voicicependant notre
sélection :
–Cancer colorectalavecmétastases hépatiques
synchrones:faut-il réséquer le primitif ?
L’une des communications les plus originales de ces
Journées fut celle de l’équipe de l’IGR sur l’intérêt de la
résection de la tumeur primitive dans le traitement du
CCR métastatique. Apartir des données de l’essai
FFCD 9601,les 216 patients (73 % de l’effectif total)
avecmétastases synchrones ont été étudiés.Parmi ceux-
ci,60 avaient bénéficié avant l’inclusion de la résection
de la tumeur primitive,alors qu’elle restait en placechez
156 (73 %) d’entre eux.Les deux groupes de patients
étaient comparables entre eux saufce quiconcernait le
site tumoral (plus de rectum dans le groupe avec
tumeur en place:35%versus 14 %;p = 0.0006) et le
taux d’ACE(tendance en faveur d’un excès de patients
avecACE>30 dans le groupe tumeur en place;p=
0.06). Defaçon étonnante,il existait,en analyse univa-
riée,de meilleurs taux de survie globale et sans progres-
sion à 2 ans dans le groupe aveclésion primitive opérée
que dans le groupe avec tumeur en place:respective-
ment 24%versus 10% (p <0.0001) et 4%versus 0%
(p = 0.001). Enanalyse multivariée,lanon résection de
la tumeur primitive était bien retrouvée comme unfac-
teur de mauvais pronostic, àlafois en terme de survie
globale (RR de décès 2.3;p>0.0001) que de survie
sans progression (RR = 1.9 ;p = 0.0002). Les autres
variables retrouvées comme facteurs indépendants de
mauvais pronosticétaient,de façon classique,unOMS
2 et un nombre de sites métastatiques supérieur à1.
Cette étude rétrospectivenon randomisée semble
bien critiquable sur le plan méthodologique. Les
paramètres du bilan de baseline pris en compte sem-
blent trop restreints et on ne peut,en aucuncas,
exclure que le groupe opéré de la tumeur primitive
regroupait,en fait,des malades de meilleur pronos-
tic.Ilaurait été intéressant,par exemple,de vérifier
que les populations étaient égales en termes de
phosphatases alcalines ou d’autres critères biolo-
giques de mauvais pronostic, ainsiqued’avoir une
notion scanographique volumétrique de lamasse
tumorale hépatique déterminante pour le pronostic.
D’autrepart,sur le plan théorique,ces résultats sem-
Rapport de congrès
Journées Francophones de PathologieDigestive 2005
blent paradoxaux àl’heure où de très nombreuses
études font état d’une progression accélérée des
lésions métastatiques lors des actes chirurgicaux via
la sécrétion accrue de facteurs de croissance et d’an-
giogenèse. La question soulevée reste doncnon réso-
lue en l’absence d’étude randomisée (LouafiA6).

PEUT-ON VRAIMENT
GUÉRIR D’UN
ADÉNOCARCINOME
DU PANCRÉAS ?
E.MITRY
Le pronosticdes cancers
pancréatiques est l’un des
–Traitement adjuvant des cancers coliques
de stade III :résultats de l’essaiX-ACT
Les données de l’essaiX-ACT communiquées àl’ASCO
2004 ont été révélées au publicfrançais par J.-F.Seitz.
Nous rappellerons que,dans cet essai randomisant 1 987
patients opérés d’uncancer colique de stade III entre
FUFOL et capécitabine (Xéloda ® ),le traitement oral
avait montré une supérioritéen termes de taux de survie
sans rechuteà 3 ans (réduction de 14 %;p = 0.04) mais
sans différence de survie globale. Le profil de toxicité
était également en faveur de la capécitabine.
CancéroDigest 0.6 - mai 2005 - Supplément àla Lettre du CREGG
4
–Biologie moléculaire et CCR :
toujours de nouvelles pistes
Cette étude s’est proposée d’étudier l’expression de la
sous-unitécatalytique de la télomérasecomme facteur
pronostiqueaprès résection de métastases hépatiques
(MH) d’origine colorectale. L’activité de la télomérase
est,en effet,liée àlaprésence de cette sous-unité,
l’enzyme étant elle-même spécifique des tissus tumo-
raux.L’expression de la sous-unité peut être étudiée par
immunohistochimie au niveau du nucléole. Sur une
série rétrospective de 201 patients de l’IGR et du MD
Anderson,un marquage nucléolaire prospectif aété
retrouvéchez 43%des patients.Enanalyse multivariée,
trois facteurs de mauvais pronosticétaient isolés:ce
marquage positif (p <0.0001) ;un délaicourt d’appari-
tion des MH ;et un nombre de MH supérieur à 2.
Cette étude rétrospective pourrait ainsi permettre
de mieux sélectionner les patients candidats à une
chirurgie d’exérèse de MH d’origine colorectale
CCR (Boige A7).
–Détermination de la sensibilitéàl’oxaliplatine par
étude du polymorphisme de GST-M1
Les gluthation S-transférases sont des enzymes impli-
qués dans ladétoxyfication de l’oxaliplatine. Sur une
petite série de 41 patients,il aété montré que les
patients avecdélétion homozygote de GST-M1 obte-
naient de meilleurs taux de survies sans progression et
globales (LecomteA8). En revanche,une autre iso-
forme :G
ST
-P1était,quant àelle,a
ssociée à une plus
faible neurotoxicité,àdosecumulée égale,en cas de
mutation (40% de lapopulation) (LecomteA58).
–Trithérapie de type FOLFIRINOX:
résultats actualisés
Dans cette phaseII n’incluant que des patients avec MH
de CCR non résécables,l’objectif principal était le taux de
résection R0 des MH.Sur 34 patients inclus,le taux de
RO aété de 71%et le taux de contrôle de lamaladie de
91 %. Grâceàla chirurgie et àla radiofréquence,
près de 80% des patients ont pu bénéficier d’une
mise en rémission complète de lamaladie. La
médiane de survie globale n’apas encore étéatteinte et la
médiane de survie s
ans progression était de plus de 12
mois.La toxicité principale était hématologique (neutro-
pénie grades 3-4 chez 65%des patients) mais sans décès
toxique. Ces résultats spectaculaires,mais obtenus sur une
population sélectionnée dans des centres avec chirurgiens
experts,doivent être validés par une étude randomisée
actuellement en cours (essaiMETHEP) (Ychou A7).
–Pas de radiofréquencepercutanée
en cas de MH accessibles à une chirurgie ?
Une étude rétrospective de l’IGR a montré que,sur 506
patients candidats à une chirurgie de MH d’origine
colorectale opérés après bilan d’imagerie soigneux (au
moins deux examens différents mais sans pet-scan),
41 % présentaient en peropératoire des métastases non
détectées en imagerie mais qui purent toutes être résé-
quées.Si on ne retient que les patients aveclésions
cibles initiales de moins de 30mm de plus grand dia-
mètre (et avecmoins de 3 lésions)quiauraient pu être
candidats à un traitement percutané,ce taux demeure
identique (40%). Ne pas avoir bénéficié d’une explora-
tion chirurgicale aurait donc conduit à une perte de
chance importante pour ces patients (Elias A59).
Revuede presse:
Épidémiologie
Ces résultats étaient toutefois pondérés par l’ora-
teur dans sa conclusion par rapport aux résultats de
l’étude MOSAIC qui retrouvait ungain de survie sans
rechuteavecle FOLFOX 4 nettement plus significatif,
et représente doncle standardactuel dans cette
indication (Seitz A 21).
Aut
otal,c
es résultats même préliminaires montrent
ungain net en terme de down-staging et surtout de
taux de rechute locale à5ans en faveur de la RCT
néoadjuvante par rapport àlaRT néoadjuvante des
cancers du rectum. Le taux élevé de rechute locale
dans le bras RT seule,mais aussi dans le bras RCT,
s’explique probablement par une chirurgie non opti-
male avec, en début de recrutement,une mauvaise
diffusion de la technique d’exérèse totale du méso-
rectumdans unessailargement multicentrique. Le
prochain essaiintergroupe français devrait mainte-
nant évaluer des protocoles optimisés de RT avec
dose plus importante (50 versus 45 Gy) et chimio-
thérapie renforcée (XELOX versus capécitabine
seule). Enattendant,la RCT préopératoiredevrait
logiquement devenir le traitement de référence des
lésions T3-T4 des bas et moyen rectums.Rendez-
vous àl’ASCO 2005 pour confirmation ! (Bouché O).
plus effroyables avec un taux de survie relativeà5ans
inférieur à5%en Europe (Étude Eurocare 3). Les don-
nées présentées par Carpelan-Holmstrom et al. suggè-
rent que la réalité serait encore pire et laprobabilité de
survie àlong terme,en cas d’adénocarcinome canalaire
du pancréas même diagnostiquéà un stade précoce et
opéréà visée curative,quasi nulle.

Quatre mille neufcent vingt-deux (4 922)cas de can-
cers pancréatiques (code ICD-C25 selon la
Classification Internationale des Maladies) ont été enre-
gistrés au Registre des Cancers de Finlande au cours de
lapériode 1990-1996.Seuls,89 patients (1.8 %) étaient
vivants 5ans après le diagnostic.
Lecompte rendu anatomopathologique initialamontré
que 70% des longs survivants d’uncancer du pancréas
n’avaient pas unadénocarcinome canalaire mais un
autre type de tumeur maligne (cystadénocarcinome,
ampullome,tumeur endocrine),une tumeur bénigne ou
qu’il n’y avait pas de preuve histologique suffisante
(cytologie seule ou absence totale de preuve). Seuls,
26/89 cas étaient étiquetés «adénocarcinome canalaire».
Une relectureanatomopathologique en aveugle,par
3pathologistes confirmés de 24/26 cas,aété effectuée... et
le diagnosticd’adénocarcinome canalaireconfirmé dans
10 cas seulement!Les autres cas correspondaient à une
TIPMP dégénérée (2 cas),une tumeur pseudo papillaire
(1 cas),une tumeur maligne des voies biliaires (8 cas),un
cystadénome séreux (1 cas) ou une pancréatite (2 cas).
La survie médiane des patients encore vivants à5ans
n’était que de 5.4 ans (rang :5.08-13.4) et 9/10 patients
étaient décédés dont 7 d’une reprise évolutive de leur
maladie. Tous ces longs survivants avaient une tumeur
localisée (stades Ia à IIb) opérée à visée curative (résec-
tion R0). Finalement,un seul patient était encore vivant,
et sans récidive tumorale,avec un recul de 13.4 ans.
CancéroDigest 0.6 - mai 2005 - Supplément àla Lettre du CREGG 5
Référence
CARPELAN-HOLMSTROM M.et al. Gut 2005;54:385-
387
Ces données – particulièrement décourageantes –
confirment le pronostic catastrophique des adéno-
carcinomes pancréatiques avec une récidivequasi
inéluctable,parfois après 5ans,des rares tumeurs
opérées à visée curative.
Registre des Cancers de Finlande 1990-1996
4 922 cancers du pancréas
89 survivants à 5 ans (1.8 %)
seulement 10 adénocarcinomes canalaires
stades I ou II opérés à visée curative
9/10 décédés (7/9 de récidive)
survie médiane 5.4 ans
1 seul survivant (13.4 ans)
Dépistage
ÉTUDE RANDOMISÉE
DE DIFFÉRENTES
STRATÉGIES DE
DÉPISTAGE DU CANCER
COLORECTAL
R.LAMBERT(Lyon)
Une étude multicentrique
randomisée vient d’être
conduite en Italie sur des échantillons de population
pour des personnes dans la tranche d’âge 54-64ans
sans facteur de risque particulier pour le cancer colo-
rectal. Les personnes ayant des antécédents préalables
de lésions colorectales ou ayant eu un examen endosco-
pique ou un test de sang fécal,récents ont été éliminées.
La sélection aporté de novembre 1999 àjuin 2001.
L’étude conduite par le Centre de Prévention
Oncologique du Piémont àTurin associait des équipes
de Biella, Milan,Florence,Rimini. Les 26 682 personnes
sélectionnées étaient randomisées entre différentes stra-
tégies de dépistage et l’objectif de l’étude était double :
–comparer le taux de participation ;
–comparer les résultats pour ladétection de lésions
néoplasiques.
Les résultats publiés sont ceux de lapremièrecampagne
de dépistage. L’invitation pour le test du sang fécal était
uniquealors que l’invitation pour la sigmoïdoscopie a
été réitérée 3 fois pendant cette période de 2 années.
1) Le taux de participation selon la stratégie
de dépistage :
–l
a recherche de sang fécal (méthode immunologique)
tous les 2 ans (test envoyé par laposte) :taux de parti-
cipation de 30% pour 2266 personnes;
–la recherche de sang fécal
tous les 2 ans avec test remis
par le généraliste:taux de par-
ticipation de 28%pour 5893
personnes;
–le librechoix de lapersonne
entre 2 stratégies:recherche
du sang fécal ou sigmoïdoscopie flexible unique:taux
de participation de 27% pour 3579personnes;
–la sigmoïdoscopie flexible une seule fois:taux de par-
ticipation de 28%pour 36
50 personnes;
–la sigmoïdoscopie flexible suivie par le test du sang
fécal tous les 2 ans:taux de participation de 28%pour
10867 personnes.
Il n’y apas de différence significative pour laparticipa-
tion dans chacun de ces groupes.Ilfaut noter que,
parmi les 970 personnes qui ont accepté la stratégie de
librechoix entre test du sang fécal et sigmoïdoscopie
(soit 27 % du groupe contacté),522 ont choisi le test
fécal et 448 ont choisi la sigmoïdoscopie. Globalement,
le taux de participation de lapopulation est plus faible
que lors des campagnes de dépistage réalisées au
Danemark ou en Angleterre. La cible est doncmoins
bien couverte dans ce pays d’Europe du sud.
2)La détection des lésions néoplasiques:
–pour les personnes qui ont effectivement pratiqué le
test du sang fécal,le pourcentage de tests positifs était
de 4.3%. Uncancer colorectalaété dépistéchez
0.35%des sujets et un ou plusieurs adénomes «avan-
cés»chez 1.4 %;
–pour les personnes qui ont effectivement été exami-
nées en sigmoïdoscopie,uncancer colorectalaété retrouvé
chez 0.4 % des sujets,et un ou plusieurs adénomes
«avancés»chez 5.1 %.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%