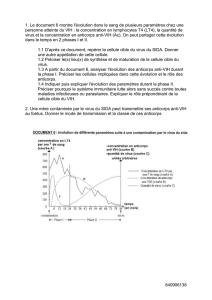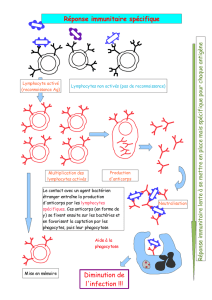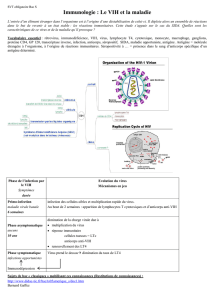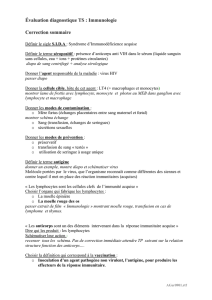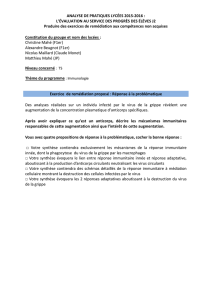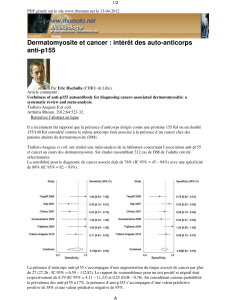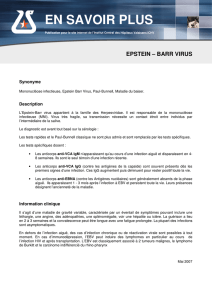16/11/2015 LEVERRIER Floriane DFGSM3 CR : Paul

Immunopathologie et immunointervention - Agents infectieux intracellulaires
16/11/2015
LEVERRIER Floriane DFGSM3
CR : Paul SEISSON
Immunopathologie et immunointervention
Professeur MEGE
14 pages
Agents infectieux intracellulaires
C'est la deuxième partie du cours sur l'immunité anti-infectieuse.
A. Généralités
Parmi les agents infectieux intracellulaires, on retrouve les virus, les bactéries, les protozoaires et les
champignons.
Les virus dont les profils varient suivant les types :
–Infection aigüe puis résolution : poliovirus, virus respiratoire syncitial
–Infection aigüe puis latence (et éventuellement réactivation) : herpes virus, Epstein Barr virus
–Infection aigüe puis persistance de l'état infectieux de façon chronique : HIV, virus hépatite
Parmi les bactéries, on retrouve les Mycobacterium tuberculosis, M. leprae, Listeria monocytogenes ou encore
Salmonella enterica.
Parmi les protozoaires, on retrouve Leishmania sp.,Plasmodium sp. Toxoplasma gondii. Leurs mécanismes
sont proches de ceux des bactéries intracellulaires.
Parmi les champignons, on retrouve entre autres Candida albicans, Aspergillus sp.
1/12
Plan
A. Généralités
B. Anticorps
I. Epstein Barr virus
II. Dengue
III. Hépatite B : Réussite de la réponse anticorps
IV.Hépatite C : Echec de la réponse anticorps
C. Cytokines
I. Interféron de type I et hépatite
II. Interféron de type II γ : Mécanismes de production
D. Cellules NK et cytotoxiques
I. Cellules Natural Killer
II. Cellules T CD8 : Cytotoxicité et infections virales
III. Cellules T CD4+ : Polarisation de la réponse humaine
E. Réponse immune anti-parasitaire : Protozoaires
F. Immunité anti-fongique

Immunopathologie et immunointervention - Agents infectieux intracellulaires
Nous avons différents moyens de lutte parmi lesquels les anticorps,cytokines,cellules NK et cytotoxiques,
cellules T et l'activation macrophagique. Ces mécanismes sont mis en place en fonction de l'agent infectieux.
B. Anticorps
Les anticorps sont très importants contre les parasites extracellulaires (via des mécanismes d'opsonisation). Ils
jouent également un rôle protecteur dans les infections virales par leur capacité à neutraliser : On parle
d'anticorps neutralisants.
L'objectif de la vaccination et de l'immunothérapie est de faire produire des anticorps neutralisants (ça ne
représente pas la majorité des anticorps attention). La plupart du temps, l'anticorps va interagir via le
mécanisme d'internalisation. Si le virus ne trouve pas de site favorable, il ne pourra pas agir.
Pour les infections par virus, l'efficacité est due aux anticorps neutralisants.
Pour les infections à bactéries intracellulaires, il y a une absence d'effet protecteur des anticorps même s'ils
sont produits en grand nombre. Ils sont même parfois facilitants !
Pour les parasites, il n'y a globalement pas d'effet protecteur. Néanmoins, dans le cas du paludisme, le
parasite va être à un moment extra-cellulaire lors de son transit jusqu'au foie. Les anticorps pourraient donc
avoir un rôle.
Les stratégies vaccinales contre le paludisme jouent justement sur cette capacité à induire des anticorps.
Pour les champignons, il y a également absence d'effet protecteur des anticorps.
I. Epstein Barr virus
L'EBV est un herpes virus qui infecte et transforme les lymphocytes B. Il est responsable de la mononucléose
infectieuse et du lymphome de Burkitt.
L'infection est très fréquente dans les pays en développement où l'infection subclinique a eu lieu chez 99% des
enfants à 3 ans. Par opposition, l'infection clinique dans les pays développés a lieu à l'adolescence, entre 15 et
25 ans.
La protection est assurée par anticorps neutralisants et CD8 cytotoxiques pour les cellules B infectées.
La présence des anticorps permet également la datation. Suivant si on est en présence d'IgG ou d'IgM, on peut
déterminer s'il s'agit d'une infection précoce ou non.
La réponse anticorps anti-EBV permet également de distinguer infection récente et ancienne :
IgM anti-VCA IgG anti-VCA Anti-EA Anti-EBNA Interprétation
+ + +/- - Infection primaire
- + - + Infection ancienne (> 4 mois)
VCA : viral capsid antigen : EA : early antigen
EBNA : EB uclear antigen (apparation 4ème mois)
2/12

Immunopathologie et immunointervention - Agents infectieux intracellulaires
II. Dengue
Cas clinique : Un homme de 47 ans rapporte une histoire de piqures de moustique aux Philippines avec rash et
fièvre transitoire.Lors d'un second séjour, il présente après piqûre de moustique : fièvre (6 jours), rash étendu,
TA 122/78 mmHg et température à 38,4°C. A l'examen, on note une congetion palpébrale, rash, érythème et
hémorragie pétéchiale.
Le bilan biologique montre : plaquettes 52x109 cells/L ; anomalies hépatiques ; IgM antivirus dengue
6,8 (N≤1,1) ; IgG 3,5 (N≤1,1), antigène NS1 dengue positif.
Traitement et prise en charge hémodynamique.
Les IgM antivirus de la dengue sont les premières à apparaître 3 à 5 jours après le début de la maladie avec un
pic à la 2ème semaines. Les IgG augmentent plus tard et persistent plusieurs mois voire plus.
La seconde exposition au virus de la dengue entraîne des syndromes plus sévères alors que le patient avait des
anticorps => Forme facilitante des anticorps (CR : un complexe immun Ac-virus se forme ce qui facilitera
l'internalisation par les phagocytes )
III. Hépatite B : Réussite de la réponse anticorps
C'est un Hepadnaviridae à ADN (8 génotypes) dont la demi-vie est de 2/3 jours. Il y a 350 millions de
personnes infectées mais 90% des cas récupéreront.
On retrouve un mode de transmission classique : mère-enfant,intraveineux et sexuel avec des complications
de cirrhose (2-5/100 personnes HbeAg positives) et de carcinome (incidence : 5% en Europe et 16% en Asie)
Dans cette atteinte, les anticorps servent au diagnostic. Un vaccin est disponible (même si en France, du à de
nombreux lobbys, la couverture vaccinale est faible), caractérisé par une réponse anticorps. Cette réponse
anticorps est très intéressante pour dater la maladie et son évolution.
Ce sont des virus qui mutent peu.
On est ici en présence d'anticorps neutralisants, donc qui ont un rôle protecteur. Les anticorps anti-HBc et
anti-HBs persistent après récupération.
On a ici une pathologie qui peut évoluer vers la chronicité.
IV.Hépatite C : Echec de la réponse anticorps
C'est un virus Flaviviridae à ARN (6 génotypes). 170 millions de personnes sont infectées et la transmission se
fait ici par voie intraveineuse. Le taux de mutation est très élevé.
60-80% des patients iront vers une évolution chronique et on observe des complications dans 5-10% des cas
après 10 ans.
La réponse anticorps est mauvaise, puisque l'apparition des anticorps est variable voire absente. Ces anticorps
spécifiques ont un profil isotypique restreint et le titre reste faible. Les anticorps n'ont pas un rôle protecteur.
Dans les infections virales, la réponse anticorps est extrêmement importante et on voit que suivant son
efficacité, cela influe sur les évolutions possibles des pathologies.
3/12

Immunopathologie et immunointervention - Agents infectieux intracellulaires
C. Cytokines
Les cytokines de type III seront confondues avec les I pour ce cours.
Les cytokines engagent des récepteurs différents qui induisent l'activation de très nombreux effecteurs, certains
communs, d'autres spécifiques :
–IFN I : molécules spécifiques à effets anti-infectieux
–IFN II : molécules associées à une réponse oxydative
Les interférons de type I et III sont les α,β et ε tandis que les interférons de type II sont les γ.
Les IFN-γ sont produits par les lymphocytes T, cellules NK et à faible dose par les cellules myéloïdes.
Les IFN I et III sont eux produits par l'ensemble des cellules et donc présents au niveau des interfaces.
I. Interféron de type I et hépatite
Les interférons de type jouent un rôle de protection contre les virus. Ils bloquent la synthèse protéique et la
machinerie d'intégration du génome virale dans la cellule hôte. C'est un mécanisme très puissant :
➢Hépatite B (protégée par les anticorps) :
Les IFN α/β inhibent la formation de nouvelles capsides du virus de l'hépatite B HBV, déstabilisent les capsides
existantes et dégradent l'ARN HBV.
=> Effet très puissant de l'IFN sur la vie des virus.
L'IFN de type I agirait par la voie du protéasome. (CR : Ce mécanisme favorise l'exposition au niveau du CMH
de type I et donc l'activation des LT cytotoxiques CD8 )
➢Hépatite C (non protégée par les anticorps) :
Le virus HVC n'est pas sensible à l'effet antiviral de IFN de type I : Elle possède une HCV serine protéase qui
bloque l'induction de l'interféron via IRF3 et inhibe les kinases en aval de l'interféron.
4/12

Immunopathologie et immunointervention - Agents infectieux intracellulaires
II. Interféron de type II γ : Mécanismes de production
L’interféron γ est produit par les cellules NK et par les lymphocytes T (souvent Th1). C'est la voie de
l'interleukine 12 et 18 qui favorisent la production de l’interféron par les cellules NK et LT. Cette voie de
L'IFN-γ est donc un reflet à la fois de la réponse innée (via NK) et de la réponse adaptative (CD4 et CD8).
Cet IFN agit sur cellules myéloïdes, en particulier les macrophages. Il augmente leur potentiel toxique en
amplifiant les mécanismes dépendant de l'oxygène mais également ceux non dépendants de l'oxygène. De plus,
il amplifie la fonction de présentation antigénique.
●Déficits
A partir du modèle murin : Les souris qui ne produisent par d’IFN γ ou qui n'en ont pas les récepteurs vont
mourir d'infections virales, bactériennes, parasitaires ou encore fongiques. Elles sont donc sensibles à
l'ensemble des agents infectieux.
A partir de pathologies humaines : Dans le même temps, il existe chez l'Homme un certain nombre de maladies
génétiques dues à des altérations de l'IFN-γ ou des voies conduisant à l'IFN-γ. Ces patients vont faire un tableau
infectieux donc le tableau est assez étroit, dominé par des mycobactéries provenant surtout de l'environnement.
Il existe donc chez l'Homme des mécanismes de compensation absents chez la souris.
Pour les déficits complets en récepteurs de l'IFN-γ, on retrouve chez ces patients une production d'IFN-γ
normale mais leurs cellules ne répondent pas. Ce sont des maladies sévères qui surviennent avant l'âge de 10
ans et mettant en jeu le pronostic vital. Les germes retrouvés sont soit associés à des affections opportunistes,
soit des mycobactéries de l'environnement. La manifestation principale est l'absence de granulome.
Ces enfants peuvent bénéficier de greffe de moelle et c'est le seul traitement.
Il existe également des déficits partiels (soit déficit de l'IFN, soit de la voie de signalisation). On retrouve le
même tableau mais atténué. L'affection est moins sévère et on observe des granulomes d'apparition tardive.
On peut également avoir des anomalies des voies conduisant à l’interféron : Anomalie de l'IL-12 ou des
récepteurs de l'IL-12. Ces sujets ont une réponse à l'IFN-γ normale puisqu'il y a des récepteurs, mais une
production l'IFN-γ diminuée puisque moins de signal.
On a donc bien des voies de compensation, puisque la réponse à l'IFN-γ reste normale.
5/12
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%