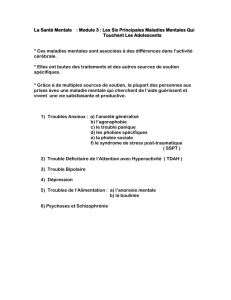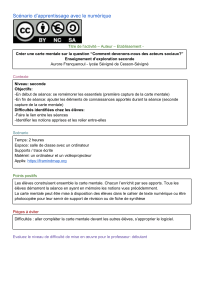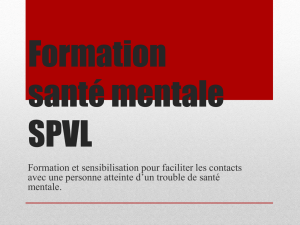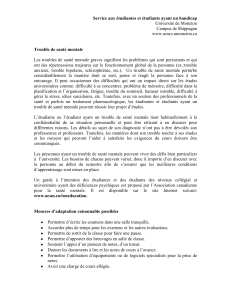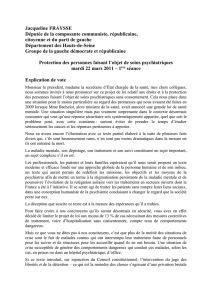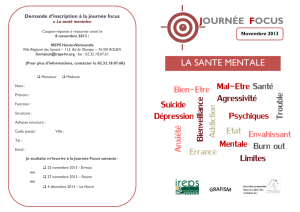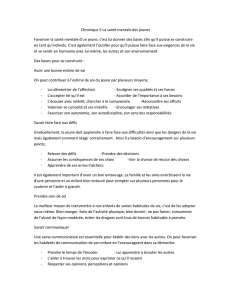atelier A - CSSS-IUGS

Atelier A – 6 octobre
Expériences et défis
en santé mentale
L’expérience du patient partenaire au suivi intensif
dans la communauté à Sherbrooke
Par Daniel Boleira Guimaraes, professeur, Département de psychiatrie,
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
et membre de l’axe « Le développement des capacités des adultes », Centre affilié universitaire (CAU),
CSSS-IUGS
Biographie
Daniel Boleira Guimaraes est professeur adjoint au Département de psychiatrie de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke et chercheur régulier au CAU du Centre de santé et de
services sociaux – Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (CSSS-IUGS). Il est médecin psychiatre
depuis 1997, spécialiste du Collège des médecins du Québec CMQ depuis 2009 avec une maîtrise en sciences
dans le domaine de la psychothérapie de groupe par l’Université de São Paulo (Brésil). Il collabore depuis
plusieurs années aux projets de recherche et développement cliniques tels que la clinique des jeunes
psychotiques, le suivi intensif dans le milieu, les cliniques de pharmaco surveillance de la clozapine et la
clinique culturelle. Ses intérêts de recherche portent entre autres sur la supervision clinique en psychothérapie,
l’intervention interculturelle, le soutien clinique apporté aux intervenants qui œuvrent en contexte de suivi
intensif au domicile pour la clientèle avec des troubles mentaux graves et persistants et troubles concomitants.
Résumé de la communication
L’équipe du suivi intensif dans la communauté (SI) est une équipe interdisciplinaire, qui assure au quotidien et
à la communauté : le traitement, le soutien et la réadaptation des personnes vivant avec un trouble de santé
mentale grave. Le but de ce service est de permettre aux personnes atteintes de troubles mentaux chroniques,
de pouvoir vivre chez eux, de façon automne et sécuritaire, en leur donnant la possibilité de vivre leur
processus de rétablissement de façon normalisatrice. Dans le cadre du SI, le processus de rétablissement passe
par l’implication du client à son propre plan d’intervention. L’objectif de vie du client est la pierre angulaire du
suivi et du plan d’intervention individualisé, en partant des situations de vie pour lesquelles l’individu a le désir
de modifier et respecter les situations pour lesquelles la personne désire maintenir le statuquo même si elles ne
nous apparaissent pas optimales du point de vue intervenant. L’expérience quotidienne au SI nous amène à
réfléchir sur nos attentes comme intervenants en santé mentale face à la clientèle. Le client et l’intervenant
n’ont pas les mêmes attentes face à cette problématique. Il y a un décalage entre le « désir du client » et le
« désir de l’intervenant». Travailler en partenariat avec le client c’est se montrer ouvert à être confronté à nos
propres valeurs, accepter de mettre en veilleuse nos solutions toutes parfaites, se mettre à « l’écoute de
l’autre », et accompagner l’autre à son rythme dans son processus de changement. C’est donner la parole au
client.

La collectivisation du savoir et de l’intervention
comme levier d’émancipation en santé mentale
Par Jean-François Pelletier, professeur-chercheur (boursier Institut de recherche en santé
du Canada (IRSC) et Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQ-S)), Département de
psychiatrie, Université de Montréal
Biographie
Jean-François Pelletier, PhD en science politique, est professeur-chercheur au Département de psychiatrie de
l'Université de Montréal et chercheur associé au Yale Program for Recovery & Community Health. La maladie
mentale a nettement influencé ce choix de carrière, de sorte que l'on pourrait dire qu'il est
"patient-professeur-chercheur". Il est en outre directeur du Programme international de recherche-action
participative, un programme de recherche financé par les Instituts de recherche en santé du Canada et le Fonds
de la recherche du Québec - Santé (chercheur-boursier). Il s'agit aussi d'un organisme à but non lucratif dont les
membres sont tous des patients partenaires de recherche et d'enseignement à l'Institut universitaire en santé
mentale de Montréal. La mission consiste à traduire le savoir expérientiel subjectif de la maladie mentale en
connaissance scientifique objective en santé mentale publique et à faire de la recherche institutionnelle un milieu
de travail inclusif des personnes les premières concernées, pour une inclusion citoyenne à part entière.
Résumé de la communication
La recherche-action participative peut être l’occasion pour les personnes usagères de services de santé mentale
de s’accomplir et d’améliorer leur condition, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes qui ont connu des
interruptions de parcours de vie significatives en raison des répercussions de la maladie mentale. Leur
participation comme partenaires et collègues de recherche et d’intervention à part entière peut faire une
différence importante pour les individus concernés, surtout lorsque cette participation est une occasion
d’acquérir et de pratiquer de nouvelles habiletés sociales et professionnelles. Cette étude de cas porte sur un
programme d’aide et d’accompagnement social destiné à traduire le savoir expérientiel subjectif et individuel en
savoir scientifique objectif et à faire du milieu de la recherche académique un milieu de travail favorisant
lui-même l’inclusion de ces personnes. En partenariat intersectoriel avec le ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale du Québec et l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, un groupe de personnes
usagères a mis au point une intervention favorisant le plein exercice de la citoyenneté et à rédiger rédigé le
manuel (inspiré et adapté d’une expérience américaine éprouvée). Le plein exercice de la citoyenneté est l’un des
quatre grands thèmes proposés par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec pour son Plan
d’action en santé mentale 2014-2020. Afin de favoriser le plein exercice de la citoyenneté, le leur et celui de leurs
pairs dans la collectivité, ces participants ont proposé et expérimenté des stratégies visant à influencer les
déterminants socio-économiques et psychosociaux de la santé mentale. Cette présentation expose les résultats
préliminaires de l’évaluation du programme en question, faisant particulièrement ressortir ses effets dans la vie
des personnes concernées.
L’expérience subjective des usagers de
services en santé mentale
Par Katharine Larose-Hébert, candidate au doctorat et professeur, École de service social,
Université d’Ottawa
Biographie
Katharine Larose-Hébert est candidate au doctorat en service social à l’Université d’Ottawa. Sa thèse porte sur
l’expérience subjective et le savoir émique des personnes utilisatrices de services de santé mentale au Québec.
Militante, elle est activement engagée dans la défense de droits en santé mentale, elle est d’ailleurs présidente du
conseil d’administration de l’organisme Droit-Accès de l’Outaouais et siège à titre d’administratrice au
regroupement provincial de l’Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du
Québec (l’AGIDD-SM).

Résumé de la communication
À travers le « regard » biomédical se trace le portrait du malade, à l’issue d’un diagnostic psychiatrique,
l’homme ordinaire deviendra un patient, « usager » des services de santé mentale. C’est donc au sein du
« regard » de l’autre que le vécu s’objective; les comportements et les paroles des patients sont dorénavant
abordés en tant que signes et symptômes d’une pathologie particulière. De ce fait, le discours du patient sur
son expérience, vidé de son contenu affectif, est interprété par l’ « expert » comme l’expression même de sa
maladie. Le savoir de l’usager sur lui-même – sensible et expérientiel - se trouve alors positionné à l’extérieur
du pouvoir et de la raison, exclu en grande partie du traitement auquel il doit se soumettre. L’organisation des
soins en santé mentale au Québec ne fait guère exception et n’offre qu’un espace restreint au discours de
l’usager. Cependant, le sens fondamental de l’expérience vécue ne peut être réduit aux symptômes; l’individu
entretient un rapport intime et nuancé à sa maladie, à son parcours d’infortune. Le vécu ne peut être traduit
par une série de données mesurables, il ne s’insère donc pas nécessairement dans les impératifs de
fonctionnalité désirés d’un système, d’une structure. Ainsi, trop souvent, le rôle de la subjectivité de l’usager
devient secondaire. Son savoir émique est tenu à l’écart de sa prise en charge, lui soustrayant de ce fait une
partie de son pouvoir, de ses droits fondamentaux. Cette communication présentera les résultats d’une
recherche doctorale portant sur l’expérience subjective des usagers de services en santé mentale alors qu’ils
les « utilisent ». Notre objectif est avant tout de valoriser et développer diverses formes de savoirs. Les
pratiques institutionnelles et systémiques seront interrogées à travers l’expérience de l’usager.
Que nous apprend l’exploration du processus d’adaptation
des personnes vivant avec la schizophrénie?
« Tout le monde est quelqu’un »
Par Marie-Claude Jacques, professeure, École des sciences infirmières, Faculté de médecine
et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke
et membre de l’axe « Le développement des capacités des adultes », CAU, CSSS-IUGS
Biographie
Marie-Claude Jacques est professeure à l’École des sciences infirmières de l’université de Sherbrooke et
chercheuse régulière au CAU du CSSS-IUGS. Elle a cumulé plusieurs années d'expérience comme infirmière
en soins communautaires en suivi des personnes sans-abri et atteintes d’un trouble mental grave. À présent,
elle enseigne les soins infirmiers en santé mentale et en psychiatrie au baccalauréat et à la maîtrise en sciences
infirmières. Ses intérêts de recherche portent sur l’adaptation des personnes souffrant de troubles mentaux
graves et vivants dans la précarité, ainsi que sur les meilleures pratiques visant cette clientèle.
Résumé de la communication
La schizophrénie est un trouble mental grave qui touche 1 % de la population. Bien que les traitements
pharmacologiques et psychothérapeutiques ne cessent d'évoluer, la chronicité est fréquente et de nombreuses
difficultés de santé mentale et psychosociales empêchent ces personnes d'avoir une vie satisfaisante. L'isolement
social, à la fois symptôme et conséquence de la schizophrénie, vient compliquer la situation en contribuant à
l'aggravation de la maladie, notamment en raison des rechutes non reconnues. Comment s'adapter à vivre avec la
schizophrénie dans ces conditions ? Bien que les composantes de l'adaptation au stress chez ces personnes aient été
abondamment étudiées, l'adaptation à cette situation de vie dans son ensemble, en particulier dans ce contexte,
reste mal connue. Cette communication présente une recherche qualitative utilisant la théorisation ancrée qui a
pour but de décrire le processus d'adaptation de personnes atteintes de schizophrénie et dont le soutien social est
insuffisant. La théorisation ancrée selon l'approche constructiviste de Charmaz (2006, 2014) est une méthode qui
favorise une meilleure compréhension des structures sociales, relations et situations qui influencent les
comportements, les interactions et les interprétations des individus. Ainsi, le savoir expérientiel est recherché,
reconnu et valorisé, car cette méthode porte une attention particulière à la co-construction du savoir entre le
chercheur et les participants. Un recrutement à stratégies multiples a aussi permis de rejoindre des personnes
souvent négligées par la recherche, car difficiles à rejoindre et catégorisées comme vulnérables. Les résultats visent
à mieux comprendre l'adaptation de ces personnes, à partir de leur point de vue, à l’aide d’une perspective nouvelle
du contexte et des conditions dans lesquels ce phénomène survient. Cette recherche se veut une première étape
vers l'élaboration d'un programme de recherche visant l'amélioration des soins et services actuellement offerts à
cette population, qui restent pour le moment nettement plus prescriptifs, voire coercitifs, que réellement
personnalisés.

NOTES
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
1
/
4
100%