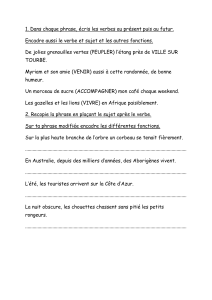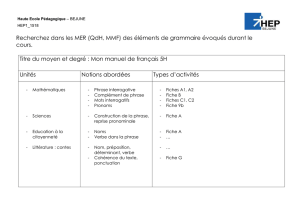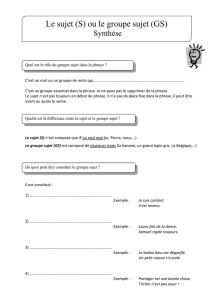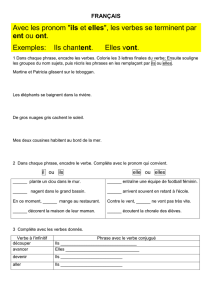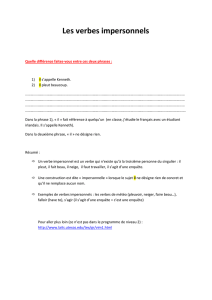Sujet

Sujet
Matière
Définition
Emplois
Contexte syntaxique
Programmes
Pratiques scolaires
Français
La notion de sujet est avant tout en
Français une notion grammaticale,
certainement la plus célèbre. Elle reste
cependant difficile à définir.
Le sujet est une fonction syntaxique
essentielle da la phrase. La grammaire
traditionnelle définit le sujet d’un point
de vue sémantique : » Le sujet désigne
l’être ou la chose qui fait ou qui subit
l’action ou qui est dans l’état exprimé par
le verbe ».A cette définition trop
restrictive, les grammaires modernes
répondent par une analyse placée au
niveau syntaxique. Le sujet se caractérise
alors par une série de propriétés
formelles :
-c’est un constituant essentiel de la
phrase.
-Il gouverne l’accord du verbe en nombre
, en personne et parfois en genre
(participe passé employé avec être)
-Il peut-être encadré par la locution
« c’est…qui » dans la phrase.
-Quand à une phrase à la voix active
correspond une phrase à la voix passive,
le sujet de la première devient le
complément d’agent de la seconde.
Différentes classes grammaticales
peuvent occuper la fonction sujet ( nom,
G.N., infinitif, pronom, certaines
propositions relatives et complétives).
Le sujet désigne aussi en Français
l’énoncé d’une rédaction ou d’une
La notion de sujet est fréquemment
utilisée en Français soit comme objet
d’étude dans l’analyse de la phrase, soit
en orthographe pour régler les accords du
verbe et de l’attribut du sujet.
On peut s’appuyer sur l’identification du
sujet pour éclairer le sens d’une phrase ou
relever un effet stylistique dans l’étude
des textes (inversion, ellipse, …).
« Quel est le sujet de tel verbe ? »
« Accordez les verbes à leur sujet
respectif. »
« Analysons le sujet de la rédaction. »
La notion de sujet est une des premières
notions de grammaire enseignée à l’école
primaire, à travers notamment l’étude
des pronoms personnels qui
accompagnent la conjugaison.
Cette notion, abordée à l’école primaire,
est revue et approfondie en classe de
sixième
.Outre son identification et la
connaissance des règles d’accord qu’il
régit, les élèves doivent étudier l’ellipse
et de l’inversion du sujet, comme
phénomène syntaxique dans l’étude des
types de phrases ou de la phrase
complexe, ou comme effet stylistique
dans l’étude des textes du collège au
lycée.

Mathématiques
Histoire
S.V.T
S.T.I.
dissertation.
« Sujet » peut-être aussi synonyme de
thème, « le sujet d’un texte », ce dont on
parle.
Enfin, on le rencontre dans certains textes
dans le sens de « soumis à quelqu’un ou
quelque chose, le sujet d’un roi… ».
Pas de définition particulière.
Soumis dépendant : on est le sujet du
seigneur, du roi.
Terme non utilisé en SVT
Pas de définition particulière
Pas d’emploi dans un contexte
proprement mathématique
Sujet de devoir d’interrogation écrite
Sujet principal
Sujet britannique, néerlandais. Sujets d'un
souverain, d'un roi,
Sujet d'intérêt national.
Sujet de morale, de méditation, de pensée,
de discussion.
Sujet de roman, de livre.
Sujet d'une dissertation.
Pas de mention particulière dans les
programmes de mathématiques du
secondaire.
Philosophie
Le mot a en philosophie un caractère
central, et des usages très divers,
indiquant aussi bien la responsabilité
(être un sujet de droit) que la soumission
(le sujet d’un roi, mais aussi être sujet à
des maux de tête).
Les philosophies du sujet.
Le sujet de droit.
Le sujet pensant.
Notion centrale des programmes des
séries générales. Située dans la colonne
de gauche du tableau des notions, elle est
liée en priorité aux notions de conscience,
d’inconscient, d’autrui, de désir... mais
aussi à pratiquement toutes les autres

1° il désigne en logique, dans une
proposition affirmative, l’être auquel est
attribué un prédicat (S est p) et, d’un
point de vue métaphysique, le substrat ou
la substance par rapport à ses attributs.
il désigne celui que l’on considère
comme l’auteur ou le responsable d’une
pensée, d’un discours ou d’une action :
celui qui dit je se présente à la fois
comme le sujet (grammatical ou logique)
de l’énoncé et le sujet (la source) de
l’énonciation. Mais le sujet logico-
grammatical ne recouvre pas
nécessairement un sujet « auteur ».
Le sujet est donc l’un des pôles de la
relation, voire de l’opposition sujet-objet,
et de ses dérivés : subjectivité/objectivité,
etc.
2° il peut aussi bien désigner ce dont on
parle ou traite, et constitue en ce sens un
presque synonyme d’objet, ce qui est sou-
mis, subjectum, à la réflexion, par
exemple, étant du même coup ob-jet,
placé devant le regard. Même chose
lorsque l’on parle de « sujet de
satisfaction ».
3° ces ambiguïtés se retrouvent dans
l’usage massif du terme dans le champ
sociologique, éthique et politique : le
sujet est l’individu soumis à l’autorité du
pouvoir politique (pas seulement
monarchique). Mais le sujet d’un droit
possède ce droit ; le sujet de droit est la
personne en tant qu’elle est susceptible
d’avoir des droits et des obligations ; le
sujet du droit est la personne, distincte de
notions du programme, en particulier la
raison et le réel, théorie et expérience, la
société et l’État, la morale, le bonheur...

la chose ;
1
/
4
100%