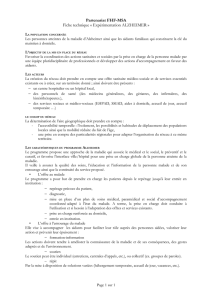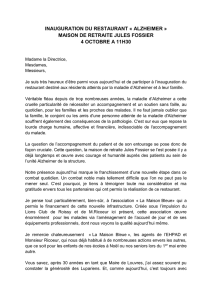alzheimer

Alzheimer
Numéro revue mensuelle et thématique, pratique et mise à jour régulièrement centrée sur le médicament.
Médicament
LA REVUE DU
Médicament
LA REVUE DU
Janvier
2013
18
21
23
INFOS PRATIQUES
Professionnel
Avis de spéciAlisteAvis de spéciAliste
avis de MG
sondaGe Médecins
pharMaciens
03
17
analyse
econoMique
19
22
Dr Rabéa COTTERET
Dr Guy Recorbet
Dr Gérard Ponson
DES mOyENS SUPPlémENTAIRES
POUR AIDER PATIENTS ET AIDANTS
NOUVEAU :
PARTIcIPEz AU TEST DE lEcTURE

Médicament
LA REVUE DU
Médicament
LA REVUE DU
2
Le nom de cette maladie est maintenant connu
du grand public car il atteint plus de 800 000
personnes en France.
EDITORIAL
Dr Alain Sebaoun
Ce numéro veut poser les nombreux problèmes de
cette affection redoutable
- Problème de la faible efficacité des thérapeutiques
médicamenteuses et de la nécessité d’une
recherche productive en ce domaine
- Problème de l’épuisement des aidants
- Problèmes économiques majeurs
- Problèmes de communication pour faire
connaître aux médecins les nombreuses
initiatives associatives apportant des moyens
complémentaires à la lutte contre la maladie
- Problèmes de stimulation cognitive à favoriser
Vous trouverez dans cette revue un éventail des
traitements et moyens qui sont à la disposition des
malades et surtout des aidants. Il est légitime de se
demander qui souffre le plus, le malade de moins en
moins conscient de sa maladie au fur et à mesure
de son évolution et dont personne ne sait évaluer la
souffrance, ou l’aidant.
Ce dernier a lui même besoin d’un soutien continu
pendant toute la durée de la maladie et ce soutien est
une contribution indispensable. Tous reconnaissent
les trésors de dévouement de ces aidants, mais
soyons- en conscients, aussi parce que cela diminue
le fardeau économique considérable, qui serait
totalement insupportable sans ces conjoints ou
enfants des malades.
Les nations qui n’auront pas prévu cet effort dans
les années qui viennent, iront au devant de graves
désordres sociaux car la solidarité ne pourra bientôt
plus faire face à ce défi.
L’augmentation exponentielle de cas de MA en raison
du vieillissement de la population , qui touche toutes
les couches sociales de notre société, exigera de nos
politiques une prise de conscience et des
décisions en rapport avec l’importance de l’impact
socio-économique.
Nous sommes confrontés à un énorme défi : solidarité,
réflexions éthiques et économiques confondues.
Espérons que des mesures immédiates seront prises
par nos responsables politiques pour s’attaquer
à la priorité d’un futur immédiat qui se moque de
l’idéologie de gauche ou de droite.
Bonne lecture
La rédaction
Cher lecteur,
Directeur de la publication :
Alain Sebaoun
Comité des médecins
généralistes
Gérard Lyon
José Clavéro
Gérard Ponson
Guy Thuilier
Guy Recorbet
Rédacteur en chef :
Guy Thuilier
Comité des spécialistes
Alain Sebaoun
Jacques Tricoire
Experts indépendants
Jérome Roncalli
Jacques Pouymayou
Dr Rabéa Cotteret
N’hésitez pas à aller sur notre site www.revue-medicament.com
pour y charger l’application android ou pour y trouver comment
s’équiper en tablettes android médicales (incluant le vidal 2012
et bien d’autres applications médicales) et surtout pour
vous abonner car sans ce soutien cette revue indépendante ne
pourra exister.

Médicament
LA REVUE DU
Médicament
LA REVUE DU
3
Maladie
d’Alzheimer
ALZHEIMER
Décrite pour la première fois en 1906 par Aloïs Alzheimer, la maladie d’Alzheimer est
une pathologie dont le diagnostic reste très complexe et difficile à établir. A ce jour, il
n’existe aucun traitement curatif, mais des médicaments agissant sur les systèmes
de neurotransmetteurs sont à la base de traitements substitutifs mais ne peuvent
pallier tous les déficits de systèmes observés au cours de la maladie notamment
sérotoninergiques, noradrénergiques, histaminergiques et neuropeptidiques.(1)
Dr Rabéa CotteRet
Gériatre hospitalière APHP
> Alzheimer actualités. Fondation IPSEN . novembre décembre 2006 N°189

Médicament
LA REVUE DU
Médicament
LA REVUE DU
4
ALZHEIMER
Ce tableau montre qu’il a fallu près d’un siècle
entre la découverte de la maladie et le premier
traitement.
Maladie neurodégénérative, progressive et irréversible,
elle associe des pertes de mémoire et une perte
des fonctions cognitives aboutissant au syndrome
aphaso-apraxo- agnosique sur le plan clinique et des
lésions cérébrales sur le plan anatomique. On retrouve
des signes associés à type de dépression, insomnie,
délire, hallucinations, incontinence et amaigrissement.
A un stade avancé, on retrouve des crises comitiales,
une hypertonie et des myoclonies. Elle s’accompagne
par ailleurs de troubles du comportement à type
d’agitation, agressivité, hallucinations et délire ainsi
que de troubles du comportement moteurs aberrants
, apathie et dépression méconnus et sous traités.
La première description a été faite par le neurologue
Aloïs Alzheimer en 1906 sur le cas d’Augusta D…
âgée de 51 ans et suivie pour une démence dans
un asile depuis 1901. Elle souffrait de jalousie
excessive puis il a été noté un déclin cognitif avec
aphasie, troubles psychocomportementaux (à type de
délire de préjudice avec des hallucinations auditives),
agraphie, troubles de la mémoire et désorientation et
elle décèdera de complications de l’immobilisation.
A l’autopsie, dégénérescence neurofibrillaire et
plaques séniles ont été décrites.
Epidémiologie
Représentant à elle seule environ 70% des démences,
la maladie d’Alzheimer est étroitement liée à l’âge et
à la durée moyenne de vie. On parle plus de maladie
d’Alzheimer que de démence, terme utilisé par les
professionnels. Seule la moitié des patients souffrant
de cette maladie est aujourd’hui diagnostiquée.
L’insuffisance de diagnostic est liée au patient lui-
même ou à son entourage et au médecin.
Le nombre de cas est évalué entre 750 000 et
800 000. La maladie d’Alzheimer et maladies
apparentées (MAMA) constituent un enjeu de santé
publique puisqu’elles concernent plus de 1,2% de
la population totale. Les MAMA touchent plus les
femmes que les hommes et ce chiffre devrait être
multiplié par 2,4 d’ici à 2050.
Sur le nombre de patients atteints par la maladie
d’Alzheimer, 450 000 sont suivis médicalement et
300 000 justifient d’une prise en charge en maladie
de longue durée (Réunion sur le plan Alzheimer 2008-
2012 au palais de l’Elysée sept 2010)
Le délai entre le début de la maladie et le diagnostic
est de 20 mois en moyenne en Europe contre 24 mois
en France.
Certaines formes surviennent avant l’âge de 60 ans ;
il s’agit de formes rares, qui peuvent être héréditaires
et pour lesquelles certains gènes ont été identifiés.
En France, en 2004, on dénombrait 32 000 cas de
patients de moins de 60 ans et 1 000 de moins de
50 ans.
En plus des facteurs génétiques, les facteurs envi-
ronnementaux jouent un rôle. Parmi les facteurs de
risque, on retiendra le niveau socioculturel (faible
niveau de revenu, faible niveau d’instruction, et une
stimulation intellectuelle moindre) l’exposition aux
solvants organiques à l’aluminium et aux microtrau-
matismes crâniens répétés.
Le coût médical de la maladie représente environ
10% du coût total contre 90% du coût médico-social
et celui-ci est 4 fois plus important en institution.
Le médecin généraliste est au cœur du diagnostic de
la maladie. Entourages et médecins doivent prêter
attention et vigilance à la plainte subjective du patient
et surtout celle de l’entourage permettant un diagnos-
tic précoce et une orientation rapide vers un centre
diagnostic. Il assure le suivi du traitement à domicile
et la coordination des intervenants ainsi que le sou-
tien des aidants. La prise en charge est globale avec
notamment les troubles du comportement gênants
pour l’entourage ainsi que les troubles nutritionnels.
La survie est de 8 à 10 ans après le diagnostic de la
maladie d’Alzheimer qui représente la 4ème cause de
mortalité en France.

Médicament
LA REVUE DU
Médicament
LA REVUE DU
5
Les systèmes NeurotraNsmetteurs
ALZHEIMER
Mécanismes physiopathologiques
Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer a toujours
reposé sur des signes cliniques, définis par un déclin
survenant sur deux domaines cognitifs ou plus et par
les perturbations portant sur les activités de la vie
quotidienne. (2)
La nature neurodégénérative de la maladie d’Alzheimer
se traduit par des lésions histopathologiques bien
précises qui sont :
• les plaques séniles
• la dégénérescence neurofibrillaire
• l’atrophie corticale.
Plaques séniles
La protéine amyloïde ou peptide Aβ est le constituant
majeur des plaques séniles ; dépôts neurotoxiques,
ils ont un effet direct par lésion de la membrane et un
effet indirect par l’augmentation des radicaux libres.
Cette protéine est le produit du clivage de l’APP,
précurseur de la protéine amyloïde et si la protéine
Aβ est le produit normal du catabolisme de l’APP,
dans la maladie d’Alzheimer, il y a une accumulation
de ce peptide qui entraîne un dysfonctionnement
synaptique et la mort cellulaire (par une entrée
massive du calcium, une augmentation de la toxicité
du Glutamate et une augmentation des radicaux
libres). La concentration du peptide Aβ 1-42 est
diminuée dans le LCR des patients malades car il est
capté par les plaques séniles alors que le peptide Aβ
1-40 n’est pas modifié au début de la maladie et son
agrégation est plus tardive.
Source 2007 : Alzheimer’s Association
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%