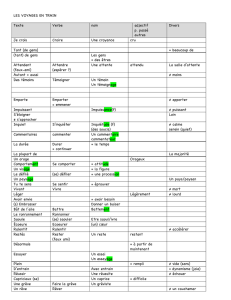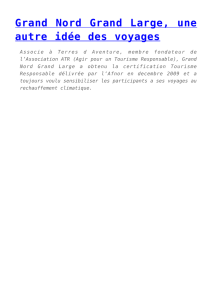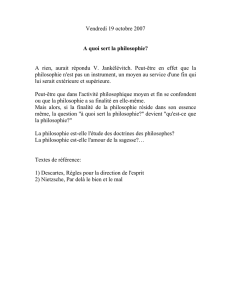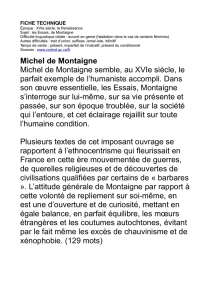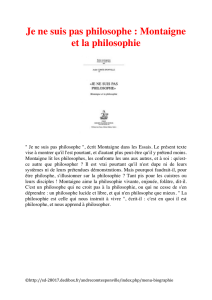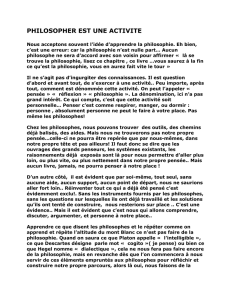Philosophie du voyage

1
PHILOSOPHIE DU
VOYAGE
Eugène Delacroix – « les femmes d’Alger » 1834
JEAN-LOUIS CHEVREAU – Conférences de l’Institut municipal - 2009

2
PHILOSOPHIE DU VOYAGE
« Je pérégrine très saoul » - Montaigne : Essais (« De la vanité »)
Band-e Amir Afghanistan 07/66
A Louise et Romane
pour tous les voyages
que nous ferons ensemble.

3
Mercredi 18 novembre : Première partie
Tristes Tropiques (photos Claude Lévi-Strauss)
Introduction : J’en commencerai, comme souvent, par l’exposé des raisons qui m’ont fait
choisir ce thème : Philosophie du voyage.
Selon moi, la philosophie et les problèmes qu’elle soulève, s’origine dans un vécu,
dans des expériences que la vie nous propose. Ce n’est pas la philosophie qui alimente la
vie, c’est la vie qui alimente la philosophie. C’est donc à partir de ce désir de voyager,
depuis mon adolescence, que je vais rechercher les éléments nourriciers ou fécondants de
l’autre aventure de ma vie : la philosophie.
Très jeune, comme beaucoup d’enfants de mon âge, j’étais attiré par les cartes de
géographie, les photos et les gravures de nos livres scolaires représentant des peuples, des
coutumes ou les paysages des « pays lointains », comme l’on disait alors. J’aimais aussi
les récits d’aventures des explorateurs, des marins et des aventuriers, et par tempérament,
j’ai toujours voulu voir ce qui se passait derrière la colline. J’ai goûté avec bonheur les
quelques voyages en Europe avec mes parents, puis dés l’âge de dix-sept ans, j’ai
commencé à voyager seul ou avec un camarade, dans des conditions rudimentaires,
voyages difficilement réalisables aujourd’hui, puisqu’ils se faisaient en auto-stop.
Attiré par l’Orient, mon premier voyage fut pour la porte de l’Orient, Istanbul. Cet
entremêlement d’Orient et d’Occident m’avait fasciné. La rencontre de ces deux cultures

4
m’obligeait à me demander si l’on avait affaire à une déculturation, cas où les Turques
seraient fascinés par l’occident qu’ils veulent imiter, ou à une acculturation, produisant
une forme originale et féconde, à partir des deux cultures. Il me semble que l’opposition,
acculturation / déculturation est en toujours d’actualité, pour bon nombre de sociétés extra
occidentales. La visite de la maison de Pierre Loti, sur les rives du Bosphore, m’avait mis
sur la route des écrivains voyageurs. Je dois avouer qu’à 17 ans, je n’avais pas assez de
jugement critique pour voir le côté quelque peu suranné de cet orientalisme, que
représente la littérature de Pierre Loti, et une bonne partie de celle des grands écrivains du
19ième siècle.
Le voyage en auto-stop avait deux grands avantages : il ne nécessitait pas un gros
budget, et me faisait vivre des rencontres exceptionnelles, avec les personnes des pays
traversés qui me transportaient, et parfois m’hébergeaient. Le second voyage, en 1966,
réalisé lui aussi, en stop, et dans le temps de mes grandes vacances scolaires, me conduisit
jusqu’en Afghanistan. A Kaboul j’ai croisé la route de Kessel, qui habitait dans le même
hôtel. J’ai été très impressionné en l’entendant toute la nuit taper à la machine à écrire. Il
devait écrire à cette époque « les Cavaliers », et peut être inspiré par le spectacle que j’ai
vu, beau et intense, le sport national afghan : le « bouzkachi ». C’était alors un pays en
paix, et c’est avec une certaine amertume que je regarde une photo de moi posant devant
le grand Bouddha de la vallée de Bamian. Les talibans n’étaient pas encore passés par là.
Un ami me disait que la différence entre la marche et le voyage réside dans les étapes
pour l’un, et entre les étapes pour l’autre. Ce qui n’est vrai qu’en partie. C’est le cas si
l’on prend par exemple l’avion d’un point à un autre, mais sur la route du voyage en stop,
en voiture ou en autobus, le voyage c’est déjà la route. La route était longue parfois, et la
traversée des grands plateaux comme celui d’Anatolie, des montagnes du Kurdistan, ou
celle des déserts d’Iran et d’Afghanistan, était une épreuve physique et psychologique
déterminante. Nicolas Bouvier, dont j’ai connu l’œuvre bien plus tard, et qui a fait ce
voyage dans les années cinquante, parle fort justement, dans ce très beau livre et
merveilleusement intitulé : « L’usage du monde », d’une initiation, et même d’une
métamorphose. En effet, le voyage réalise un passage, qui a signifié pour moi, non
seulement le passage de l’enfance à l’âge adulte, mais aussi un passage plus important, le
goût de la découverte et de l’étonnement devant la variété des hommes, des cultures, et
des paysages. Etonnement qui traduisait aussi la découverte de ma propre étrangeté, celle
que me faisait sentir le regard des autres, et qui me fait dire qu’à l’étranger, on devient
étranger à soi même, en quelque sorte. J’avais enfin une perspective nouvelle sur moi-
même et sur ma position de français, d’occidental. J’avais commencé à me sortir de cette
emprise, de l’éducation, et de mes idées reçues. En fait le voyage ce n’est pas dés l’abord
la possession de l’autre et de ce qui nous semble exotique, au contraire, le voyage est une
invitation au dépouillement de soi. Nicolas Bouvier a cette tranchante expression : « On
voyage pour que la route vous plume, vous rince, vous essore ». C’est en cela que le
voyage est subversif, avec soi-même j’entends, et c’est aussi cela qui distingue le
voyageur et le touriste, car le touriste est souvent plus conformiste. Lors de mes premiers
voyages dans les années 60, je croisais parfois quelques hordes de touristes, bien que le
tourisme de masse n’existât pas encore. Dans l’état d’esprit qui était le mien à cette
époque, il va de soi que je ne fréquentais pas « ces gens-là ».

5
L’année de mon bac, mes parents m’offrirent un billet « charter », pour Paramaribo
en Guyane hollandaise, appelé le Surinam. Muni de ce billet et de quelque argent gagné à
la cueillette des pommes, j’ai choisi de me rendre en Amazonie. Pourquoi l’Amazonie ?
Je me destinais à l’étude de la philosophie, qui elle aussi, autant que les voyages, fût un
véritable dépaysement, une nouvelle exploration, une seconde leçon spirituelle, puisque
cet enseignement, dés ma première initiation, consista pour ma pensée, à s’exiler de tout
appui antérieur, rassurant et passif. Cependant ma lecture débutante d’ouvrages
d’ethnologie m’avait fascinée. Le « Tristes Tropiques » de Lévi-Strauss, m’avait ébloui,
et je considère toujours ce livre comme l’un des plus beaux du vingtième siècle. Il est vrai
que dans cet ouvrage, il écrit : « Je hais les voyages ». Quel paradoxe cependant, puisque
son œuvre a déclanchée de nombreuses vocations, de voyageurs, ou d’ethnologues. La
lecture de son œuvre m’apportait non seulement la découverte de peuples échappés de
l’histoire, peuple sans histoire, ou d’une histoire froide, comme le dit Lévi Strauss, mais
aussi une méthode d’observation, particulièrement par son travail, sur les mythes, ou sur
les structures de la parenté, qui devenait éclairant pour nous faire comprendre la vitalité
culturelle de ces peuples, contrairement à l’opinion commune, à laquelle la conquête
coloniale nous avait accoutumée. Peut-être faut-il ajouter, pour comprendre cette
fascination pour ces indiens d’Amazonie, l’attirance quelque peu libertaire, pour ces
peuples sans Etat.
Les travaux de Robert Jaulin et de Pierre Clastres déclanchèrent aussi dans mon
esprit de jeune homme, un sentiment de révolte contre tout ce que la civilisation
occidentale faisait vivre à ces pauvres indiens. Bref, je voulais voir les indiens ! Les
quelques temps passés avec les indiens « Pacas Novas », du territoire brésilien du
Rondonia, ne m’ont certes pas appris grand chose sur leur culture, mais au moins ceci :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
1
/
79
100%