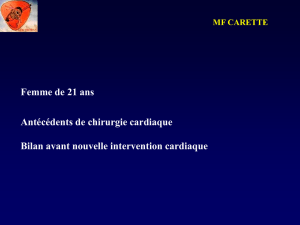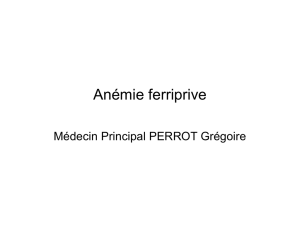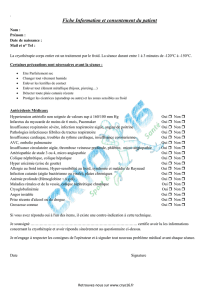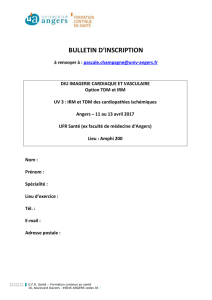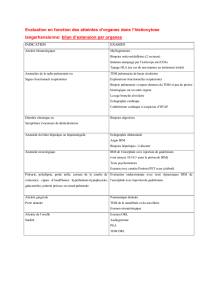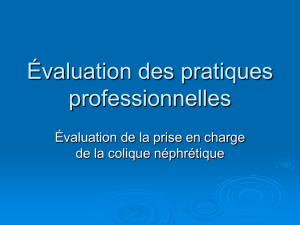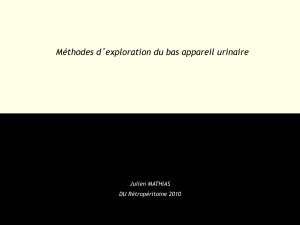L`UIV, un examen du passé sans avenir?

MISE AU POINT Progrès en Urologie (2001), 11, 552-561
552
L’UIV, un examen du passé sans avenir?
Jean-Pierre LAISSY, Eric ABECIDAN, Pascale KARILA-COHEN, Vincent RAVERY,
Elisabeth SCHOUMAN-CLAEYS
Services de Radiologie et d’Urologie, Hôpital Bichat, Paris, France
Face à l’offensive des nouvelles imageries (scanner,
uroscanner, uroIRM), l’UIV a du souci à se faire.
Après 30 ans de bons et loyaux services, son utilité est
largement remise en cause. Dès 1985, les premiers
bruits avant-coureurs d'un avenir menacé pour l'UIV se
faisaient entendre [1]. Ce n'est malgré tout que quinze
ans plus tard que l'UIV vit ses dernières heures en
temps que telle. Assaillie de tout côté par des tech-
niques concurrentes et plus performantes, c'est le scan-
ner spiralé sans injection dans la colique néphrétique
qui lui a porté l'estocade finale.
Manuscrit reçu : novembre 2000, accepté : janvier 2001.
Adresse pour correspondance : Pr.J.P.Laissy, Service de Radiologie, Hôpital
Bichat, 46, rue Henri Huchard, 75018 Paris.
e-mail : [email protected]
RESUME
L’UIV s’est vue ces dernières années voler sa place de "gold standard" dans l’explo-
ration successivement du parenchyme rénal puis même de la voie excrétrice.
Deux gagnants : l’échographie et le scanner.
Dans la colique néphrétique, quelques réticents prônent encore la place de l’UIV, aux
motifs suivants : le surcoût du scanner (cela n’est pas vrai par rapport à un scanner
sans injection) et l’absence de données fonctionnelles (le scanner a sa propre sémio-
logie de l’hyperpression). Les avantages ne se discutent pas : résolution en contraste
permettant de déceler la quasi totalité des calculs à l’exception de certaines compli-
cations des trithérapies chez les patients séropositifs, couverture étendue facilitant
l’identification des diagnostics différentiels, rapidité et meilleure efficacité, enfin
absence de risque lié à l’injection iodée dans cette indication.
Pourtant il est des cas où les performances sont plus limitées : patient maigre, ou sou-
hait d’explorer la sphère gynécologique mais l’UIV n’est là pas plus contributive.
Alors quelle place réserver à l’UIV dans la colique néphrétique? le besoin d’un dia-
gnostic de certitude et la discussion d’un geste urgent (levée d’obstacle dans un cadre
infectieux) alors que le scanner est soit inaccessible (maintenance… ), soit vraiment
trop irradiant, comme chez la femme enceinte, quand l’échographie, voire l’IRM et
l’uroIRM, n’ont pas été suffisamment contributives.
L’indication essentielle reste en fait le besoin d’une fine visualisation de la voie excré-
trice (bilan d’hématurie, recherche d’une tumeur uroépithéliale), le besoin d’un mor-
phogramme fin de l’ensemble de l’arbre urinaire (appréciation de certaines patholo-
gies malformatives), voire la recherche d’une grossière appréciation de la fonction
rénale chez un polytraumatisé qui n’aurait pas été exploré en scanner et chez qui on
hésiterait – à juste titre - à ouvrir le rétropéritoine.
Il reste a prédire que, faute de faire des UIV, on ne fera plus le diagnostic de nécrose
papillaire ou de petite diverticule caliciel, mais finalement qu’importe?
L’UIV n’est donc, dans les pays qui disposent d’un équipement adapté, plus qu’une
affaire d’expert. L’UIV est un examen du passé, sans avenir certes, mais avec une
descendance : l’uroscanner.
Mots clés : scanographie, UIV, rein, colique néphrétique, rein, tumeurs, vessie, tumeurs.

553
Des chiffres qui en disent long
Aux USA, il était recensé 10 millions d’UIV en 1975,
et seulement 600 000 UIV en 1995, soit une réduction
de -94% [9]! Pour expliquer ce recul considérable, il
est intéressant de répertorier les indications cliniques
pour lesquelles une éventuelle substitution a pu avoir
lieu. A leur tête on retrouve la colique néphrétique,
l’hématurie et la dysurie ; nous allons essayer de com-
prendre, par un tour d’horizon des indications les plus
fréquentes, les raisons de l’abandon de l’UIV.
Un peu d'histoire[2]
La notion d'opacification des cavités urinaires voit le
jour dans les années 1920. Il s’agit d’opacifications
directes (Collargol et air en injection rétrograde).
L’opacification urinaire par voie veineuse n’est pas
encore prête (1929-30, première molécule iodée intra-
veineuse), elle est en effet indissociable de la pharma-
cologie des produits de contraste utilisés, qui à l'époque
bien plus qu’à l'heure actuelle, sont des médicaments
potentiellement dangereux, autrement dit dont les
effets indésirables sont plus importants que les béné-
fices escomptés.
Les laboratoires vont élaborer des produits de contras-
te de plus en plus performants et de moins en moins
toxiques, mais il faudra attendre encore une quarantai-
ne d'années avant que l'urographie intraveineuse ne
gagne ses lettres de noblesse. Les molécules tri-iodées
apparaissent en effet dans les années 1950-60, c’est le
début de l’uroradiologie.
En 1960, l'UIV devient l'examen-clé de la radiologie.
15 à 30 examens sont effectués par jour (mais une
semaine de délai avant le compte-rendu!). Certes, cet
examen explore les reins et les voies urinaires, mais
il fait également partie d'un complexe radiologique
systématique dans les pathologies abdominales (dou-
leurs, masses) comprenant successivement l'UIV, la
cholécystographie orale, le TOGD, le lavement bary-
t é .
Dans les années 1960 aussi, l’UIV se perfectionne et se
sophistique, notamment par l’utilisation de la néphro-
tomographie (qui, à la phase vasculaire de l’injection,
permet de faire la différence entre kyste et tumeur).
L’UIV ne se conçoit alors qu’avec une avalanche de
clichés, comprenant l’inévitable compression urétérale
(sauf colique néphrétique), l’incontournable test à l’io-
de préalable…
La notion dynamique de l'injection est une source d’in-
térêt radiologique pour la physiologie rénale, en même
temps que les descriptions sémiologiques se multi-
plient.
La pyélographie rétrograde est en recul, à l’inverse des
autres opacifications endocavitaires qui se développent
(cystographie …). Malgré les éléments apportés par la
néphrotomographie, les explorations vasculaires sont
de plus en plus indiquées du fait de la découverte de
bon nombre de masses rénales qui ne font pas leur
preuve.
Le rétropneumopéritoine est indiqué lorsqu’une masse
semble d'origine extrarénale.
Le début de la révolution technologique commence dès
1970. Les tomographies sont devenues systématiques,
comprenant même des temps vasculaires (clichés
minutés précoces) si une HTA rénovasculaire est sus-
pectée.
L’échographie fait ses débuts et apporte d’emblée des
informations que l’UIV était incapable de fournir en
totalité : taille des reins, lésions kystiques/solides, état
des cavités.
On commence à parler, sans savoir quel sera son rôle
futur à jouer, de la tomodensitométrie (TDM).
Les années 1980 sont transitoires. En TDM, émergent
les premières indications : cancer du rein (complément
à l’échographie), puis angiomyolipome, pathologie
inflammatoire et traumatique. La lymphographie est
progressivement remplacée par la TDM dans les bilans
d’extension des cancers testiculaires.
Du fait des réponses précises apportées par le couple
échographie/TDM, l’artériographie est en net recul.
La substitution des produits de contraste classiques par
des produits non ioniques, en dépit de leur surcoût,
s’effectue petit à petit; en même temps on assiste à une
véritable préoccupation scientifique sur la néphrotoxi-
cité des PDC iodés.
Ces années là voient aussi l’introduction de l’IRM, de
l’échoDoppler, des gestes interventionnels peu vulné-
rants (néphrostomie percutanée et surtout lithotripsie
+++).
L’accomplissement de la substitution se fait entre 1990
et 2000. Cette dernière décennie est l'occasion d'avan-
cées en matière de caractérisation tissulaire (imagerie
dynamique), notamment grâce à la TDM spiralée (dif-
férentes phases => uroscanner), et grâce à l’écho-
Doppler couleur.
L’Uro-IRM montre sa capacité à visualiser l'arbre uri-
naire comme l'urographie intraveineuse, mais avec
l’avantage considérable de n’avoir recours à aucun pro-
duit de contraste [23, 30].
La cystographie et l’uréthrographie ont des indications
beaucoup plus sélectives et, par conséquent, de plus en
plus limitées.
Pourquoi préférer les nouvelles techniques à l’UIV?
L’appareil urinaire est composé d’un environnement
J.P.Laissy et coll., Progrès en Urologie (2001), 11, 552-561

parenchymateux distribué autour de l’arbre urinaire,
lui-même représenté par un luminogramme.
Les applications de l'imagerie en urologie comprennent
donc l’étude des parenchymes, que ce soit le rein (can-
cer et bilan d’extension, tumeurs bénignes, pyéloné-
phrite, traumatismes), la prostate et les testicules; des
conduits (uretères, vessie, urètre masculin et féminin
(diverticules..) et des vaisseaux.
Les indications cliniques majeures de l’imagerie
s’inscrivent dans un cadre relativement restreint où
l’UIV n’a plus le rôle pivot des décennies passées.
Nous verrons en effet qu’en cas de colique néphré-
tique et de pyélonéphrite, d’hématurie macrosco-
pique, de traumatisme rénal et enfin de dysurie qui
sont les motifs de consultation les plus fréquents, les
imageries alternatives remplacent favorablement
l'ASP et l'UIV.
Il en est de même dans d’autres situations cliniques,
notamment les douleurs et masses abdominales, et
l’HTA rénovasculaire.
Les pathologies malformatives méritent une place à
part.
Enfin, certaines indications très spécifiques de l’injec-
tion d’iode, notamment de façon rétrograde (cystogra-
phie rétrograde, UCMR, UPR) resteront encore indi-
quées pendant au moins plusieurs années, et ne seront
par conséquent pas évoquées.
La colique néphrétique
Les urologues reconnaissent leur réticence vis-à-vis de
la TDM sans injection dans le diagnostic de colique
néphrétique. En réalité, cette réticence n'est liée qu'à
l'absence de cartographie des voies urinaires à laquelle
ils/elles sont habitué(e)s depuis maintes années. La lit-
térature scientifique a pourtant montré de manière non
équivoque la supériorité de la TDM par rapport à l'UIV
dans cette situation [15, 35], et ceci pour plusieurs
raisons : l'absence de néphrotoxicité puisqu'il n'y a pas
d'injection de produit de contraste iodé, la meilleure
résolution en contraste de la TDM par rapport à l’ASP,
la rapidité d'exécution de la TDM. Malgré l'absence
d'injection de produit de contraste, il est possible de
reconnaître une dilatation des cavités pyélourétérales
en amont de l'obstacle (Figure 1), et de repérer un
nombre supérieur de calculs [8]. De nouvelles descrip-
tions sémiologiques ont permis d'affiner le diagnostic
différentiel et d'apporter des critères pronostiques.
La distinction entre un calcul et un phlébolithe repose
sur deux signes. La paroi urétérale autour du calcul est
le siège d'un oedème et éventuellement s'accompagne
d'une infiltration périurétérale; le phlébolithe de siège
intravasculaire donne un aspect en queue ou en ficelle
[36].
Le degré d’infiltration périrénale est corrélé dans 94%
des cas au degré d ’obstruction observé en UIV (Figure
2), et il a été décrit comme étant prédictif du passage
spontané ou non des calculs [6].
L’infiltration de la graisse périrénale et périurétérale
ainsi que l’œdème de la paroi urétérale sont d’autant
plus fréquemment rencontrés que l’obstacle est sous
tension et s’accompagne d’une dilatation des voies uri-
naires [36].
La seule limite médicale de la TDM, comme des autres
imageries (sauf IRM?) est la colique néphrétique chez
des patients séropositifs pour le VIH sous traitement
par Indinavir, car le calcul est de très faible densité et,
par conséquent, indissociable des structures tissulaires
environnantes [10].
Il existe une autre limite, cette fois-ci organisationnel-
le, la disponibilité en urgence du scanner hélicoïdal.
Dans ce cas de figure, l’association d’un contexte cli-
nique évocateur, d’une échographie de l'appareil uri-
naire objectivant une dilatation et d’un calcul vu à
l'ASP suffit au diagnostic dans 90% des cas.
L'hématurie
Une des dernières indications résiduelles de l’urogra-
phie intraveineuse est l'hématurie. Les patients se pré-
sentant avec une hématurie macroscopique nécessitent
une évaluation à la fois du parenchyme rénal et de
l'urothélium. L'évaluation traditionnelle de ces patients
se faisait par l'UIV et la cystoscopie. Il est devenu
néanmoins de plus en plus habituel d'examiner ces
patients en uro TDM, pour évaluer de façon simultanée
les reins à la recherche de masse, et les voies excré-
trices (la prostate est par contre mal étudiée par cette
technique).
Pathologie tumorale
Dans une étude datant déjà de quelques années, il avait
été démontré que pour les lésions tumorales rénales de
3 cm, la sensibilité de l’UIV n'était que de 85% par rap-
554
Des concepts clés
• Diagnostic différentiel des douleurs du flanc (appendicite,
diverticulite, affections gynécologiques) :
- TDM = vue panoramique de la cavité abdomino-pelvienne.
• Injection = un problème de responsabilité médicale :
- Accidents idiosyncrasiques liés aux PDC iodés intraveineux
- Néphrotoxicité
• Coût = problème de société
- ASP + TDM = moins cher qu’échographie et UIV
- Irradiation : un problème de santé publique :
- ASP + TDM pas plus irradiants qu’une UIV
J.P.Laissy et coll., Progrès en Urologie (2001), 11, 552-561

555
Figure 1. Examen TDM sans injection pour récidive de colique néphrétique droite. Présence d’un calcul millimétrique intraré -
nal droit (a), et d’un calcul de l’uretère proximal droit (b, coupe axiale et c, reconstruction coronale), sans infiltration périréna -
le et avec minime dilatation du bassinet droit (d), traduisant un minime degré d’obstruction.
J.P.Laissy et coll., Progrès en Urologie (2001), 11,552-561
a b
c
d

556
Figure 2. Examen TDM sans injection pour colique néphrétique gauche. infiltration périrénale gauche modérée (a), traduisant
indirectement une obstruction urétérale modérée, en amont d’un calcul du méat urétéral gauche (b). Noter néanmoins l’asymé -
trie de taille des reins.
Figure 3. Uroscanner pour hématurie chez une femme de 83 ans. Dilatation des cavités pyélocalicielles droites, au sein desquelles
sont présentes des images lacunaires engaînantes et/ou à implantation large sur la paroi caractéristiques de tumeur urothéliale
(a, b, c). Cette tumeur est obstructive car elle s’accompagne d’un néphrogramme suspensu, par comparaison à la néphrographie
du côté sain. L’obstacle est également évident sur le cliché numérisé d’uroscanner réalisé en fin d’examen (d).
J.P.Laissy et coll., Progrès en Urologie (2001), 11, 552-561
b
a
a
b
cd
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%