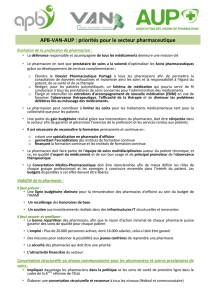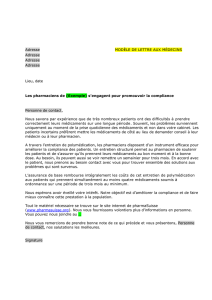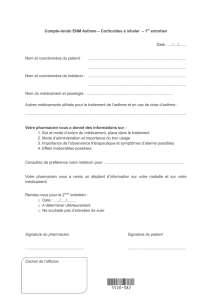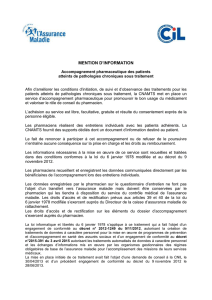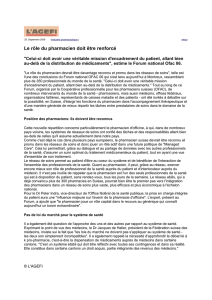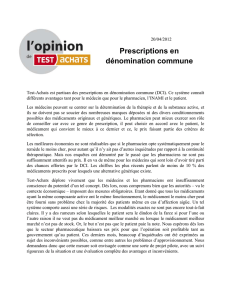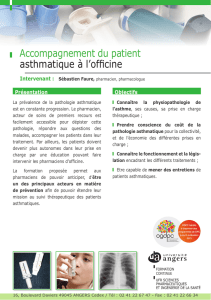Le pharmacien et la santé publique en Suisse à l

Le pharmacien
et la santé publique en Suisse
à l’aube du 21e siècle
Programme en 32 thèses

32 thèses | pharmaSuisse
Le pharmacien
et la santé publique en Suisse
à l’aube du 21e siècle
Programme en 32 thèses
Version 2004
Dominique Jordan, Président
Dr Marcel Mesnil, Secrétaire général

32 thèses | pharmaSuisse
Le pharmacien est le professionnel du médicament. Il en connaît le développe-
ment, l’utilisation et l’élimination adéquate en intégrant les nouveaux déve-
loppements comme les technologies de l’informatique, la pharmacoéconomie et
la pharmacogénomique. Son savoir, ses compétences par rapport à la prise en
charge des patients et sa neutralité font de lui un garant de qualité et de sécurité,
mais aussi un générateur d’économies dans le système de santé.

32 thèses | pharmaSuisse
Index
1. Thèses sur la formation du pharmacien en général
1.1 Formation de base 6
1.2 Formation postgrade 6
1.3 Formation continue 7
1.4 Spécialisations 7
2. Thèses sur la mission du pharmacien d’officine
2.1 Suivi du traitement prescrit par le médecin 8
2.2 Médication officinale 8
2.3 Sécurité et observance thérapeutique 9
2.4 Prévention et éducation à la santé 9
2.5 Prestations de services sociaux 9
2.6 Service d’urgence 9
2.7 Rationalité et économicité des pharmaciens 9
2.8 Agencement des pharmacies 10
2.9 Collaborateurs 10
3. Thèses sur les conditions-cadre
3.1 Remise de médicaments par les pharmaciens 11
3.2 Indépendance professionnelle 11
3.3 Rémunération des prestations 11
3.4 Publicité pour les médicaments 12
3.5 Densité d’implantation des pharmacies 12
3.6 Loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh) 12
3.7 Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) 12
3.8 Loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd) 13
3.9 Chaînes et groupements de pharmacies d’officine 13
4. Thèses sur les relations avec les partenaires
4.1 Médecins 14
4.2 Grossistes 14
4.3 Offices de facturation 14
4.4 Industrie pharmaceutique 15
4.5 Assurances-maladie 15
4.6 Autorités sanitaires 15
4.7 Droguistes 16
4.8 Organisations de patients et de consommateurs 16
4.9 Médias 16
4.10 Responsables politiques 16

6
32 thèses | pharmaSuisse
1. Thèses sur la formation du pharmacien en général
La formation des pharmaciens est conçue en fonction des multiples possibilités
professionnelles. Les études de base sont suivies d’une formation spécialisée
touchant aussi aux techniques de décision, de direction et de gestion. Le tout est
complété par des programmes de formation continue obligatoires.
1.1 Formation de base
La formation universitaire de base, à l’intersection entre sciences naturelles et
médecine, constitue la condition sine qua non pour l’exercice de la profession
dans tous les secteurs. L’année de stage doit conférer au diplômé le bagage
nécessaire pour mener à bien les missions spécifiques à l’orientation prise. Au
terme de ses études, le diplômé dispose des connaissances nécessaires pour sé-
lectionner et prescrire des médicaments efficaces et sûrs et en maîtriser les appli-
cations, en pouvant juger des rapports bénéfice / risque et coût / efficacité du
traitement s’il se destine à l’officine ou à une orientation hospitalière. Pour une
orientation dans l’industrie, il doit acquérir les connaissances spécifiques per-
mettant de prendre la responsabilité d’une fabrication à grande échelle ou d’en
assurer les contrôles de qualité. Sa formation doit en particulier intégrer des
nouveaux développements comme les technologies de l’informatique, la phar-
macoéconomie et la pharmacogénomique.
1.2 Formation postgrade
Les pharmaciens diplômés, désirant occuper un poste de direction dans le cadre
d’une officine, de l’industrie, de l’administration ou d’un hôpital, suivent une
formation complémentaire obligatoire (formation postgrade et spécialisations).
La responsabilité de son organisation et de sa qualité en incombe à chaque so-
ciété de discipline au sein de la société professionnelle. La formation postgrade
en pharmacie d’officine confère au diplômé les compétences et les techniques de
gestion d’entreprise nécessaires à la direction d’une officine du type «centre de
santé». Il doit être en mesure d’effectuer un triage efficace, d’assumer une pres-
cription pharmaceutique et de suivre les patients pour les aider à atteindre les
objectifs des traitements prescrits par le médecin. Il doit être un partenaire com-
pétent, critique et efficace pour aider le médecin dans ses choix. Ces activités
nécessitent une solide expérience pratique, ce qui implique que la formation
postgrade doit être suivie conjointement à l’exercice de la profession.
La formation postgrade en pharmacie hospitalière confère au diplômé les com-
pétences et les techniques de gestion nécessaires à la direction d’une pharmacie
d’hôpital et à évaluer le rapport coût / efficacité des traitements médicamenteux
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%