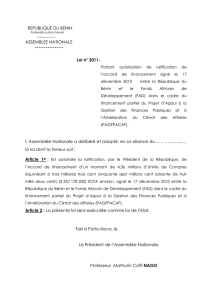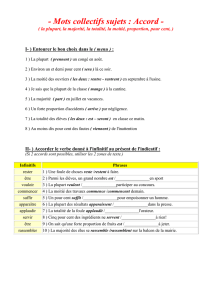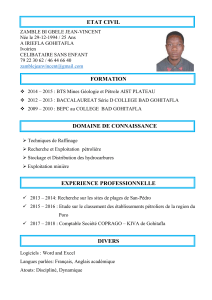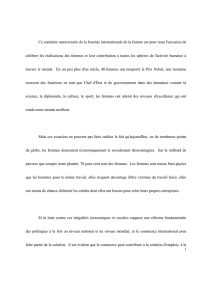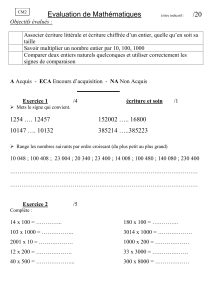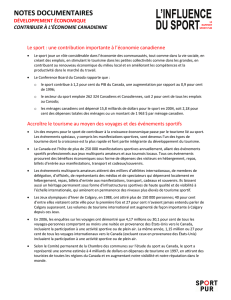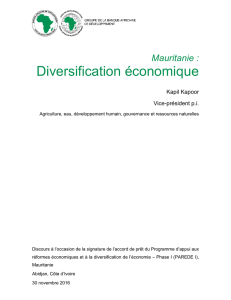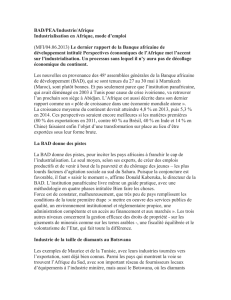le rôle du secteur privé dans le développement économique de l

13
Chapitre 1 : Le rôle du secteur privé dans le développement économique de l’Afrique
Évolution historique
Après leur indépendance, la plupart des
pays africains ont engagé des stratégies de
développement économique tiré par l’État et
reposant sur la substitution des importations. On
considère que ce choix a été déterminant pour
l’industrialisation et la modernisation des pays à
faible revenu. De grandes entreprises d’État ont
été créées dans des secteurs jugés stratégiques et
des barrières commerciales ont été érigées an
de protéger la production nationale naissante.
Les pouvoirs publics ont également instauré des
ofces de commercialisation des produits de base,
chargés de xer les prix. Ces options politiques
ont réorienté les ressources et crédits initialement
alloués à l’agriculture pour les affecter à l’industrie
manufacturière. Pour pouvoir gérer cette situation,
les gouvernements ont mis en place de vastes
administrations publiques, tandis que le secteur
privé se trouvait marginalisé.
Il s’est avéré que le développement économique
conduit par l’État n’était pas viable. La production
et la productivité agricoles stagnaient quand, dans
le même temps, le contrôle des prix canalisait
les ressources vers les secteurs industriels1.
À l’abri de toute pression concurrentielle, les
entreprises d’État n’innovaient pas, s’appuyaient
sur des technologies à forte intensité capitalistique
inadéquates et étaient tributaires d’intrants
importés. En conséquence, leurs exportations
n’étaient jamais compétitives ; au contraire,
elles contribuaient aux décits budgétaire et
commercial, ce qui ne manquait pas d’avoir des
implications économiques graves et durables.
Cette situation a été exacerbée par plusieurs chocs
sur les matières premières durant les années 19702,
aboutissant à une stagnation de l’économie. La
croissance du PIB réel du continent est ressortie,
en moyenne, à seulement 4,5 pour cent par an sur
la période 1960-1980, le revenu réel par habitant
afchant une croissance moyenne de seulement
1,7 pour cent sur la même période (graphique 1.1).
Dans les années 1980, plusieurs pays africains ont
entrepris des réformes économiques et structurelles,
Chapitre 1 :
LE RÔLE DU SECTEUR PRIVÉ
DANS LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE L’AFRIQUE
En Afrique, le secteur privé est en train d’acquérir de la maturité. Entravé pendant
des décennies par un environnement paralysant et par la lourdeur de ses politiques
publiques, il est désormais prêt à assumer son rôle vital de moteur de la croissance
économique et de la lutte contre la pauvreté dans cette région du monde. Le
présent chapitre examine le secteur privé en Afrique, qui représente plus des
quatre cinquièmes de la production totale, les deux tiers des investissements et les
trois quarts des crédits accordés à l’économie, et qui emploie 90 pour cent de la
population en âge de travailler qui occupe un emploi.
1 Entre 1960 et 1980, la croissance agricole par travailleur a progressé au rythme annuel de 0,45 pour cent en Afrique sub-
saharienne.
2 Il s’agit ici des chocs pétroliers au début des années 1970, qui ont eu des répercussions sur tous les pays, et d’autres chocs
affectant certains pays en particulier, notamment l’effondrement des cours du café (Kenya), du cacao (Ghana) et du cuivre
(Zambie).

14 Rapport sur le développement en Afrique 2011
qui se sont traduites par une période sans
précédent de forte croissance à partir des années
1990. La Tanzanie, le Kenya et la Zambie, par
exemple, ont démantelé leurs institutions chargées
du développement tiré par l’État et commencé à
cantonner l’État à une fonction de régulateur et
de facilitateur, laissant alors au secteur privé le
rôle de moteur de la croissance économique. Les
gouvernements ont pour cela cédé les entreprises
d’État, restructuré les services publics, réformé les
ofces de commercialisation des produits de base
et lancé des partenariats public-privé. Ces pays
ont également réformé leur système de gestion
des nances publiques et recentré les dépenses
publiques sur l’infrastructure, l’éducation et la
santé. De surcroît, ils ont supprimé le contrôle
de l’administration sur les prix, les importations
et les taux de change, et levé les interdictions de
participation à certaines activités commerciales
qui étaient imposées au secteur privé. Certes
difciles, ces réformes ont porté leurs fruits : la
croissance économique, le revenu par habitant
et la productivité ont décollé dans les années
1990, puis s’est accélérée au cours de la dernière
décennie, malgré la crise nancière internationale
de 2008-2009.
La croissance initiale de l’Afrique après les
indépendances, son déclin durable jusqu’au
milieu des années 1990 et sa reprise subséquente
indiquent que les réformes structurelles entreprises
se sont traduites par une véritable transformation
et qu’elles ont eu l’effet attendu. Dans d’autres
régions, des pays qui sont passés par des transitions
similaires ont pu obtenir des résultats comparables.
Au XIXe siècle, le Canada et le Japon, par
exemple, ont suivi une trajectoire similaire, celle
de la croissance tirée par l’État, qui a abouti à
une stagnation économique (encadré 1.1). Après
la libéralisation, la croissance économique s’est
rétablie dans les deux pays et s’est accélérée au
début du XXe siècle. Plusieurs pays d’Amérique
latine, ainsi que l’Union soviétique, ont également
opté pour une accumulation de capital dirigée
par l’État jusqu’à ce que leur économie stagne
dans les années 19703, après quoi la libéralisation
Graphique 1.1 : PIB et PIB par habitant par décennie
(Évolution en pourcentage)
Source : Plateformes de données OCDE et BAD.
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Années 1950 Années 1960 Années 1970 Années 1980 Années 1990 Années 2000
Croissance réelle du PIB Croissance réelle du PIB par habitant
3 En Union soviétique, le taux de croissance de la productivité totale des facteurs ressortait en moyenne à 1,3 pour cent par
an dans les années 1950, a ralenti à -0,1 pour cent durant les années 1960, avant de tomber à -0,8 pour cent puis -1,2 pour
cent respectivement dans les années 1970 et 1980. Dans les années 1970, les niveaux élevés d’investissement et d’accu-
mulation de capital n’ont pas pu compenser cette baisse de productivité, et le PIB par habitant a commencé de stagner
(Easterly et Fischer 1994).

15
Chapitre 1 : Le rôle du secteur privé dans le développement économique de l’Afrique
économique les a aidés à retrouver la voie de l’essor
économique. Enn, dans les années 1990, l’Inde
et la Chine ont engagé des réformes structurelles
levant les restrictions à la participation du secteur
privé dans un certain nombre de secteurs. Ces
réformes ont, à terme, contribué à l’accélération
des taux de croissance, lesquels ont atteint près de
10 pour cent par an4.
Si le récent essor des produits de base a contribué
aux performances économiques de l’Afrique dans
les années 2000, une gestion macroéconomique
prudente et la libéralisation du secteur privé
expliquent plus des deux tiers de l’expansion
économique du continent5. De surcroît, ces
options politiques ont soutenu une croissance
du PIB qui s’est révélée solide face à la crise
économique mondiale et à l’effondrement des
cours des produits de base en 2008 et 2009. Alors
que la plupart des pays d’Afrique ont enregistré
une hausse de leur PIB réel par habitant durant
l’envolée des matières premières des années 1970
(1,4 pour cent en moyenne), leurs performances
pendant le récent boom ont été non seulement
meilleures (2,6 pour cent) (graphique 1.2), mais
aussi moins volatiles (graphique 1.4). Bien que
l’essor des produits de base ait été plus marqué
dans les années 1970 que dans les années 2000
(graphiques 1.2 et 1.3), le PIB réel par habitant de
nombreuses économies d’Afrique s’est contracté
après le premier boom, alors qu’il a continué de
progresser après le second, de 3,8 pour cent en
2008 et de 3 pour cent en 2009.
4 En Inde, les entreprises privées, qui sont entrées sur le marché à compter de 1985, ont vu leur part dans la production
totale augmenter : de 1,6 pour cent en 1990, elle est passée à 15,3 pour cent en 2005 (Alfaro et Chari 2009), faisant baisser
la part des entreprises d’État inefcientes. On a constaté que les entreprises d’État étaient 29 pour cent et 42 pour cent
moins productives respectivement en Inde et en Chine que les entreprises privées (Hsieh et Klenow 2009).
5 De récents rapports (McKinsey 2010) et des examens par les pairs (Beny et Cook 2009) sont parvenus à la même conclu-
sion.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
1874 - 1893
1894 - 1913
1914 - 1923
Source : Société des Nations, statistiques annuelles.
Encadré 1.1 : PIB réel par habitant du Japon, par décennie
(Évolution en pourcentage)
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le
nouveau gouvernement japonais s’est lancé
dans un ambitieux programme de modernisation
et d’industrialisation. Dès 1868, l’État est
intervenu dans quasiment tous les secteurs,
notamment les mines, les chemins de fer, le génie
civil, la télégraphie, la construction navale, la
production de fer et l’industrie manufacturière.
Au début, la production industrielle et le PIB
ont afché une croissance rapide. Cependant,
dans les années 1890, cette stratégie de
croissance s’est révélée intenable, car presque
toutes les entreprises d’État accumulaient des
pertes, et les pouvoirs publics se sont retrouvés
confrontés à une crise budgétaire. Incapables
d’emprunter et confrontées à une ination
galopante, les autorités japonaises ont entrepris
un long programme de privatisation, qui s’est
étiré sur près de 20 ans. Cette restructuration
a jeté les bases de la reprise économique,
effective à compter de 1914.

16 Rapport sur le développement en Afrique 2011
Graphique 1.2 : Cours des produits de base et PIB réel
par habitant dans les années 1970 et 2000
(Évolution en pourcentage)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
1970s 2000s
Croissance du PIB réel par
habitant
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
1970s 2000s
Croissance des cours des produits de base énergétiques
Croissance des cours des produits de base hors énergie
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
1970s 2000s
Croissance du PIB réel par
habitant
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
1970s 2000s
Croissance des cours des produits de base énergétiques
Croissance des cours des produits de base hors énergie
Source : PIB d’après la plateforme de données OCDE et BAD ;
cours des produits de base d’après la Banque mondiale.
Graphique 1.3 : Cours des produits de base, 1961-2010
(Évolution en pourcentage, moyenne mobile sur 10 ans)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006
Énergie Produits de base hors énergie
Source : Indices des produits de base de la Banque mondiale.
Au cours de la dernière décennie, l’expansion
économique de l’Afrique s’est accompagnée
d’une réduction signicative de la pauvreté sur
tout le continent, atteignant même les segments
les plus pauvres de la population6. Après deux
décennies (1980-2000) de stagnation économique
durant lesquelles 70 pour cent de la population
était pauvre7, le taux de pauvreté a reculé de 66
à 61 pour cent sur la dernière décennie. Sur la
même période, la classe de transition, c’est-à-
dire les personnes gagnant entre 2 et 4 dollars
EU par jour, est passée de 14 à 21 pour cent de
la population (graphique 1.5 et tableau 1.1)8. Si
l’expansion économique de la dernière décennie a
6 Sala-i-Martin et Pinkovskiy (2010) parviennent à une conclusion analogue.
7 Sont dénies comme pauvres les personnes qui gagnent moins de 2 dollars EU par jour.
8 La classe de transition, constituée de 101,7 millions de personnes en 2000, en comptait 190,6 millions en 2010. Si les
personnes appartenant à cette catégorie sont susceptibles de passer dans la classe moyenne, elles courent aussi le risque
de retomber dans la pauvreté.

17
Chapitre 1 : Le rôle du secteur privé dans le développement économique de l’Afrique
eu un impact quelque peu décevant sur la pauvreté,
elle a néanmoins abouti à une augmentation du
nombre de non-pauvres (quelque 117 millions de
personnes de plus) dépassant l’augmentation du
nombre de pauvres (73 millions) pour la première
fois en 30 ans.
Graphique 1.4 : Évolution du PIB réel et du PIB réel par habitant, 1951-2009
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
1951
1953
1955
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
2000
2002
2004
2006
2008
Évolution du PIB réel Évolution du PIB réel par habitant
Source : Plateformes de données OCDE et BAD.
Graphique 1.5 : Distribution des catégories de revenus
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980 1990 2000 2010
Classe supérieure (> 20 dollars EU/jour)
Classe moyenne (4-20 dollars EU/jour)
Classe de transition (2-4 dollars EU/jour)
Pauvres (< 2 dollars EU/jour)
Source : Département de la statistique de la BAD et Banque mondiale.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
1
/
27
100%