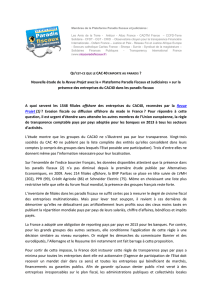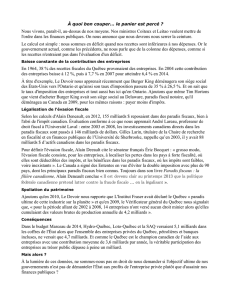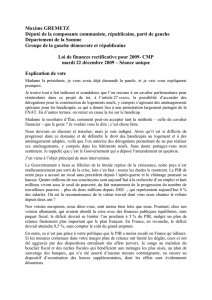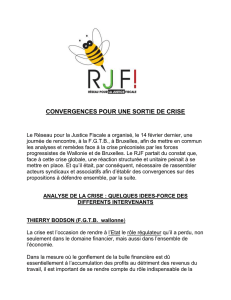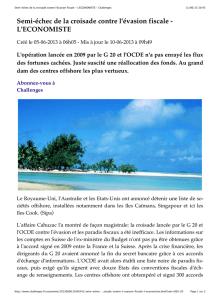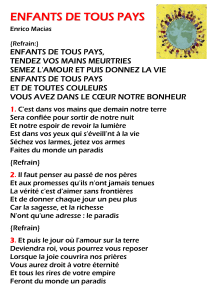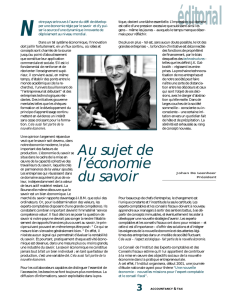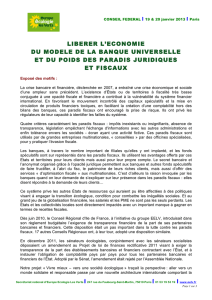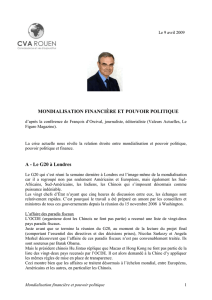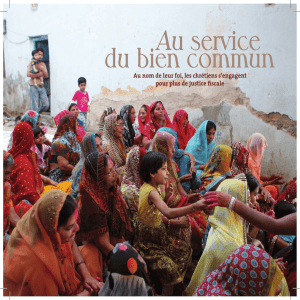Paradis fiscaux, capitalisme mondial et responsabilité

Paradis fiscaux, capitalisme mondial et responsabilité sociale des
entreprises
Christian PRAT dit HAURET
Professeur des Universités
Université Montesquieu Bordeaux IV
06-16-53-35-47
Résumé de la communication
L'objet de l'article est d'analyser le rôle des paradis fiscaux au sein du capitalisme mondial et
d'étudier la place des paradis fiscaux au sein de la gouvernance mondiale à travers le prisme
du concept de responsabilité sociale de l'entreprise. Les paradis fiscaux sont des accélérateurs
de capitaux au service du développement du capitalisme mondial et l'absence d'harmonisation
fiscale européenne et internationale est révélatrice d'une gouvernance mondiale illusoire. Le
rôle joué par les paradis fiscaux questionne la gouvernance des multinationales. La double
question des la responsabilité sociale des entreprises et de ses acteurs est posée.
Mots clés : responsabilité sociale – paradis fiscaux – gouvernance – capitalisme.

L’actualité récente a mis en lumière l’évasion fiscale organisée par des contribuables
allemands qui ont transféré des fonds dans des pays à fiscalité privilégiée pour éviter de payer
l’impôt sur les revenus dans leur pays de domiciliation. Les paradis fiscaux sont au coeur du
capitalisme mondial et joue un rôle important au sein de l’économie mondiale car ils
constituent un espace géographique où le taux d’imposition est faible et les contrôles fiscaux
inexistants.
Si les paradis fiscaux peuvent être utilisés par des particuliers soucieux d’optimiser leur
situation fiscale personnelle, ils jouent également un rôle important au sein du système
capitaliste mondial, terrain de jeu planétaire des firmes multinationales. L’accroissement des
échanges internationaux, le développement des moyens de communication et de transport
offrent en effet de nombreuses possibilités d’optimisation fiscale pour les sociétés
multinationales. Selon le Rapport moral sur l’argent sale dans le monde, rédigé en 2001, les
paradis fiscaux hébergeraient plus de la moitié des capitaux détenus hors frontières, soit plus
de 5 milliards de dollars. De plus, plus de 4 000 banques offshore et plus de 2,4 millions de
sociétés écrans y sont installées.
L’objet de l’article est d’analyser le rôle des paradis fiscaux au sein du capitalisme mondial et
d’étudier la place des paradis fiscaux au sein de la gouvernance mondiale à travers le prisme
du concept de responsabilité sociale de l’entreprise.
I. Paradis fiscaux, capitalisme mondial et gouvernance des Etats :
1. Les paradis fiscaux : des accélérateurs de particules au service du développement du
capitalisme mondial
1.1. Définition et caractéristiques des paradis fiscaux :
Selon l’OCDE, un paradis fiscal est une juridiction imposant peu ou pas d’impôt sur les
revenus des capitaux et qui présente l’une des caractéristiques suivantes : un manque de
transparence, un refus de fournir des informations aux autorités étrangères et la possibilité
d’établir des entreprises fictives. Pour le Groupe d’Action Financière (GAFI), qui est
l’institution en charge de la lutte internationale contre le blanchiment d’argent mafieux, les
paradis fiscaux sont des « pays ou territoires non coopératifs dont la caractéristique première
est la faiblesse de la réglementation en matière financière, l’absence de coopération
administrative internationale et de prévention, de détection et de répression du blanchiment
de capitaux.
Un paradis fiscal est un territoire à fiscalité très basse, par rapport aux autres pays. Les
anglais utilisent le terme de « zero haven ». Selon le Code Général des impôts, l’article 238 A
définit les paradis fiscaux comme des « pays à fiscalité privilégiée » en d’autres termes,
comme des pays où l’imposition est plus faible que dans d’autres pays où l’imposition est
considérée comme normale. Le terme de paradis fiscal est souvent employé dans le montage
d’une société offshore. Les spécialistes lui préfèrent donc celui de pays à la fiscalité très faible
ou très avantageuse.
Chavagneux et Palan (2007) citent le Forum de stabilité financière pour qui les centres
financiers offshore sont des « juridictions attirant un niveau élevé d’activité de la part de non-
résidents » et qui proposent une faible imposition, un régime peu contraignant
d’enregistrement des entreprises, un niveau de confidentialité des transactions excessif et

l’impossibilité pour les résidents d’avoir recours aux mêmes « avantages ». Ils soulignent que
pour l’économiste Richard Johns, les paradis fiscaux sont des pays engageant des politiques
délibérées visant à attirer des activités internationales par la minimisation des impôts et la
réduction de toute autre forme de restriction sur les opérations des entreprises. Richard Johns
souligne que les paradis fiscaux ont deux propriétés essentielles. La première est que leur
développement n’est pas spontané mais résulte de stratégies étatiques. Tous les paradis
fiscaux offrent la même caractéristique : l’utilisation de leur souveraineté pour façonner les
lois (ou une absence de loi) répondant aux intérêts de leurs clients. La deuxième propriété
repose sur la distinction entre les politiques traditionnelles d’attractivité du territoire et ce que
proposent les paradis fiscaux. Ces derniers créent leurs avantages comparatifs par un
allègement de contraintes réglementaires de toutes sortes afin d’attirer des activités étrangères
qui, sinon, n’auraient marqué aucun intérêt pour ces territoires.
Le Fonds de Stabilité Financière ajoute une troisième propriété aux paradis fiscaux, à savoir
que ces centres financiers ne cherchent pas à ce que les entreprises qu’elles veulent attirer
viennent s’installer ou se délocaliser sur leur territoire. Des îles comme Guernesey,
découragent toute forme d’implantation réelle. Les paradis fiscaux s’inscrivent dans la
mondialisation en offrant une résidence juridique et fictive à leurs clients.
Chavagneux et Palan (2007) propose dix critères qui caractérisent 80 territoires considérés
comme des paradis fiscaux actifs. Les dix critères sont les suivants :
- une taxation faible pour les non-résidents ;
- un secret bancaire renforcé ;
- un secret professionnel étendu ;
- une procédure d’enregistrement relâchée ;
- une liberté totale des mouvements de capitaux internationaux ;
- une rapidité d’exécution ;
- le support d’un grand centre financier ;
- une stabilité économique et politique ;
- une bonne image de marque ;
- un régime d’accords bilatéraux.
Selon le rapport Gordon de l’administration fiscale américaine et les travaux de l’OCDE, les
paradis fiscaux présentent un certain nombre de caractéristiques telles que :
- l’absence ou le faible niveau d’imposition pour des dépenses publiques réduites ;
- la stabilité économique et politique ;
- la liberté des changes accompagnée d’une monnaie unique ;
- un secret commercial et un secret bancaire stricts et rigoureux ;
- un secteur financier très développé par rapport à la taille du pays ou la dimension
de son économie ;
- des infrastructures de communication et de transport ;
- l’impunité judiciaire relativement aux lois nationales.
1.2. Paradis fiscaux et développement du capitalisme mondial :
Jessua (2006) définit le capitalisme « comme un système socio-économique dominant avec
pour figure dominante celle du capitaliste. Ce dernier est entendu soit comme un possesseur
de capitaux qui s’efforçe de les faire fructifier en les plaçant, soit comme un entrepreneur qui
décide de les mettre lui-même en valeur dans son entreprise. Cette définition implique une

distinction nette entre les possesseurs de capitaux (les capitalistes) et les salariés qui ne
possèdent que leurs bras. François Quesnay décrivait déjà les fermiers comme des possesseurs
de capitaux importants. Après lui, des auteurs comme Adam Smith ont entrepris de dévoiler
les ressorts de l’enrichissement des nations, autrement dit de la croissance économique, et ont
insisté sur le rôle joué par le capital existant et par son accumulation ».
Il cite Schumpeter pour qui le capitalisme se définit par l’appropriation privée des moyens de
production, par la coordination des décisions à travers les échanges, en d’autres termes par le
marché ; enfin par l’accumulation des capitaux grâce à des institutions financières, autrement
dit par la création de crédit.
Les paradis fiscaux ne sont pas nouveaux. En effet, 2000 ans avant Jésus-Christ, les premiers
commerçants grecs envoyaient des émissaires dans certains ports afin que vendeurs et
acheteurs, lors d’une transaction, puissent se retrouver à un point convenu pour transborder la
marchandise et échapper ainsi aux taxes portuaires déjà existantes. Mais c’est surtout durant
les années 30 et surtout pendant des Trente Glorieuses que les paradis fiscaux se sont
fortement développés.
Selon les membres d’Attac Suisse (2002), il existerait actuellement plus de sept cent paradis
fiscaux dans le monde et leur localisation ne serait pas le fruit du hasard. Les paradis fiscaux
sont concentrés dans trois grandes zones géographiques : les Caraïbes, l’Europe de l’Ouest et
l’Asie du Sud. Ils sont étroitement adossés et dépendants des grandes puissances industrielles
et bancaires qui dominent le monde : les Etats-Unis, l’Europe de l’Ouest et le Japon. Les plus
connus parmi ces havres financiers sont les Bahamas, les îles Caïmans, Hong Kong,
Singapour et pour l’Europe, les îles anglo-normandes, le Luxembourg et la Suisse. Pour les
membres d’Attac, les paradis fiscaux servent de refuge aux capitaux de sociétés ou à de riches
particuliers qui cherchent à échapper à leur fisc national, donc à frauder. Pour d’autres
membres d’Attac (Attac France, 2003), en trente ans, les paradis fiscaux seraient devenus,
avec la passivité ou la complicité de la plupart des grands états, le cœur du système financier
planétaire sous l’impulsion de l’idéologie ultra-libérale, volant et appauvrissant tous les Etats,
fragilisant les économies, bloquant les politiques de progrès social, reportant l’effort collectif
sur les revenus du travail et développant les inégalités au sein des pays du Nord et du Sud.
Par ailleurs, les paradis fiscaux ne sont pas seulement l’expression d’un dérèglement passager
du système capitaliste et ne constituent pas un phénomène extérieur, une sorte de tumeur
greffée sur le capitalisme, qu’il suffirait d’opérer chirurgicalement pour l’éliminer (Guex,
2002). Ils seraient consubstantiels au système capitaliste et en représenteraient un maillon très
important car les paradis fiscaux constituent la face la plus visible et la plus spectaculaire d’un
phénomène plus profond : la concurrence fiscale à laquelle se livrent les Etats
économiquement développés. Selon cet auteur, « cette concurrence s’est développée à la fin
du XIXième siècle en raison de deux facteurs : premièrement, la course aux armements des
grandes puissances impérialistes, qui a débouché sur la première guerre mondiale, a entraîné
une hausse des dépenses publiques qu’il a fallu financer par une réforme des vieux systèmes
fiscaux. Deuxièmement, la rapide montée en puissance du mouvement ouvrier européen (en
1912 déjà, le Parti social-démocrate devient le parti électoralement le plus fort d’Allemagne,
avec plus de 30% des voix), a eu pour conséquence que cette situation a entraîné
l’introduction ou l’extension d’une série d’impôts qui touchaient directement ou
indirectement les détenteurs de capitaux : l’impôt progressif sur le revenu et la fortune,
l’impôt sur les bénéfices, l’impôt sur l’héritage et dès cette époque, les classes dirigeantes des

pays industrialisés ont cherché à éviter et à frauder les impôts en utilisant, ou même en créant,
certains Etats dans lesquels le fisc resterait beaucoup plus clément ».
De façon plus globale, l’existence des paradis fiscaux met en cause les fondements du
capitalisme mondial sur une de ses composantes fondamentales : la transparence. Ils
contribueraient de façon significative à l’évasion fiscale, au blanchiment des capitaux, au
développement de la corruption et à la fluidité du capitalisme mondial.
2. L’absence d’harmonisation fiscale internationale et européenne, révélatrice d’une
gouvernance mondiale illusoire :
2.1. Une harmonisation fiscale au point mort :
Sur le plan européen, l’absence d’harmonisation fiscale européenne est la règle et les paradis
fiscaux foisonnent. Selon Lambert (1994), « il y a au sein de l’Union Européenne ou dans les
territoires qui y sont associés des enclaves, des zones à fiscalité privilégiée, alors même que la
Commission de Bruxelles œuvre à l’harmonisation des impositions nationales ». Il souligne
« qu’en France, l’administration fiscale retient les pays où il n’existe pas d’impôt sur le
revenu, ceux dans lesquels les revenus de source étrangère ne sont pas imposés, les Etats et
territoires étrangers où les impôts sont notoirement moins imposés qu’en France. L’Espagne
considère comme paradis fiscaux des pays comme Andorre, Gibraltar, le Luxembourg pour
les sociétés holding et San Marin ». Il met également en évidence que certains territoires sont
situés dans l’union douanière sans pour autant appartenir à l’Union Européenne, même s’ils
disposent de dispositions particulières dans leurs relations avec les Etats membres de la
Communauté. C’est le cas des îles Anglo-Normandes. Jersey permet aux investisseurs de
créer des structures juridiques pour accueillir et faire fructifier des fonds privés ou en faisant
appel à l’épargne publique. L’île n’a que deux conventions fiscales. L’une d’une portée très
limitée avec le Royaume-Uni, l’autre avec la France concernant les profits réalisés au titre des
transports maritimes et aériens. Jersey est ainsi un havre fiscal cherchant à attirer les non-
résidents par une législation particulièrement favorable où prospèrent les trusts.
La question qui se pose de façon plus globale est celle de la légitimité de l’impôt. L’impôt est
légitime car il contribue à l’équilibre économique. Pour Ardant (1972), « le point de départ est
simple : lorsque les particuliers s’enrichissent, ils ne dépensent pas toute l’augmentation de
leurs revenus et pour ne pas réduire les débouchés et l’emploi, cette limitation de la
consommation devrait être compensée par d’autres dépenses, des dépenses
d’investissement ». La conclusion tirée par l’école socialiste est que la gestion de l’économie
par les représentants de la collectivité est nécessaire non seulement à la justice sociale, mais
aussi au plein emploi des ressources productives ».
2.2. Une gouvernance mondiale de façade :
Malgré l’existence d’institutions internationales, la gouvernance mondiale ne semble qu’une
illusion. Pour Berns (2006), « un monde constitue une totalité, or la gouvernance ne totalise
pas ; elle joint ou connecte des éléments, mais sans que ceux-ci s’intègrent dans une totalité…
et elle est le lieu où l’opposition entre économie et politique se dilue ». Il existerait ainsi une
porosité entre la politique et l’économie. Il met en évidence que « l’économie approche
foncièrement la société d’une manière domestique mais ne peut pas se limiter à l’enceinte de
la maison, emménage tout autour d’elle et privatise la vie publique ».
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%