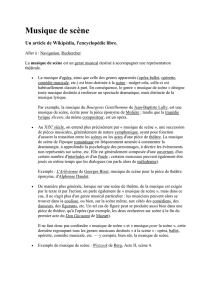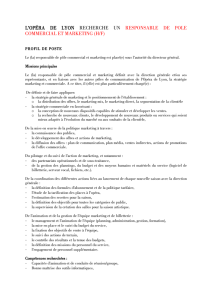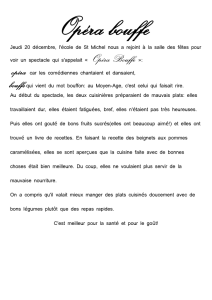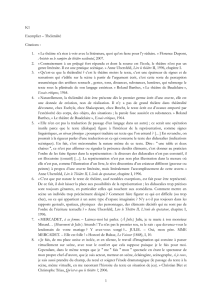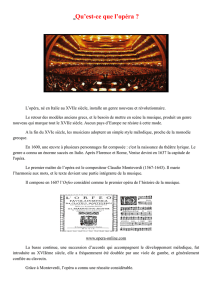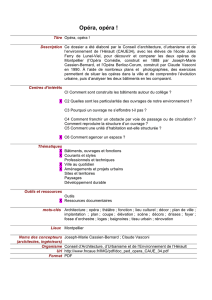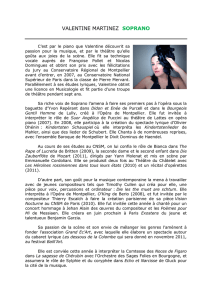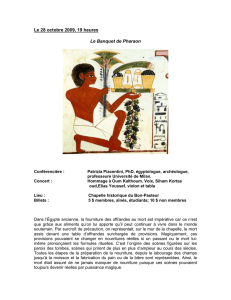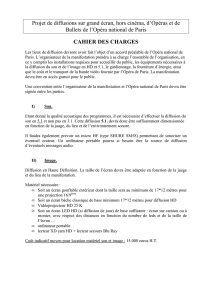Nuit quotidienne, nuit spectaculaire, nuit absolue - IRCL

© 2015 ARRÊT SUR SCÈNE / SCENE FOCUS (IRCL-UMR5186 du CNRS)
ISSN 2268-977X. Tous droits réservés. Reproduction soumise à autorisation.
Téléchargement et impression autorisés à usage personnel. www.ircl.cnrs.fr
!
!!
!
!
!
!
"#$%!&#'%$($)**)+!*#$%!,-).%/.#0/$1)+!*#$%!/2,'0#)!
3#)0&#),!1450)6$'*,!,#1!0)!%748%1)!741'9&#):!51/*;/$,!
<-/104!)%!0=1$&#)>!()!0?8@)!.0/,,$&#)!
!
A/%7)1$*)!BC"DEFGH!
I*$J)1,$%4!A7/10),K()KL/#00)!M!F$00)!N!
!
3#)!5/#%K$0!)*%)*(1)!-/1!O!,.P*)!()!*#$%!Q!R!S)!%)00),!,.P*),!,'*%K)00),!-)1%$*)*%),!-'#1!
($,%$*@#)1!'#!'--',)1!%748%1)!-/104!%1/@$&#)!)%!%1/@4($)!0=1$&#)+!,'#,!&#)00),!T'(/0$%4,!,?=!
-14,)*%)*%K)00),!R!
U)!-1'-',)!()!($,%$*@#)1!%1'$,!),-P.),!()!*#$%,!V!0/!nuit%quotidienne+!)*!1)0/%$'*!W!0/!
&#),%$'*! ()! 0?#*$%4! ()! %)T-,!X! 0/! nuit% spectaculaire+! )*! 1)0/%$'*! W! 0/! T'(/0$%4! ()! 0/!
1)-14,)*%/%$'*! )%! W! ,/! -',,$2$0$%4!X! )*5$*! 0/! nuit% absolue! ('*%! 0),! ()#6! /,-).%,!
<.',T'0'@$&#)!)%!T'1/0>!14#*$,,)*%!)%!'--',)*%!%'#%!W!0/!5'$,!0),!()#6!%748%1),!M!-/104!)%!
0=1$&#)!M!T$)#6!&#)!*)!-)#%!0)!5/$1)!0/!&#),%$'*!()!0?#*$%4!()!%)T-,Y!
Nuit!quotidienne!
F/! -1)T$P1)! '..#11)*.)! '#! T'(/0$%4! &#$! J$)*%! W! 0?),-1$%! ),%! 0)! ,)*,! .'#1/*%! (#! %)1T)!
O!*#$%!QY!C0!,)!145P1)!W!0/!(#14)!()!0/!1'%/%$'*!&#'%$($)**)!()!0/!D)11)!,#1!,'*!/6)+!0/!*#$%!
(4,$@*/*%!0/!(#14)!-)*(/*%!0/&#)00)!#*)!-/1%$)!()!0/!-0/*P%)!,)!%1'#J)!(/*,!0?'T21)+!(#14)!
&#$!J/1$)!W!0/!5'$,!,)0'*!0/! 0/%$%#()!(?#*! 0$)#!,#1! 0)!@0'2)! %)11),%1)!)%! ,)0'*!0/! -',$%$'*!()!
.)0#$K.$!(/*,!,/!14J'0#%$'*!/**#)00)!/#%'#1!(#!Z'0)$0Y!F?$*.0$*/$,'*!()!0?/6)!()!0/!D)11)!,#1!0)!
-0/*! ()! 0?4.0$-%$&#)! 1)*(! .'T-%)+! -/1! #*)! 1)-14,)*%/%$'*! @4'T4%1$&#)+! ()! 0/! J/1$/%$'*!
,/$,'**$P1)! (),! (#14),! (?)*,'0)$00)T)*%! )%! (?'T21)Y! [! 0/! 0/%$%#()! ()! H'#)*! M! \)! -1)*(,!
.'TT)!14541)*.)!0/!J$00)!*/%/0)!()!A'1*)$00)+!('*%!0/!0/%$%#()!),%!-1'.7)!()!.)00)!()!]/1$,!M+!
.)%%)!(#14)!,)!,$%#)+!,)0'*!0/!,/$,'*+!)*%1)!:^!7)#1),!)%!_!7)#1),!)*J$1'*Y!
I*)!'-$*$'*!14-/*(#)!),%!&#)!%748%1)!-/104!)%!%748%1)!0=1$&#)!,?'--',)*%!(#!5/$%!&#)!
0)! -1)T$)1! ,)1/$%! ,'#T$,! W! #*)! ,%1$.%)! O!#*$%4! ()! %)T-,!Q+! W! ,/J'$1! 0)! \'#1! -1$,! /#! ,)*,!
1),%1)$*%! <(#14)! (?)6-',$%$'*! /#! 1/='**)T)*%! ,'0/$1)>+! )%! &#)! 0)! ,).'*(! ,)1/$%! 0$2414! ()!
.)%%)!.'*%1/$*%)!V!/$*,$!0),!O!,.P*),!()!*#$%!Q+!-14%)*(#T)*%!$00$.$%),!W!0/!,.P*)!-/104)+!,'*%!
-',,$20),!)%!T`T)!514&#)*%),!W!0/!,.P*)!0=1$&#)Y!
a*! *)! -)#%! -/,+! /0'1,+! 4J$%)1! 0/! &#),%$'*! .0/,,$&#)! ()! 0?#*$%4! ()! %)T-,! W! 0/! ,.P*)!
-/104)!)%!()!,'*!/--14.$/%$'*Y!F/!%1/@4($)!-/104)+!($%K'*+!)6.0#1/$%!0/!*#$%!W!./#,)!()!.)!&#$!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: U?#%$0$,)!0)!&#/0$5$./%$5!O!741'9&#)!Q!-0#%b%!&#)!O!%1/@$&#)!Q!./1! \)! -1)*(1/$! &#)0&#),! )6)T-0),!)*!()7'1,!(#!
@)*1)!%1/@$&#)!stricto%sensu+!/J).!*'%/TT)*%!Le%Cid!)%!Zaïs!-/,%'1/0)!741'9&#)Y!

!
Scènes de nuit/Night Scenes
ARRÊT SUR SCÈNE/SCENE FOCUS 4 (2015)!
!
!
cdef!
),%!,'#J)*%!-14,)*%4!.'TT)!#*)!O!.'*J)*%$'*!QY!S?/2'1(!.)!*?),%!-/,!#*)!.'*J)*%$'*+!-/,!
-0#,! &#)! *?),%! #*)! .'*J)*%$'*! 0/! *'%$'*! T`T)! (?#*$%4! M!T/$,!\)!*?)*%1)1/$! -/,! (/*,! 0)!
(4%/$0!()!.)!-'$*%!X! \)!0?/$! 5/$%!*/@#P1)! )%!/$00)#1,g!)%!.)!*?),%!-/,! )6/.%)T)*%!T'*!,#\)%Y!
G*,#$%)+!$0!,#55$%!()!&#)0&#),!'..#11)*.),+!)%!*'*!(),!T'$*(1),+!-'#1!T'*%1)1!&#)!0/!,.P*)!
-/104)!%1/@$&#)!)%! 741'9&#)!*?)6.0#%! -/,!*4.),,/$1)T)*%! 0/!*#$%Y! A)!*?),%! -/,!-/1! 7/,/1(!
&#?'*!0),!1)*.'*%1)!-1$*.$-/0)T)*%!.7)h!A'1*)$00)Y!]1)*'*,!&#)0&#),!)6)T-0),Y!
Le%Cid%.'TT)*.)!0)!,'$1+!,)!(41'#0)!)*,#$%)!0/!*#$%!)%!,?/.7PJ)!0)!0)*()T/$*!T/%$*Y!C0!
*?),%!@#P1)!4%'**/*%!&#)!0),!-)1,'**/@),!)*!,'$)*%!/#,,$!)6/0%4,!)%!(4-1),,$5,!%'#1!W!%'#1!V!
$0,! T/*&#)*%! ()! ,'TT)$0!i! j'$.$! &#)0&#),! $*($.),! -)1T)%%/*%! ()! ,$%#)1! 0)! ./1/.%P1)!
*'.%#1*)!()!0/!-$P.)Y!F/!*#$%!%'T2)!W!0?/.%)!CC!V!
Sa"!kGH"l"SY!
F?)551'$!&#)!-1'(#$1/$%!.)%%)!/0/1T)!$*#%$0)+!
S/*,!0/!*#$%!&#$!,#1J$)*%+!%1'#20)1/$%!%1'-!0/!J$00)!V!
]#$,&#?'*!5/$%!2'**)!@/1()!/#6!T#1,!)%!,#1!0)!-'1%+!
C0!,#55$%!-'#1!.)!,'$1NY!
mYYYn!
AoCpq"GY!
S/*,!0?'T21)!()!0/!*#$%!./.7)!2$)*!%'*!(4-/1%rY!
F/!.40P21)!2/%/$00)!.'*%1)!0),!p/#1),+!7'1,!,.P*)+!,)!(41'#0)!-)*(/*%!0/!*#$%!V!
Sa"!SCqLIGY!
F),!p/#1),!J'*%!(),.)*(1)!X!)%!0)!50#6!)%!0/!*#$%!
S/*,!#*)!7)#1)!W!*',!T#1,!0),!/TP*)*%!,/*,!21#$%dY!
a*!*)!-)#%!14,$,%)1!/#!-0/$,$1!()!.$%)1!0)!14.$%!()!H'(1$@#)!&#$!1)J$)*%!W!0?/.%)!Cj!V!
U?)*!./.7)!0),!()#6!%$)1,+!/#,,$%b%!&#?/11$J4,+!
S/*,!0)!5'*(!(),!J/$,,)/#6!&#$!0'1,!5#1)*%!%1'#J4,!V!
F)!1),%)+!('*%!0)!*'T21)!/#@T)*%/$%!W!%'#%)!7)#1)+!
s1t0/*%!(?$T-/%$)*.)+!/#%'#1!()!T'$!()T)#1)+!
Z)!.'#.7)!.'*%1)!%)11)+!)%+!,/*,!5/$1)!/#.#*!21#$%+!
]/,,)!#*)!2'**)!-/1%!(?#*)!,$!2)00)!*#$%^Y!
I*)! O!,$! 2)00)! *#$%!Q! (4.1$%)! -/1! 0)! .40P21)! J)1,!V! O!A)%%)! '2,.#1)! .0/1%4! &#$! %'T2)! (),!
4%'$0),u!QY!
S/*,!Nicomède+!0?/.%)!j!.'TT)*.)!/J/*%!0?/#2)!V!0/!14J'0%)!(#!-)#-0)!/!.'TT)*.4!
()!*#$%Y!
lHZC"avY!
G%!,$!0?'2,.#1$%4!0/$,,)!.1'w%1)!.)!21#$%+!
F)!\'#1!($,,$-)1/!0),!J/-)#1,!()!0/!*#$%_Y!
mYYYn!
j'#,!)*J)11)h!/-1P,+!,$%b%!&#?$0!,)1/!\'#1+!
G%!J'#,!0#$!('**)1)h!0?),-'$1!(?#*!-1'T-%!1)%'#1x!myn!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
g!A/%7)1$*)!B$*%h0)1+!Poétique%de%l’opéra%français%de%Corneille%à%Rousseau+!]/1$,+!p$*)1J)+!<:xx:>!gee^Y!
N!]$)11)!A'1*)$00)+!Le%Cid+!CC+!J$+!JY!^NNK^N^Y!F),!.$%/%$'*,!&#)!*'#,!('**'*,!()!A'1*)$00)!,'*%!%'#%),!)6%1/$%),!()!
,),!Œuvres%complètes!)*!%1'$,!J'0#T),+!4(Y!LY!A'#%'*+!s$20$'%7P&#)!()!0/!]04$/()+!!]/1$,+!L/00$T/1(+!:x_eK_uY!
r!]Y!A'1*)$00)+!Le%Cid+!CCC+!$J+!JY!x_dY!
d!]Y!A'1*)$00)+!Le%Cid+!CCC+!J$+!JY!:e_dK:e_^Y!
^!]Y!A'1*)$00)+!Le%Cid+!Cj+!$$$+!JY!:guNK:gu_Y!
u!]Y!A'1*)$00)+!Le%Cid+!Cj+!$$$+!JY!:g_NY!
_!]Y!A'1*)$00)+!Le%Cid+!j+!$+!JY!:r_:K:r_gY!

C. KINTZLER, Nuit quotidienne, nuit spectaculaire, nuit absolue
!
!
cd:f!
S'*.!,$!0)!\'#1!,)!0PJ)!W!0?/.%)!j+!'*!-)#%!)*!(4(#$1)!&#)!%'#%!.)!&#$!,)!-/,,)!/J/*%!/!0$)#!M!
/#!T'$*,!)*!@1/*()!-/1%$)!M!(#1/*%!0/!*#$%!&#$!-14.P()Y!
S/*,% Sertorius,% 0?/.%)!Cj!/**'*.)!0)! ,'$1! /J).! 0)! 5),%$*! /#!.'#1,!(#&#)0! Z)1%'1$#,! J/!
`%1)!/,,/,,$*4!V!
]GH]G""lY!
D'#%)5'$,!0/!.'0P1)!'z!,?)T-'1%)!,'*!8T)!
]'#11/$%!(P,!.)%%)!*#$%!.'TT)*.)1!&#)0&#)!%1/T)!V!
j'#,!0#$!($1)h+!,)$@*)#1+!%'#%!.)!&#)!J'#,!J'#(1)h:eY!
U)! *)! T?/%%/1()1/$! -/,! 0'*@#)T)*%! ,#1! 0)! .40P21)! Discours% des% trois% unités,% 'z!
A'1*)$00)!5/$%!4%/%!()!,'*! $*%)1-14%/%$'*!5'*(/T)*%/0)T)*%!%748%1/0)+!.?),%KWK($1)!14@04)!
,#1! 0?/.%$'*! (1/T/%$&#)+! ()! 0?#*$%4! ()! %)T-,Y! Z'#0$@*'*,! \#,%)! &#)! A'1*)$00)! =! -',)! 0)!
principe%de%la%fiction%silencieuseY!F/!(#14)!()!0/!-$P.)!*?/!-/,!W!`%1)!2/0$,4)!-/1!(),!1)-P1),!
)6%41$)#1,!()!%=-)! /,%1'*'T$&#)!'z! 0),!-)1,'**/@),!5'*%!0)#1,!1450)6$'*,!,#1!0)!0)J)1! (#!
Z'0)$0+!0)!.7/*%!(),!'$,)/#6!)%.Y!<.'TT)!.?4%/$%!()!1$@#)#1!(/*,!0/!-/,%'1/0)>+!T/$,!),%!#*)!
(#14)!-1'-1)T)*%!%748%1/0)!(/*,!0/&#)00)!.?),%!0?/#($%)#1!&#$!4%/20$%+!-/1!0?)*@/@)T)*%!()!
,'*!/%%)*%$'*!,#1!0?/.%$'*+!0?#*$%4!()!%)T-,Y!
Z#1%'#%!\)!J'#(1/$,!0/$,,)1!.)%%)!(#14)!W!0?$T/@$*/%$'*!(),!/#($%)#1,!)%!*)!(4T41$%)1!\/T/$,!0)!
%)T-,!&#?)00)!)T-'1%)+!,$!0)!,#\)%!*?)*!/J/$%!2),'$*+!-1$*.$-/0)T)*%!&#/*(!0/!J1/$,)T20/*.)!=!
),%! #*! -)#! 5'1.4)! .'TT)! /#! Cid+! -/1.)! &#?/0'1,! .)0/! *)! ,)1%! &#?W! 0),! /J)1%$1! ()! .)%%)!
-14.$-$%/%$'*Y!F'1,!T`T)! &#)! 1$)*!*?),%!J$'0)*%4!(/*,!#*!-'PT)!-/1!0/! *4.),,$%4!(?'24$1!W!
.)%%)!1P@0)+!&#?),%K$0!2),'$*!()!1)T/1&#)1!W!0?'#J)1%#1)!(#!%748%1)!&#)!0)!,'0)$0!,)!0PJ)+!&#?$0!
),%!T$($!/#!%1'$,$PT)!/.%)+!)%!&#?$0!,)!.'#.7)!W!0/!5$*!(#!()1*$)1!R!A?),%!#*)!/55).%/%$'*!&#$!*)!
5/$%! &#?$T-'1%#*)1!X! $0! ,#55$%! (?4%/20$1! 0/! -',,$2$0$%4! ()! 0/! .7',)! (/*,! 0)! %)T-,! 'z! '*! 0/!
1)*5)1T)+!)%!&#?'*!0)!-#$,,)!%1'#J)1!/$,4T)*%+!,$!'*!=!J)#%!-1)*(1)!@/1()+!,/*,!=!/--0$&#)1!
0?),-1$%! T/0@14! ,'$Y! S/*,! 0),! /.%$'*,! T`T)! &#$! *?'*%! -'$*%! -0#,! ()! (#14)! &#)! 0/!
1)-14,)*%/%$'*+!.)0/!,)1/$%!()!T/#J/$,)!@18.)!,$!0?'*!T/1&#/$%!(?/.%)!)*!/.%)!&#?$0!,?),%!-/,,4!
#*)!()T$K7)#1)!()!0?#*!W!0?/#%1)::Y!
A)%%)! (#14)+! -0#,! &#?#*)! /55/$1)! ()! (4.'T-%)+! 14,#0%)! ()! 0?)55)%! ()! %748%1)! )%!
(4%'#1*)! 0?/%%)*%$'*! (#! ,-).%/%)#1! /#,,$! 2$)*! W! 0?4@/1(! ()! 0/! (#14)! '2\).%$J)! <.)00)! &#)!
J$J)*%! 0),! /@)*%,! (1/T/%$&#),>! &#)! ()! 0/! (#14)! 14)00)! <.)00)! (#! ,-).%/%)#1! )%! (),!
.'T4($)*,>Y!G*!5/$%+!.?),%!0/!(#14)!14)00)!&#$!),%!0/!-0#,!.'*%1/$@*/*%)+!-#$,&#?)00)!,)!7)#1%)!
W! (),! 0$T$%),! -7=,$'0'@$&#),! 1)0/%$J),! /#,,$! 2$)*! /#6! .'T4($)*,! &#?/#6! ,-).%/%)#1,+!
/#6&#)0,! '*! *)! -)#%! -/,! $T-',)1! #*)! (#14)! %1'-! 0'*@#):gY! p/$,! 0/! (#14)! '2\).%$J)! ),%!
/,,)h!40/,%$&#)!)%!.)%%)!40/,%$.$%4!*)!,)!14JP0)!&#?W!#*!0).%)#1!T/0$*%)*%$'**4!&#$!.7)1.7)!
0/! -)%$%)! 2`%)Y! ")! (4-/,,'*,! -/,! %1'-! 0),! J$*@%K&#/%1)! 7)#1),+! ($%! A'1*)$00)+! ()! -)#1! ()!
%'T2)1!(/*,!0/!($,-1'-'1%$'*!)*%1)!(#14)!14)00)!)%!(#14)!'2\).%$J)Y!"#0!('#%)!&#?#*)!-$P.)!
,$%#4)!-1P,!(?#*!(),!-b0),+!'z!0/!(#14)!(?)*,'0)$00)T)*%!'#!()!*#$%!/%%)$*%!,$6!T'$,+!()J1/$%!
-'#1! .)%%)! 1/$,'*! 14/0$@*)1! ,'*! #*$%4! ()! %)T-,! ,#1! #*)! 0/%$%#()! -0#,! %)T-414)+! .'TT)!
.)00)!()!H'#)*!'#!()!Z4J$00)+!'#!,#1!0/!1'%/%$'*!()!0/!D)11)!,#1!)00)KT`T)!&#$!),%!%'#\'#1,!
()! gr! 7)#1),! &#)00)! &#)! ,'$%! ,/! -',$%$'*! ,#1! 0)! -/1.'#1,! ()! ,/! 14J'0#%$'*! /**#)00)Y! p/$,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
x!]Y!A'1*)$00)+!Le%Cid+!j+!J+!JY!:^gxK:^NeY!
:e!]Y!A'1*)$00)+!Le%Cid+!Cj+!$$$+!JY!:dg:K:dgNY!
:: ]Y!A'1*)$00)+!Discours%des%trois%unités+!(/*,!Trois%Discours%sur%le%poème%dramatique,!4(Y!pY!G,.'0/!)%!sY!F'#J/%+!
]/1$,+!Lk!k0/TT/1$'*+!:xxx+!-Y!:rdY!
:g G00)!),%!4@/0)T)*%!.'*%1/$*%)!()!T/*$P1)!/2,'0#)!-/1!#*!*4.),,/$1)!.'TT)*.)T)*%!)%!#*)!*4.),,/$1)!5$*+!
,/#5!W!,#--',)1!&#?$0!*?=!/!-0#,!()!($5541)*.)!)*%1)!0)!14)0!)%!0)!5$.%$5+!.'TT)!0?/!5/$%!])%)1!o/*({)!(/*,!Outrage%
au% public,% -$P.)! W! 0$1)! non% représentable!T/$,!*'*!-/,!irreprésentable+! ./1! )*! 0/! 0$,/*%! '*! ,)! 1)-14,)*%)!
-/15/$%)T)*%!0),!.'*,4&#)*.),!-7=,$&#),!)%!,#1%'#%!T'1/0),!(?#*)!/2'0$%$'*!(#!1/--'1%!)*%1)!14)0!)%!5$.%$5Y!

!
Scènes de nuit/Night Scenes
ARRÊT SUR SCÈNE/SCENE FOCUS 4 (2015)!
!
!
cdgf!
.'*%1/$1)T)*%!W!.)!&#)!-'#11/$%!5/$1)!.1'$1)!.)%!)6)T-0)+!0)!1/$,'**/20)!*?),%!-/,!(/*,!0)!
14@0/@)! ()! 0/! (#14)! ()! 0?#*$%4! ,#1! #*)! 14/0$%4! )6%41$)#1)Y! A?),%! /#! .'*%1/$1)! 0?/.%$'*!
%748%1/0)! &#$+! ,)0'*! ,/! */%#1)! -1'-1)+! %1'#J)! (/*,! .)%%)! 14/0$%4! 0)! ,.7PT)! (#! .'*.)-%!
&#?)00)!-'1%)!)*!)00)KT`T)Y!
p/$,!,$!0?'*!-)#%!%1'#J)1!04@$%$T)T)*%!(/*,!0/!%1/@4($)!(1/T/%$&#)+!*'%/TT)*%!.7)h!
A'1*)$00)+! (),! ,.P*),! ,)! (41'#0/*%! 0/! *#$%+! -)#%K'*! -/10)1! -'#1! /#%/*%! ()! O!,.P*),! ()!
*#$%!Q!R!I*)!O!,.P*)!()!*#$%!Q!,#--',)!&#)!0/!*#$%!),%!-14,)*%)!()!T/*$P1)!*4.),,/$1)!en%
tant% qu’elle% est% la% nuit!)%!-/,!,)#0)T)*%!)*!%/*%!&#?)00)! )*%1)! (/*,! 0)! (4.'T-%)! (?#*)!
%)T-'1/0$%4Y! ]'#1! -/10)1! J41$%/20)T)*%! ()! scène% de% nuit+! $0! 5/#%! ('*.! 5/$1)! 0?7=-'%7P,)!
(?#*)!,#--1),,$'*! ()! 0/!*#$%! )*!%/*%!&#)! %)00)+!()! ,'*! /2'0$%$'*+!)%!J'$1! ,$!.)0/!/55).%)!0/!
-$P.)Y!Z$!'*!5/$,/$%!0/!5$.%$'*!&#)!0/!-41$'()!($#1*)!),%!(?#*)!(#14)!40/,%$&#)!-1)*/*%!(),!
0$2)1%4,! /J).! 0),! ('**4),! @4'@1/-7$&#),! )%! /,%1'*'T$&#),+! .)0/! .7/*@)1/$%K$0!
5'*(/T)*%/0)T)*%! 0)! (41'#0)T)*%! ()! 0/! -$P.)!R! l#%1)T)*%! ($%+! T`T)! -)*(/*%! 0),!
T'T)*%,!'z!'*!,/$%!<-/1.)!&#?'*!/!0#!0)!%)6%)!()!-1P,>!&#?$0!5/$%!*#$%+!#*!T)%%)#1!)*!,.P*)!
-)#%K$0!,)!-)1T)%%1)!(?4.0/$1)1!0/!,.P*)!-/1!0/!0#T$P1)!(#!\'#1!,/*,!)*%1)1!)*!.'*%1/($.%$'*!
T/*$5),%)!/J).!.)!&#)!($,)*%!'#!5'*%!0),!-)1,'**/@),!R!a*!'2\).%)1/!&#)!2$)*!(),!T$,),!
)*!,.P*)!*)!,?)T2/11/,,)*%!-/,!()!.)!@)*1)!()!,.1#-#0)+!T/$,!.)0/!*)!*'#,!)T-`.7)!-/,!
(?)*! 5/$1)! 4%/%! .'TT)! (?#*! %),%Y! S/*,! 0),! )6)T-0),! .$%4,+! 0)! -',%#0/%! ()! 0/! 5$.%$'*!
,$0)*.$)#,)!5'*.%$'**)!/#,,$!(/*,!.)!,)*,!V!T`T)!,$!'*!,/$%!&#?$0!5/$%!*#$%+!.)0/!*?/!-/,!#*)!
$T-'1%/*.)! (1/T/%$&#)! ),,)*%$)00)! )%! 0/! &#),%$'*!O!5/$%K$0! \'#1+! 5/$%K$0! *#$%!R!Q! 1),%)!
)6%41$)#1)!W!0/!,%1#.%#1)!(1/T/%$&#)Y!S#!1),%)!0/!-0#-/1%!(#!%)T-,+!'*!,)!1)*(!.'T-%)!&#?$0!
5/$%!*#$%!-/1!#*)!(4(#.%$'*!14%1',-).%$J)+!-0#,!/..),,$20)!/#!0).%)#1!&#?/#!,-).%/%)#1+!.)!
()1*$)1!4%/*%!)*@/@4!(/*,!0)!T'#J)T)*%!(1/T/%$&#)Y!
A)0/!5/$%!&#?'*!-'#11/+!(#!T'$*,!-1'J$,'$1)T)*%+!/J/*.)1!0?$(4)!&#)!0)!%748%1)!-/104!
741'9&#)!51/*;/$,!()!0?8@)!.0/,,$&#)+!,/*,!)6.0#1)!0/!*#$%+!),%!@4*41/0)T)*%!$*($5541)*%+!)*!
%/*%!&#)!%748%1)+!W!0/!*'%$'*!()!O!,.P*)!()!*#$%!QY!D'#%!.)!&#$!/!0$)#!0/!*#$%!*?),%!-/,!-'#1!
/#%/*%! #*)! scène% de% nuitY! U)! ($,! provisoirement!./1!0/!*'%$'*!()! ,.P*)! ()! *#$%! ),%! $.$!
)*%)*(#)!/#!,)*,!'z!0/!*#$%!(4,$@*)!0/!(#14)!-)*(/*%!0/&#)00)!#*)!-/1%$)!()!0/!-0/*P%)!),%!
-0'*@4)!(/*,!0?'T21)!X!'1+!'*!0)!J)11/!-0#,!0'$*+!.)%%)!*'%$'*!-)#%!/J'$1!(?/#%1),!,)*,Y!
La!nuit!spectaculaire!comme!schème!de!représentation!
H),%'*,! -'#1! 0)! T'T)*%! ,#1! .)%%)! /..)-%$'*! '1($*/$1)! (#! %)1T)! nuit! /#! ,)*,!
/,%1'*'T$&#)Y! D1P,! 4J$()TT)*%! )%! )T-$1$&#)T)*%+! '*! -'#11/! /0'1,! '--',)1! %748%1)! )%!
'-41/+!)*!.)!,)*,!&#?W!0?'-41/!*'*!,)#0)T)*%!()!*'T21)#,),!,.P*),!,)!(41'#0)*%!0/!*#$%+!
T/$,! /#,,$! )%! ,#1%'#%! -/1.)! &#)! .),! ,.P*),! *?'*%! -/,! ,$T-0)T)*%! 0/! *#$%! -'#1! ./(1)!
.71'*'0'@$&#)+! T/$,! &#?)00),! ,#--',)*%! nécessairement! 0/! *#$%! )%! ,'*! '2,.#1$%4! -'#1!
-'#J'$1!`%1)!1)-14,)*%4),+!-'#1!`%1)!-',,$20),Y!
A)%%)!*#$%!/,%1'*'T$&#)!/!/0'1,!#*)!5'*.%$'*!),,)*%$)00)+!%)00)!&#?'*!*)! -)#%!-/,!0/!
,#--1$T)1!,/*,!/55).%)1!0/!-$P.)!)00)KT`T)!<%)6%)!)%!T#,$&#)>+!%)00)!&#)!,$!'*!0/!,#--1$T)+!
'*!*)!-)#%!1$)*!J'$1+!1$)*!.'T-1)*(1)!)%!.)!&#?'*!)*%)*(!),%!*'*!-)1%$*)*%Y!A)%%)!5'*.%$'*!
(1/T/%$&#)!-1'-1)! W! 0?'-41/!1)*J'$)!/#!./1/.%P1)! 5'*(/T)*%/0)T)*%! spectaculaire!()! 0/!
,.P*)! 0=1$&#)! ('*%! 0/! ,-0)*()#1! ),%! %'#1*4)! J)1,! 0?)6%41$'1$%4+! ('*%! 0/! @1/*()#1! ),%!
-14.$,4T)*%! ()! 5/$1)! ()! 0?)6%41$'1$%4! #*! $*%41`%! ),,)*%$)0Y! FW! )*.'1)+! \)! *)! ,'#7/$%)! -/,!
(4J)0'--)1! .)! -'$*%+! 0?/=/*%! 4%#($4! (/*,! &#)0&#),! %1/J/#6! /*%41$)#1,:NY! F/! ,.P*)! 0=1$&#)!
5/$%! ()! 0?)6%41$'1$%4! )*! %/*%! &#)! %)00)! #*)! $*%41$'1$%4+! #*)! ),,)*%$/0$%4+! %748%1/0)Y! A?),%! ,/!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:N!j'$1!*'%/TT)*%!AY!B$*%h0)1+!Théâtre%et%opéra%à%l’âge%classique,%une%familière%étrangeté+!]/1$,+!k/=/1(+!geerY!

C. KINTZLER, Nuit quotidienne, nuit spectaculaire, nuit absolue
!
!
cdNf!
@1/*()#1+! ,/! T/@*$5$.)*.)+! .?),%! /#,,$! #*! (),! T'%$5,! ()! 0?/J)1,$'*! (),! /T'#1)#6! (#!
%748%1)! )*J)1,! 0?'-41/!V! 0?'-41/! ,$*@)! )%! %1/7$%! 0)! %748%1)Y! G*! 0?'..#11)*.)! $0! 1/TP*)!
',%)*,$20)T)*%!)%!21#=/TT)*%!,#1!0/!,.P*)!.)!&#)!0)!%748%1)!)*!4./1%)+!.?),%!#*!%748%1)!
(#!O!%'#%!J'$1!)%!%'#%!)*%)*(1)!Q+!#*!%748%1)!,/*,!1),-$1/%$'*+!,/*,!%1'#,+!'z!(P,!&#?'*!-)#%!
$T/@$*)1!#*)!,.P*)!7'1,K,.P*)+!'*!,)!(4-`.7)!()!0/!T)%%1)!,#1!0/!,.P*)Y!I*)!),%74%$&#)!
()! 0?)*.'T21)T)*%! T/$,! /#,,$! #*)! ),%74%$&#)! ('T$*4)! -/1! #*)! T4%/-7=,$&#)! ()! 0/!
*/%#1)!)%!()!0/!&#/,$K*/%#1)+!(?'z!,/!,-0)*()#1Y!
F/!*#$%!=!$*%)1J$)*(1/!('*.!.'TT)!#*!404T)*%!-/1%$.#0$P1)T)*%!,-).%/.#0/$1)Y!G%!.)!
T'T)*%! 5'#1*$%! #*! ,.7PT)! &#$! ,?4%)*(! /#K()0W! (#! .'*.)-%! ()! *#$%! -1$,! /#! ,)*,!
/,%1'*'T$&#)Y! F/! *'%$'*! ,-).%/.#0/$1)! ()! *#$%! -)#%! `%1)! 40/1@$)! -'#1! (4,$@*)1! 0),!
T'T)*%,! 'z! 0/! ,.P*)! ),%! )6-0$.$%)T)*%! )%|'#! *4.),,/$1)T)*%! -0'*@4)! (/*,! 0?'2,.#1$%4Y!
G6-0$.$%)T)*%!V! -/1! #*)! $*($./%$'*! ,.4*$&#)! ()! 0/! T/$*! ()! 0?/#%)#1Y! "4.),,/$1)T)*%!V! ()!
%)00)!,'1%)!&#?)*!0?/2,)*.)!(?'2,.#1$%4!0/!1)-14,)*%/%$'*!-)1(1/$%!,'*!,)*,Y!G*!-1$*.$-)+!#*)!
$*($./%$'*!)6-0$.$%)!()J1/$%!/#,,$!`%1)!*4.),,/$1)Y!
"'#,!/J'*,!/0'1,+!*'*!,)#0)T)*%!(),!,.P*),!&#$!'*%!0$)#!0/!*#$%!T/$,!(),!scènes%de%
nuitY!U)!-)*,)!2$)*!,t1!/#6!,.P*),!&#$+!W!0?'-41/+!'*%!2),'$*!(?#*)!'2,.#1$%4!@4*41/0)!('*%!
0/!*#$%!&#'%$($)**)!5'#1*$%!0)!T'(P0)!V!$*.)*($),+!4.0$-,),+!5`%),!)%!.414T'*$),!*'.%#1*),+!
-1'5/*),+! ,/.14),! )%! T/#($%),Y! ]0#,! 0/1@)T)*%! )*.'1)!V! ,'#%)11/$*,+! ./J)1*),! )%! 0$)#6!
$*5)1*/#6Y!a*!-)#%!-)*,)1+!-/1!)6)T-0)+!W!0/!5`%)!(#!Zoroastre!()!H/T)/#!&#$!.'TT)*.)!
\#,%)!/#!T'T)*%!'z!0/!*#$%!,?/.7PJ)+!'#!W!0?4.0$-,)!&#)!,#,.$%)!0)!T/@$.$)*!C,T4*'1!(/*,!
DardanusY!p'T)*%,!&#)!0/!%1/@4($)!-/104)!*?$@*'1)!-/,+!T/$,!&#?)00)!-0/.)!(/*,!(),!horsI
scènes!*'*!T'$*,!21$00/*%,Y!a*!-)#%!.$%)1!W!%$%1)!(?)6)T-0)!()!.),!O!7'1,K,.P*)!Q!0)!14.$%!()!
0?)*0PJ)T)*%!()!U#*$)!(/*,!Britannicus%'#!0)!,'*@)!(?AthalieY!
S#1/*%!0)!}jCCC)!,$P.0)+!0)!%748%1)!0'1@*)!()!-0#,!)*!-0#,! ,#1!.)!T'(P0)!,-).%/.#0/$1)!
&#)!0#$!5'#1*$%!0?'-41/Y!I*!)6)T-0)!)6%1`T)T)*%!1$.7)!()!.),!1$.'.7)%,!)*%1)!),%74%$&#)!
-1'-1)T)*%!%748%1/0)!)%!),%74%$&#)!,-).%/.#0/$1)!),%!0/!Sémiramis!()!j'0%/$1)!M!'z!0?/#%)#1!
*)!-)#%!$@*'1)1!&#?$0!,?/551'*%)!W!,'*!1$J/0!A142$00'*!)%!()!-0#,!'z!$0!5/$%!-0/*)1+!-/1!&#)0&#),!
14T$*$,.)*.),!5/.$0),!W!(4.)0)1+!0?'T21)!()!0/!Rodogune!()!A'1*)$00)!)%!.)00)!()!0?Athalie!()!
H/.$*)Y! F)! -'P%)! S),1$/#6+! &#$! (#%! /(/-%)1! )*! :_eg! 0/! -$P.)! ()! j'0%/$1)!-'#1!0?'-41/!
<T#,$&#)! ()! A/%)0>+! ,)! -0/$*%! ()! *)! -'#J'$1! =! -/1J)*$1!V! '*! -)#%! 0)! .'T-1)*(1)+! ./1! 0/!
Sémiramis!()!j'0%/$1)!),%!-1),&#)!(4\W!#*!'-41/:r!i!
H)J)*'*,! W! 0?'-41/Y! F/! *#$%! ('**)! 0)#1! 4.0/%! )%! 0)#1! $*.)1%$%#()! W! .),! T'T)*%,! ()!
,-).%/.0)+!/$*,$!&#)!0)#1!50/T2'$)T)*%!)%!0)#1!4%1/*@)%4Y!G00)!0),!5/$%!21$00)1!(?#*)!0#T$P1)!
J/.$00/*%)!V! 0'1,&#)! O!0)! .$)0! ,?'2,.#1.$%!Q! '*! J'$%! (),! .7',),! &#?'*! *)! J'$%! -/,!
'1($*/$1)T)*%+! T/$,! /#,,$! '*! ,'#-;'**)! &#?$0! -)#%! /11$J)1! (),! .7',),! $*4($%),! '#!
1)('#%/20),Y!F?$*%41`%!(1/T/%$&#)!J$)*%!,)!0'@)1!(/*,!.)%%)!$*.)1%$%#()Y!
Z$!0?'*!,)! -)*.7)! ,#1! 0/! -1'-1$4%4! ,%1$.%)T)*%! ,-).%/.#0/$1)+!)*! 1/--'1%! /J).! .)! &#$!
51/--)!0?~$0+!'*!-)#%!($1)!&#)!0/!*#$%!/!#*)!5'*.%$'*!()!J$,$2$0$%4!V!,/!-14,)*.)!-)1T)%!()!
J'$1!.)!&#$!,/*,!)00)!,)1/$%!$*J$,$20)!'#!1),%)1/$%!%)1*)+!,/*,!4.0/%Y!Z/*,!)00)!'*!*)!J)11/$%!1$)*!
()!.)!&#$!5/$%!0?$*%41`%!()!.)1%/$*),!,.P*),+!-14.$,4T)*%!0),!O!,.P*),!()!*#$%!Q!M!$0!),%!5/.$0)!
()!.'T-1)*(1)!&#?#*!$*.)*($)!),%!-0#,!J$,$20)!,#1!5'*(!(?'2,.#1$%4!&#?)*!-0)$*!\'#1Y!p/$,!
.)%%)! .'*($%$'*! ()! J$,$2$0$%4! *)! ,)! 14(#$%! -/,! W! #*! /,-).%! /*).('%$&#)Y! A/1+! W! =! 2$)*!
14504.7$1+! -'#1! &#)! %'#%)! ,.P*)! ,'$%! J$,$20)+! $0! 5/#%! (?/2'1(! -0'*@)1! 0)! %748%1)! (/*,!
0?'2,.#1$%4Y! G*! &#)0&#)! ,'1%)+! 0?'-41/! %1/7$%! 0)! %748%1)! \#,&#?W! ,'*! .'T20)! )*! )67$2/*%!
$T-#($&#)T)*%!/#!,)$*!T`T)!(#!%748%1)!#*)!.'*($%$'*!()!-',,$2$0$%4!(#!%748%1)!&#$!),%!W!
,/!T/1@)+!W!,/J'$1!le%fond%noir%qui%accueille%l’éclairage%de%fictionY!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:r!AY!B$*%h0)1+!Théâtre%et%opéra%à%l’âge%classique…+!.7/-$%1)!:gY!
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%