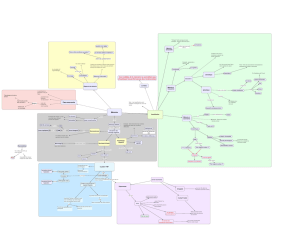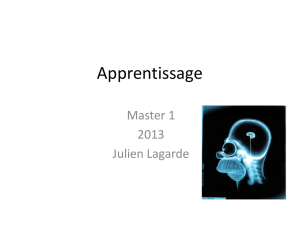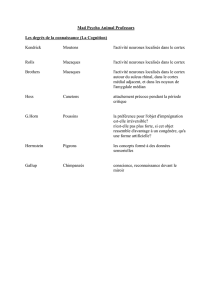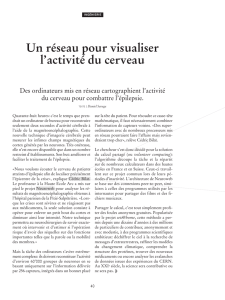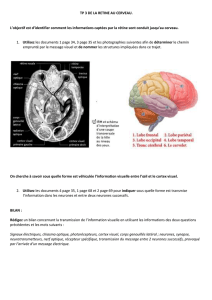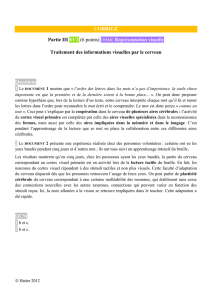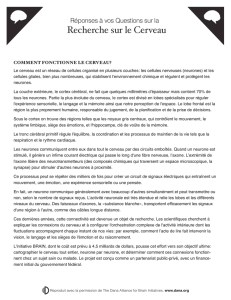XIV° CONGRES AMIK – BORDEAUX 28 et 29 Septembre 2012 Les

XIV° CONGRES AMIK – BORDEAUX
28 et 29 Septembre 2012
Les confèrences
ÉQUILIBRE, DÉSÉQUILIBRE, TOUT EST MÉMOIRE
Christian Chiffoleau, Masseur kinésithérapeute Mézièriste, Bordeaux
Aux 3 M, figures emblématiques de BORDEAUX, Montaigne, Montesquieu, Mauriac,
vient s’inviter Françoise Mézières.
Nous voilà donc aujourd’hui avec nos 4 M !
Déjà au XVI ème siècle Montaigne, à travers ses Essais, faisait référence au lien intime
entre le corps et l’esprit ; pour cela il a largement puisé dans les grands textes de
l’antiquité (Plutarque, Sénèque, Virgile…).
Il consacre 3 volumes à se décrire sans complaisance, « avec ses faiblesses, son
inconstance, sa vanité, son orgueil, il s’achemine vers sa fin, tirant sa force de la
certitude de sa petitesse et de l’acceptation de son destin qui est de vivre :
« Le seul secret de la vie, c’est vivre ! »
« Mon métier, mon art, c’est vivre ! »
« Il faut toujours être botté et prêt à partir ! »
« Nous sommes nés pour agir ! »
En plein XXème siècle le Professeur Henri Laborit énonce :
« La seule raison d’être d’un être c’est d’être, c’est‐à‐dire de maintenir sa structure.
C’est de se maintenir en vie. Sans cela il n’y aurait pas d’être ».
« Un cerveau ça ne sert pas à penser, mais ça sert à agir».
Françoise Mézières est née en 1909 à Hanoï.
Henri Laborit est né en 1914 à Hanoï (médecin chirurgien neurobiologiste innombrables
publications. Il fit ses études à l’école principale du service de santé à Bordeaux)
Montaigne écrivait : « L’interprétation de toute philosophie doit faire une place au corps
du philosophe ».
« Le monde ne s’enseigne pas, mais se pratique dans un apprentissage continu fondé
sur les expériences corporelles ».
Se maintenir en vie, maintenir son équilibre vital, avec quelle certitude d’y arriver,
allons‐nous avancer ?

Si Desproges disait : « je n’ai qu’une certitude c’est que je doute ». Montaigne affirme :
« la vérité n’est plus qu’une forme dont on a extirpé le doute ».
Pour s’éloigner du doute et puisque « nous sommes nés pour agir », cherchons
comment ne pas basculer vers le déséquilibre, comment revenir à l’équilibre en
travaillant sur les apprentissages (mémoires) nécessaires à cette réussite.
Les animaux, donc l’homme qui est un animal, ne peuvent se maintenir en vie qu’en
consommant cette énergie solaire qui a déjà été transformée par les plantes. Ce qui
exige de se déplacer. Ils sont forcés d’agir à l’intérieur d’un espace, ce qui exige un
système nerveux. Et ce système nerveux va agir, va permettre d’agir sur
l’environnement et dans l’environnement. Et toujours pour la même raison : pour
assurer la survie. Si l’action est efficace, il va en résulter une sensation de plaisir. Ainsi,
une pulsion pousse les êtres vivants à maintenir leur équilibre biologique, leur structure
vivante. Et cette pulsion va s’exprimer dans 4 comportements de base :
‐ La consommation : le plus banal, boire, manger, copuler …
‐ La lutte
‐ La fuite
‐ L’inhibition (il faut tenir à tout prix).
Et voilà comment un individu maintenu par « sa réussite » à son état d’équilibre (notion
de plaisir) peut basculer vers le déséquilibre suite à des échecs, des traumatismes divers
et variés… de la vie.
Si H. Laborit dit : « un cerveau ça sert à agir », Montaigne lui crée un lien : « mes
pensées dorment si je les assieds, mon esprit ne va si les jambes ne l’agitent ».
Mais comment sont orientées nos actions ? Essayons de voir à travers quelques
exemples simples ce que peut être le cheminement de certains éléments du vécu :
‐ Un stimulus banal déclenche une réponse automatique, réflexe d’équilibre,
mouvement de la marche, etc…
‐ Le stimulus déclenche une réaction inconsciente : il vient activer une pulsion, cette
réponse élaborée au niveau de l’inconscient, vient influencer la réaction motrice, à
l’insu même du sujet. Ce sont tous les gestes inconscients : mimique, posture, etc…
‐ Le stimulus éveille une signification consciente, mais cette signification, cette
perception, est elle‐même plus ou moins influencée par les pulsions et les interdits
rencontrés au passage au niveau de l’inconscient. La sensation qui vient au niveau
conscient est donc déjà altérée et mêlée d’une certaine charge affective. Le conscient va
rationaliser à la fois cette charge affective (affectivité consciente) et le contenu «
objectif » de la perception. La réponse ainsi élaborée va être soumise à son tour au «
filtre » de l’inconscient, avant d’aboutir à sa réalisation motrice.
Ainsi la « personnalité » du sujet, c’est‐à‐dire la façon dont il a intégré son vécu
intérieur, est‐elle toujours présente dans chacune de ses réactions motrices.

Pour certains d’entre nous la formation Mézières nous avait amené à St Mont dans le
Gers où Françoise Mézières enseignait….après une brève pensée nostalgique au
panneau de St Mont nous poursuivons quelques kms plus loin vers Marciac où a eu lieu
son XXXV éme festival de jazz. La musique n’est‐ elle pas une quête permanente
d’équilibre ? « sans musique, la vie serait une erreur » (Nietzsche).
Cette année JIM avait aussi invité la F.R.C. (fédération pour la recherche sur le cerveau).
Plusieurs rencontres et conférences étaient organisées par un professeur de neuro
psychologie et membre du laboratoire inserm(neuroanatomie fonctionnelle de la
mémoire humaine). Je vous passerai les détails de ces interventions, mais sur
témoignage inscrit grâce aux IRM(f) apparait clairement l’existence d’une
neuroplasticité du cerveau qui montre la possibilité d’adaptations synaptiques
(structurale ou fonctionnelle) en réponse à des stimulis physiologiques (dans le cas
présent même les cerveaux des souris répondent à l’écoute régulière de musique par un
enrichissement de leur connectique).
LES FAITS :
100 milliards de neurones participent au fonctionnement du cerveau et comme nous
venons de le voir, le cerveau possède des capacités d’
évolution et
d’adaptation
extraordinaires, que l’on appelle « plasticité », nos circuits de neurones se fabriquent
beaucoup par l’expérience : 10% des connections entre nos neurones existent à notre
naissance, les 90% restants vont résulter des influences que nous rencontrerons tout au
long de notre vie. Nous avons donc tous des cerveaux différents, cette incroyable
capacité à évoluer persiste tout au long de la vie adulte et fait de chacun de nous un être
unique. L’imagerie médicale nous fait découvrir ces évolutions, chaque cliché étant à lui
seul un tableau.
La perte en neurones serait de 10 à 20% à 90 ans, soit une perte de 10 milliards de
neurones : il n’y a cependant pas de quoi s’alarmer, c’est d’avantage la qualité de la
connexion entre les neurones que leur quantité qui fonde nos capacités cérébrales.
Cela dépend de notre entretien intellectuel et physique sur toute une vie.
« 1kg230, un poids tout juste honorable pour une aussi grosse tête, avec, suite aux
analyses confiées à divers laboratoires américains une conclusion décevante : le cerveau
d’Einstein présente une normalité désespérante ».
Il faut savoir que tous les neurones sont en état de veille permanent, pour eux, il
s’agit même d’une nécessité vitale, puisqu’un neurone non stimulé dégénère « mes
pensées dorment si je les assieds… »
La FRC écrit au sujet de la mémoire : « l’idée générale étant que la trace mnésique est
d’autant plus tenace que le souvenir est répété (mémoire concrète ou abstraite) ».

« L’imagerie cérébrale permet aujourd’hui de suivre en temps réel l’activité du
cerveau. Les chercheurs commencent ainsi à mieux identifier où nous stockons nos
différents souvenirs dans notre tête » et à savoir quel chemin, quelle logique nous allons
suivre !
Le prix Nobel Eric Kandel a montré que l’enregistrement d’une information en mémoire
se faisait grâce à un renforcement de la communication entre neurones au niveau de
leur zone d’échange : les synapses. Nos expériences diverses entrainent la libération de
neurotransmetteurs, de molécules capables de s’auto‐perpétuer : de proteïnes qui
ancrent nos acquis.
Mais nos souvenirs ne sont pas obligatoirement des copies conformes des évènements
vécus, ils sont le fruit d’une reconstruction mentale complexe qui obéit à deux principes
complémentaires :
Celui de la correspondance (il doit refléter au mieux notre expérience de la réalité).
Celui de la cohérence (il doit être en accord avec ce que nous sommes, nos croyances,
nos aspirations.
La prouesse de la mémoire tient donc moins à son exactitude qu’à sa capacité à modifier
nos souvenirs en faisant en sorte qu’ils restent cohérents avec notre identité.
Un vaste réseau cérébral intervient dans la formation et l’évocation des souvenirs. Par
exemple : une zone du cortex est spécialisée dans les objets, une autre dans le contexte,
une troisième lie ses informations entre elles.
Le lobe temporal joue un rôle primordial pour le fonctionnement de la mémoire. Il est
formé à la surface du cortex temporal et en profondeur notamment de 3 structures :
- L’hippocampe,
- le cortex périrhinal,
- le cortex parahippocampique, déterminantes pour l’encodage, la consolidation et
le rappel des souvenirs.
1‐ ENCODAGE :
L’image de la plage avec le parasol est transmise à l’œil vers le cortex visuel primaire où
elle est traitée et codée. Les informations sont ensuite transférées via la voie visuelle
ventrale aux zones de la mémoire. Les éléments de l’image y sont traités séparément :
- Le cortex périrhinal prend en charge la mémorisation des objets (le
parasol).
- Le cortex parahippocampique celle du contexte (la plage).
- L’hippocampe fait ensuite le lien entre les 2 types d’éléments pour former
un seul et même souvenir.

2‐REMEMORATION :
La vue du parasol dans le garage va raviver le souvenir des vacances, l’image du parasol
est d’abord transmise de l’œil au cortex visuel primaire, puis elle est transférée via la
voie visuelle ventrale au cortex périrhinal chargé de la mémorisation des objets. Ce
dernier se connecte alors à l’hippocame qui réactive le souvenir de la plage au niveau du
cortex parahippocampique chargé de la mémoration du contexte.
3‐CONSOLIDATION :
Dans les jours et les mois qui suivent sa formation, le souvenir est consolidé grâce au
renforcement des connexions entre l’hippocampe et les cortex périrhinal et
parahippocampique. L’hippocampe continue à être le liant entre le souvenir de l’objet
et celui du contexte. Mais, avec le temps, le souvenir peut perdre sa vivacité originale et
se transformer en « histoire » plus stable :
« le parasol que j’emporte habituellement en vacances ». Dans ce cas, les connexions
entre l’hippocampe et les cortex périrhinal et parahippocampique s’effacent
progressivement …
« Quand d’un passé ancien rien ne subsiste, l’odeur et la saveur restent encore
longtemps à porter sans fléchir l’édifice immense du souvenir » écrivait Proust avec un
juste pressentiment.
Le parfum d’un être cher saisi en croisant un passant, les souvenirs d’enfance jaillissant
au détour des senteurs d’un jardin. Les odeurs ont un rapport privilégié avec l’émotion
et la mémoire. Et pour cause, l’entrée olfactive dans les narines n’est qu’à 2 neurones
de l’amygdale et 3 neurones de l’hippocampe, des régions essentielles pour les
émotions et la mémoire.
Tous les autres sens passent au moins par le thalamus avant d’atteindre ces structures.
Toute nos expériences rencontrées seront donc encodées, mémorisées, et reliées entre
ces assemblées de neurones répartis à différents endroits dans le cerveau. Ainsi, dans
notre système mnésique les informations isolées se mémorisent moins bien que les
informations associées à des connaissances existantes : plus il y a d’associations entre
nouveauté et ce qui est déjà connu meilleurs est l’apprentissage.
RETENONS QUELQUES PHRASES ET MOTS
‐ La personnalité du sujet, c’est‐à‐dire la façon dont il a intégré son vécu intérieur est
toujours présente dans chacune de ses réactions motrices.
‐ La trace mnésique est d’autant plus tenace que le souvenir est répété.
‐ Les souvenirs ne sont pas obligatoirement des copies conformes des événements
vécus.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%