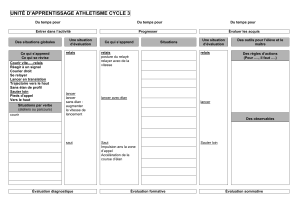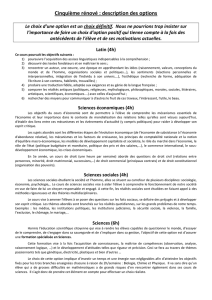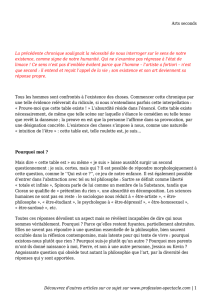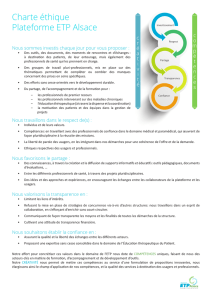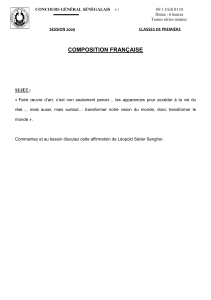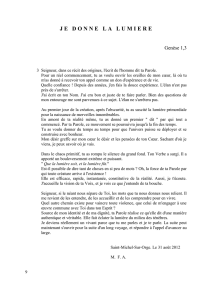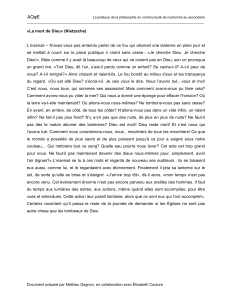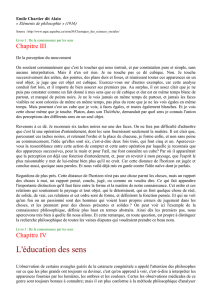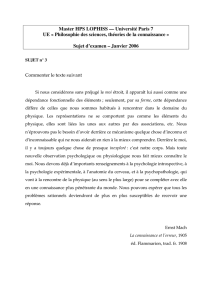Le rôle de l`art

Le rôle de l’art
René Huygue
A travers l’histoire, l’art apparaît protéiforme ; il offre tant de démarches diverses
et même adverses qu’on désespère de trouver une définition qui puisse leur être
commun dénominateur, principe d’une unité. L’art est aussi multiple que la
nature humaine a de visages ; chaque type de tempérament lui apporte ses
ressources et ses dispositions particulières.
Chacun, pourtant, par ses moyens propres, souvent incompatibles et
contradictoires avec ceux des autres, n’effectue-t-il pas une tentative analogue ?
S’il était possible de la dégager des applications si variées que les tempéraments
différents lui imposent, s’il était possible de la définir dans son unité, ne nous
livrerait-elle pas l’ultime raison d’être de cette activité humaine qu’est l’art ?
DISPARITE DU MOI ET DE L’UNIVERS.
Cette raison d’être est primordiale, car elle touche au problème de notre existence
et de son équilibre ; elle s’essaie à le résoudre. Elle se situe au cœur de la dualité
fondamentale, au sein de laquelle notre destinée s’établit, celle qui sépare la vie
intérieure et la vie extérieure : celle qui distingue la vie ressentie, éprouvée
directement en nous-mêmes, de la vie qui nous atteint par l’intermédiaire de nos
sens et dont nous ne percevons que le contre-coup.
D’une part, nous sommes nous-mêmes, ce substrat constant de ce que nous
éprouvons, par quoi se créent l’unité, l’autonomie et la permanence de notre
« moi » ; mais, d’autre part, nous sommes aussi l’écho d’autre chose qui se
manifeste en nous, mais qui n’est pas nous : tout ce que, depuis la philosophie
allemande du XIXème siècle, à la suite de Fichte, on peut englober dans le terme
de « non-moi », l’univers où nous sommes jetés, dans lequel et avec lequel nous
existons nécessairement et qui pourtant nous est étranger et extérieur.
Il est pour nous la grande énigme et la grande menace : nous ne pouvons
subsister, durer, que si nous nous accommodons à lui, d’où nous viennent toutes
ressources et tous périls. Il nous faut donc à la fois le connaître, c’est-à-dire en
avoir une représentation efficace, à travers les sensations que nous en recevons,
et agir sur lui. Même si, dans la pratique, nous parvenons à une co-existence qui
assure notre préservation, il reste l’irritante disparité du subjectif, que nous
ressentons, et de l’objectif, que nous concevons, dont nous nous faisons une idée
approximative, empirique, et sans cesse corrigée.
Peu à peu, par l’accoutumance, un rapport de cohabitation s’établit entre nous et
le monde extérieur ; mais que nous arrêtions un instant de nous laisser entraîner
par notre course et son étourdissement, que nous nous reprenions, et nous
sentons alors (c’est bien la souffrance profonde de l’homme) qu’il y a une
coïncidence de fait entre notre monde intérieur et ce monde extérieur, mais
aucune commune mesure. Nous nous déployons dans le temps, et lui se déploie
dans l’espace.
Deux univers incommunicables, impénétrables ne s’accouplent que par des points
de choc et d’interaction. L’un est esprit, l’autre est matière. Sans cesse l’humanité
remâche cette antinomie, dont le christianisme a surtout fait celle de l’âme et du
corps. Peut-être est-ce la soif essentielle de notre condition que de vouloir cesser

d’être un objet étranger, projeté comme le plomb du chasseur dans la chair du
monde et forcé de s’y incruster sans jamais pouvoir vraiment s’unir à lui. Nous
rêvons d’un lien plus sûr que cet accident qui nous force à ne pouvoir exister que
dans un milieu absolument autre que nous-mêmes.
Toute la pensée s’est dressée dans un effort millénaire pour percer, par la
connaissance, cette cloison opaque, pour arriver à comprendre le monde et à
trouver une fraternité avec lui, un principe de fraternité. La philosophie s’y est
acharnée : mais elle n’a guère abouti qu’à se faire une représentation de l’univers
plus prétentieuse que l’usuelle, constituée empiriquement par l’expérience de nos
sens ; une représentation qui, elle, prétend à l’absolu et qui, en des bonds
successifs contre la muraille ne cesse de retomber.
Quand bien même il serait possible de se figurer exactement cet univers, cette
« réalité » où nous sommes introduits, cela romprait-il la fondamentale antinomie
de notre nature et de la sienne ? Cela comblerait-il le fossé que nous ne pouvons
franchir ? Seules les religions ont tenté de révéler une communauté dont nous
sommes avides, dès que nous cessons de nous contenter d’une existence de fait,
acceptée animalement. Aussi ont-elles voulu que les dieux rappellent notre
image, comme en Grèce, ou que nous soyons créés à celle de Dieu, comme dans
notre civilisation chrétienne. De la sorte, par delà le monde physique, ce serait
son principe même, son créateur, qui rétablirait l’union profonde et qui nous
affranchirait de la séparation de ce qui est « autre ».
Pourtant, le christianisme le reconnaît encore plus autre, tellement
incommensurablement autre qu’il reste inconnaissable, inaccessible, à la
différence des habitants de l’Olympe grec. Il ne peut se rejoindre que par un
mystérieux lien d’amour lancé à travers un écart infini. Ainsi un élan de foi et
une présence consolent-ils d’une impénétrabilité qui subsiste toujours. L’Inde,
même pense que ce divin ne peut se rejoindre qu’au prix d’une abolition, d’un
anéantissement de nous-mêmes.
L’ART RELIE LES MONDES INTERIEUR ET EXTERIEUR
A ces assauts divers que religion, philosophie, ou science ont lancés contre ce mur
de l’infranchissable s’en ajoute un auquel l’homme a eu aussi recours en tous les
temps : et c’est l’art. Or, lui, et lui seul, est capable de susciter un intermédiaire,
un passage entre le monde intérieur et le monde extérieur et voilà pourquoi il est
indispensable et irremplaçable. Lui seul nous le propose non pas au prix d’un
renoncement mais grâce à une affirmation, au contraire, de ce que nous sommes.
Cette dualité que conçoit l’homme et qui le heurte, l’œuvre d’art l’apporte, la
réunit en elle, mettant en évidence sans cesse son caractère double, mixte, qui
fait d’elle un trait d’union entre ces deux réalités. Trait d’union polyvalent,
d’ailleurs : il n’agit pas seulement entre le moi et l’univers en créant cette image
où ils s’expriment conjointement, indissolublement, ce que constatait déjà le vieil
adage : homo additus naturae ; il’agit aussi entre l’artiste et les autres, puisqu’il
lui permet de se communiquer à eux, puisqu’il leur permet de le ressentir, de
l’éprouver comme une part d’eux-mêmes.
Là est le miracle de l’œuvre d’art, auquel on ne prête pas assez attention et qui
pourtant l’explique bien plus fondamentalement que toutes les esthétiques du
plaisir, du jeu ou du beau idéal, en même temps qu’il les englobe et les justifie à

leur tour comme le développement excessif et devenu systématique de vérités
fragmentaires.
L’œuvre d’art, pour une part, est image-symbole, expressive d’une réalité
psychique ; et comme le mot ici atteint à la plénitude de son sens : symbole, de
σύμβολον, jeter ensemble, réunir ! Le σύμβολον était un objet unique, rompu en
deux parties dont la réunion permettait d’identifier les porteurs. L’œuvre d’art
est bien le lien joignant ces deux éléments que l’on croyait inconciliables et qui s’y
reconnaissent tronçons d’une communauté.
Elle montre, croit-on souvent, les aspects de la réalité matérielle, mais, si réaliste
que se croie le peintre, nous le savons, c’est lui, c’est son caractère, son essence
même qu’il révèle, qu’il avoue, par la manière dont il aborde et choisit, dont il
transcrit cette réalité. Si, par une démarche inverse, il œuvre avec l’intention de
s’exprimer, de se traduire aux autres, lui inconnaissable pourtant à qui n’est pas
lui-même, il lui faudra aller chercher dans des apparences empruntées à l’univers
visible ou dérivées de lui, les éléments du langage dont il a besoin.
Ainsi l’artiste ne peut viser le monde extérieur, sans entraîner avec lui la
révélation du monde intérieur ; il ne peut davantage aspirer à montrer le monde
intérieur sans passer par le truchement du monde extérieur. Pour la première
fois, l’un et l’autre ne vivent plus que l’un par l’autre, ne se conçoivent plus que
l’un à travers l’autre et créent entre eux une tierce réalité, consubstantielle à l’un
comme à l’autre.
Voici le lien trouvé, l’arche jetée qui s’élance par-dessus le grand vide dont
l’homme et l’univers occupaient, face à face, chacun un bord. Une transition est
enfin découverte et cette transition n’est pas contact fugitif, étincelle
momentanée. Elle est plus durable que cela même qu’elle lie : depuis longtemps
celui qui s’y est traduit comme les apparences qui s’y sont reflétées auront changé
ou disparu, qu’elle subsistera dans sa matière durable avec un visage permanent.
Un troisième « ordre » naît : un ordre qui est à la fois fonction de ce qui est à nous
et de ce qui est hors de nous, qui existe par tous deux et qui, tel l’enfant engendré
par une union, ne laisse plus distinguer, dans sa substance unique, ce qui à
l’origine appartenait à chacun. Car l’œuvre est un fruit ; elle n’existe que
détachée de l’acte créateur, indépendante, abordant une vie qui n’est plus que la
sienne propre. En elle cessent de se distinguer le moi et le non-moi.
C’est bien pourquoi tant d’écrivains ont été tentés de rapprocher la création
artistique de l’amour et de son effort pour rejoindre ce qui par nature est
pourtant distinct, afin de le faire sien en même temps que l’on se donne à lui.
Mais l’amour, humain ou divin, n’est qu’un élan et non un résultat.
Que cet élan apporte ses forces presque surnaturelles à la création artistique, on
n’en saura douter ; qu’il se retrouve dans celui qui porte le spectateur vers
l’œuvre d’art et sa richesse incluse, cela est manifeste.
Mais s’il en vit, l’art va plus loin que cette tendance irrésistible et désespérée à la
fois, qui, comme l’étincelle entre les pôles, jaillira peut-être de sa surtension pour
ne rompre qu’un instant les ténèbres qu’elle a franchies. L’œuvre d’art, elle, s’y
installe ; elle y existe ; elle y fait éclore une lumière durable ; elle ne franchit pas
seulement la nuit, comme le peut l’amour ; elle la dissipe.
Car, enfin, telle est l’œuvre d’art : elle est chose ; elle est objet ; elle s’implante
dans le monde physique et s’y installe ; elle en porte les caractères ; espace,
matière, forme, apparences perceptibles pour les sens ; mais en même temps, elle

n’existe que parce qu’elle est soumise à une échelle de valeurs humaines. En elle,
réalités matérielles et réalités spirituelles ne sauraient se distinguer, non plus
que fond et forme. On ne peut appréhender l’une sans appréhender, du même
coup, l’autre. Ainsi, en chimie, de deux corps distincts, si on les réunit, se
constitue soudain un troisième, où l’analyse retrouvera sans doute les traces des
constituants ; néanmoins il subsiste désormais avec ses propriétés particulières,
sa réalité incontestable. L’œuvre d’art, elle aussi, permet à l’observateur de
remonter à ses deux sources, références offertes à la curiosité ; mais que lui
importe, à elle, complète en soi, se suffisant à elle-même, existant par elle-même
et par elle seule désormais ?
1
/
4
100%