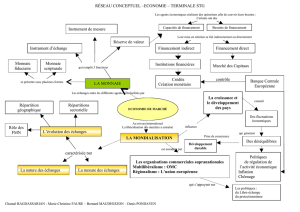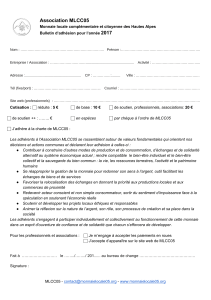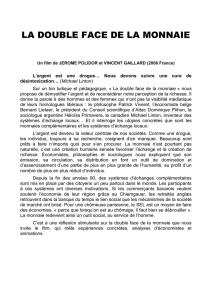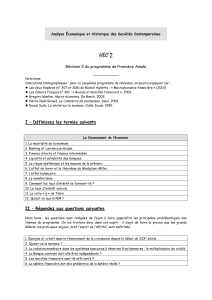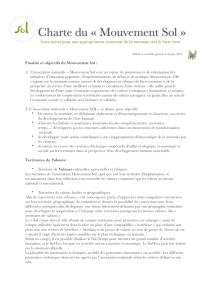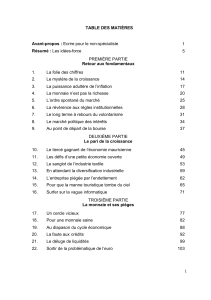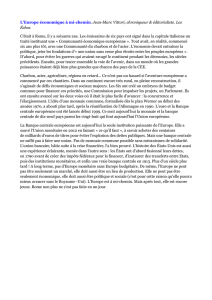Intervention de Marc Le Ny, professeur agrégé de philosophie

Marc Le Ny ― Conférence « Qu’est-ce que l’argent ? » ― Jeudi 7 juin 2012 ― page 1 / 8
Introduction : étonnement et embarras face à l’argent
Nous avons perdus la capacité de s’étonner à l’égard de l’argent en raison de la familiarité habituelle qui est
devenue la nôtre. En faisant un pas de recul historique pour apercevoir d’un peu plus loin notre vie
contemporaine, nous saisissons par contraste cette omniprésence de l’argent : la bancarisation, la monétarisation
de la vie quotidienne, l’introduction dans les sphères familiales et intimes. Dans un passé pas si éloigné, nous
n’échangions avec de l’argent que le superflu de ce qui était produit dans le cadre d’une économie rurale en
grande partie autarcique. Dorénavant, l’argent est l’objet d’une expérience quotidienne et un fait social majeur.
On commence sa journée par gratter, cocher, miser une somme dérisoire pour gagner la supercagnotte de
millions d’euros, on achète un café au comptoir, un journal, un titre de transport, on travaille pour gagner sa vie
puis on achète son repas, des vêtements, des cadeaux, des livres, etc. Nous avons, sans nous en rendre clairement
compte, acquis des compétences de gestionnaire et de banquier : on calcule des intérêts, des agios, on investit des
profits, on place notre épargne, etc. Nous jonglons entre notre compte courant et notre crédit revolving. Nous
sommes tenus au courant des évolutions journalières des grandes bourses mondiales. Avec la crise des
“subprimes” de 2007 puis celle des dettes souveraines européennes, nous avons même acquis des compétences
macro-économiques. Cependant, cette quotidienneté de notre rapport à l’argent ne nous assure pas que nous
sachions immédiatement répondre à la question de savoir ce qu’est l’argent. Et, de fait, la question « qu’est-ce
que l’argent ? » semble d’emblée embarrassante.
Nous avons l’habitude de nous adresser aux philosophes pour nous débarrasser des questions
embarrassantes. Mais, cette fois-ci, le philosophe est lui-même embarrassé car il est, par rapport à cet objet de
réflexion qu’est l’argent, dans une position inconfortable. Il n’y a pas de philosophie de l’argent et si l’on
parcourait l’histoire de la pensée occidentale, l’argent ne figurerait pas comme l’un de ses objets privilégiés.
Sans doute, pour expliquer cela, il faut rappeler que la philosophie, de sa naissance dans l’Antiquité jusqu’aux
temps modernes, a privilégié la vie théorique à la vie active, la vita contemplativa à la vita activa. Or, l’argent
appartient indéniablement au domaine des choses pratiques et quotidiennes, et même, parmi ces affaires, aux
choses les plus basses et les plus prosaïques : le négoce, le commerce, le profit. On échange des pièces sales et
des billets froissés pour ses courses, on comptabilise nos notes de blanchisserie : il n’y a rien de très
philosophique là dedans. Comme le dit Pierre Zaoui dans le Dictionnaire politique à l’usage des gouvernés,
pourquoi une philosophie de l’argent ? et pourquoi pas une philosophie du tournevis ? Nous pouvons même être
plus radicalement sceptique, et nous s’interroger sur la possibilité d’une telle philosophie ? Une philosophie de
l’argent est-elle possible ? L’argent est-il un objet que l’on peut isoler de la réflexion sur la société et l’État ?
Cela a-t-il un sens de considérer l’argent comme une réalité autonome ? Bref, le philosophe ne semble donc ni
compétent ni intéressé par l’argent.
Pour savoir ce qu’est l’argent, ou au moins pour en savoir un peu plus à propos de l’argent, il faudrait donc
se tourner vers un spécialiste de cette question. Quel est le ou les spécialistes de l’argent ? Qui est réellement
intéressé et savant à propos de l’argent ? Le sociologue, l’historien, l’économiste ? La question mérite d’être
posée, car l’argent est également absent des sciences humaines. Il n’est pas un objet d’étude canonique. Les
spécialistes de l’argent seraient-ils ailleurs : les numismates, qui collectionnent les monnaies anciennes ou
contemporaines ? Les banquiers, les traders, les psychanalystes ?
D’un autre côté, l’argent occupe une place essentielle dans la littérature. De Shylock à Harpagon, par
exemple, les figures sont nombreuses. Si l’argent n’est pas un objet traditionnel pour la pensée philosophique
comme pour les sciences humaines, il est néanmoins, comme l’atteste sa présence en littérature ou au théâtre,
l’objet d’une expérience humaine. Il faut donc enraciner notre réflexion dans cette expérience, essayer de
remonter jusqu’à la réalité phénoménale de l’argent.
1. De la dénonciation religieuse à la société de consommation
La réalité phénoménale de l’argent est aujourd’hui très abstraite : la généralisation de la monnaie
scripturale qui accompagne la bancarisation a largement dématérialisé l’argent contemporain. Avant l’invention
des pièces métalliques, au VI
e
siècle av. J.-C. en Grèce, des objets de toute sorte ont servi de monnaie : le blé, le
bétail, les coquillages cauris (dans les années quarante, les cigarettes ont servi de moyen d’échange dans
certaines régions de l’Allemagne). Puis l’argent sous la forme de pièces d’or ou d’argent est apparu. On les
surnomme « les chouettes de Minerve » parce qu’une de leur face représente cet oiseau. Minerve est le nom
Conférence « Qu’est-ce que l’argent ? » ― Jeudi 7 juin 2012, 9h.
Invité par l’ANDML (Association Nationales des Directeurs des Missions Locales), dans le cadre des
journées professionnelles de formation des 7 et 8 juin 2012 à la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Strasbourg intitulées : « Le rapport à l’argent : éthique, tabous, pratiques ».

Marc Le Ny ― Conférence « Qu’est-ce que l’argent ? » ― Jeudi 7 juin 2012 ― page 2 / 8
romain d’Athéna. Les Romains adorèrent également Junon Moneta, une déesse dont le nom rappelle que Junon
avait « averti » (monere en latin) les Romains de l’imminence d’un tremblement de terre. « Moneta » donnera
par la suite, en français, « monnaie », et « money » en anglais. Comme toutes les choses essentielles, l’argent
renvoie à un lexique étendu, particulièrement riche dans la langue familière ou argotique : la thune, le flouze, le
blé, le fric, le pèze, etc. La langue française a néanmoins une originalité par rapport à d’autres langues, comme
l’anglais, de continuer à nommer argent la monnaie. Le terme « argent » désigne donc indistinctement le métal
précieux et la monnaie. Elle garde ainsi la trace du caractère brillant, éblouissant, fascinant des pièces
métalliques. L’éclat de l’argent, qu’on extrayait des mines pour en faire des pièces de monnaie, vient de la pureté
de sa blancheur. Elle est fascinante pour l’œil qui s’absorbe dans la contemplation des pièces neuves, luisantes,
éclatantes. Cette fascination trouvait aussi sa source dans sa rareté et dans son inaltérabilité. Cette fascination
pour l’argent et la richesse est la source d’une ambivalence fondamentale par rapport à l’argent qui semble doté
d’un pouvoir mystérieux et dévastateur.
La monnaie est l’objet d’une condamnation religieuse. Il n’y a pas d’argent dans le Jardin d’Eden. Certes,
la richesse est également considérée comme un signe de bénédiction divine dans l’Ancien Testament. Job était
une personne riche (il possédait des milliers de brebis, de chevaux, de bœufs, etc., et Yahvé lui rend sa fortune au
double = la richesse peut aller avec la vertu). Le Coran et la Sunna ne manifestent pas d’hostilité de principe
envers l’argent ou l’activité commerciale. Mais le ribâ ou prêt à intérêt fait l’objet d’une condamnation
récurrente. La thésaurisation et l’enrichissement dû au seul fait de prêter de l’argent sont interdits. Dans la
tradition rabbinique, l’argent c’est Mammon. Mammon ou Mamon est un terme araméen qui signifie la richesse,
ce qui assure une sécurité matérielle. Mamon, c’est le diable (mammonisme) : « heureux le riche qui ne court pas
après Mammon » (Écclésiaste, 31,8) ; « Nul ne peut servir deux maîtres : Dieu et Mammon » (Matthieu 16, 24).
Dans le Nouveau Testament, les riches sont systématiquement dénoncés. Cette condamnation radicale se
retrouve en particulier dans les Evangiles de Matthieu et de Luc : Jésus dit qu’il sera plus difficile aux riches
d’entre dans le Royaume des Cieux qu’à un « chameau de passer par le trou d’une aiguille » (Marc 10, 25) ;
parabole du mauvais riche condamné pour avoir laissé dans le dénuement le pauvre Lazare (parabole de Lazare
et du mauvais riche rapportée par Luc 16, 19-31 : Lazare, pauvre mendiant couvert d’ulcères qu’un chien venait
lécher (chien = animal répugnant) ; ce pauvre parmi les pauvres vivait devant la maison d’un riche qui festoyait
chaque jour et ignorait le malheureux ; puis dans l’autre monde, Dieu aide Lazare et l’accueille dans le lieu de
repos des justes, et condamne le riche qui, lui, reste dans l’Hadès dans les tourments parmi les réprouvés). Les
ordres franciscains et dominicains du XII
e
siècle valorisent la pauvreté et prône le dénuement absolu. La
pauvreté est célébrée en raison de l’espace qu’elle ouvre à une âme libérée du désir d’acquérir et rendue
disponible à la spiritualité.
Le christianisme met en place les figures du marchand qui s’enrichit aux dépends d’autrui et de l’usurier
qui vole le temps à Dieu pour en faire un profit. L’historien Jacques Le Goff a éclairci le reproche essentiel de
l’Église médiévale par rapport au marchand. Le commerce transforme le temps en occasion de gain : soit que le
prêteur tire profit de l’attente du remboursement par l’emprunteur provisoirement démuni, soit que, exploitant
l’occasion d’une conjoncture, il joue sur les différences de prix entre les marchés, soit qu’il stocke en prévision
d’une famine, soit qu’il fasse payer le risque encouru sur les routes par ses marchandises, bref, de toutes les
façons : « le marchand fonde son activité sur des hypothèses dont le temps est la trame même ». Or, le temps
n’appartient qu’à Dieu.
Cette condamnation religieuse se prolonge, sous une forme laïcisée ou sécularisée d’une condamnation
morale. L’argent et la richesse sont l’objet d’un ressentiment violent : il faut égorger l’usurier juif (le Shylock de
Shakespeare, le Gobseck de Balzac), le boucher enrichi et odieux (Pabst), le moine gras, l’escroc, le trader, les
requins de la finance qui bâtissent des fortunes en payant des salaires de misère à des travailleurs, les adeptes de
l’argent-roi, les forces de l’argent, l’argent qui est la cause d’inégalités, de déséquilibres, de pauvreté.
La condamnation morale pointe les vices, les pathologies liées à l’usage de l’argent, où l’argent est
considéré comme cause de ces pathologies (on parlait de passions dans le vocabulaire classique). La
condamnation morale de l’argent se manifeste dans un grand nombre de proverbes et d’adages populaires,
comme, par exemples : l’amour de l’argent est la racine de tous les maux
1
, l’homme avare manque autant de ce
qu’il possède que de ce qu’il n’a pas, plus moderne : l’argent ne fait pas le bonheur, etc.
1
Renzo Tosi, Dictionnaire des sentences latines et grecques, Paris, Editions Jérôme Million, 2010, chapitre 16
L’argent et les biens, p. 1299-1347. En réalité les sentences antiques et romaines, c'est-à-dire avant le Moyen
Âge chrétien, sont ambivalentes eu égard à la valeur de l’argent. La condamnation de l’avarice et de la richesse,
côtoie la critique de la pauvreté (Pauper ubique iacet, Le pauvre est écrasé partout, aucun fardeau n’est plus
lourd à porter que la misère, lorsque l’argent fait défaut, tout fait défaut ; une bourse pleine de toiles d’araignée
(Catulle = l’état de pauvreté)). De nombreux proverbes sont des conseils pour gérer sa fortune. On remarquera
une pointe de contradiction dans l’argument qui consiste à condamner l’avarice au nom de la justice distributive.

Marc Le Ny ― Conférence « Qu’est-ce que l’argent ? » ― Jeudi 7 juin 2012 ― page 3 / 8
En premier lieu, une pratique financière : le prêt à intérêt est critiqué. Aristote considérait que l’argent
devait servir à échanger des marchandises pour la satisfaction des besoins des membres de la société, et il
dénonçait, sous le nom de chrématistique, la tendance de l’argent à devenir une fin en soi. L’accumulation de
l’argent est donc une activité contre nature et la fortune issue des échanges mercantiles est l’objet d’un soupçon.
Il faut distinguer la vraie richesse, qui est celle de celui qui possède des biens pouvant satisfaire des besoins, et la
fortune, qui ne consiste qu’en argent. De tous les travailleurs, le commerçant est le métier le plus infâmant et le
prêt à intérêt la pratique la plus détestable. Le mot même d’usure, en français, conserve trace de cette
condamnation puisqu’il signifie l’intérêt abusif d’un prêt d’argent, et que usuraire ou usurairement sont
connotés péjorativement.
En second lieu, un personnage : la figure de l’avare (avaritia, cupiditas) concentre le rejet moral de
l’argent. Harpagon est un usurier âpre au gain, virtuose dans les calculs financiers. L’avarice est un vice : la
passion dévorante de la faim d’or, l’appât du lucre. Ici aussi, la condamnation morale trouve sa source historique
dans la condamnation religieuse : « Qui aime l’argent n’est jamais rassasié d’argent » (Écclésiaste 5,9). Elle
acquiert le rang de vice capital durant le Moyen Âge. De nombreuses figures d’avares hantent l’Enfer de Dante.
C’est le caractère insatiable du désir immodéré d’accumuler et de garder pour soi l’argent qui est visé. L’avare
pingre, radin, excessivement attaché aux richesses, qui resquille, ment, cache, caresse son argent ; le contact
physique, sensuel des liasses de billets, de l’argent frais, des espèces sonnantes et trébuchantes comme le
personnage de Don Salluste interprété par Louis de Funès dans La Folie des grandeurs ; faire des économies de
bouts de chandelles ; représentation iconographique : une vieille femme maigre, livide et malade qui remplit une
corne d’abondance et tient fermement une bourse remplie de pièces ; perversion de l’instinct de conservation,
hypertrophie de la tendance à l’épargne. L’avarice est condamnée comme passion excessive. C’est, pour
Aristote, la pléonexie, la volonté d’acquérir toujours plus. L’avarice renvoie en fait à deux éléments : l’incapacité
à dépenser et le désir insatiable de posséder de l’argent. L’avarice s’oppose à la libéralité, à la générosité (et non
à la prodigalité, autre vice). En psychanalyse, l’avarice est pensée comme une perversion psychique. L’avare est
un sadique-anal, qui jouit de faire souffrir l’autre et de retenir son argent comme on retenait autrefois ses fèces,
ou un névrosé obsessionnel souffrant d’une dette inconsciente inextinguible à l’endroit du père.
Le problème fondamental de l’avarice (ou de son contraire, la prodigalité) consiste dans une confusion à
propos de la valeur. L’avare confond la valeur véritable des choses et la valeur économique, c’est-à-dire son
prix. Amasser des richesses et ne pas les dépenser est une façon de vivre dont l’avare jouit absolument mais qui
fige la vie, lui nuit radicalement, parce qu’il n’articule pas ou ne relie plus la valeur économique de l’argent à
celles des choses de la vie. La possession avare devient morbide et mortifère.
2. L’argent comme équivalent universel
La double condamnation religieuse et morale contient une intuition concernant l’essence de l’argent.
Derrière la réalité matérielle de l’argent, il y a la réalité économique de la monnaie et le problème des échanges
des marchandises entre les agents économiques qui constituent un marché.
Marx exprime cette intuition, au début de son œuvre, dans les Manuscrits de 1844, sous une forme qui
mélange à la fois la condamnation morale et l’analyse économique. Il s’inspire de Timon d’Athènes de
Shakespeare pour qualifier l’argent de « divinité visible » et de « courtisane universelle » : « l’or est un dieu
sensible qui unit les contraires et les force au baiser » (Timon d’Athènes, IV,3). L’argent est pensé comme une
perversion de toute valeur et de toute chose, comme une prostitution universelle. Derrière ce vocabulaire de la
dépravation de l’humanité par l’argent, Marx formule néanmoins une analyse plus économique et plus
objective : « L’argent, dit-il, du fait qu’il possède la qualité de tout acheter et de s’approprier tous les objets, est
l’objet dont la possession est la plus éminente de toutes. L’universalité de sa qualité est la toute-puissance de son
essence ». Le capitalisme est l’époque de la « vénalité universelle ». L’argent, dit-il ailleurs, est « un vampire qui
se lève la nuit pour sucer le sang du travail vivant ».
Il reviendra à son grand œuvre de 1867, Le Capital, de formuler avec des concepts plus rigoureux cette
intuition qui n’est pas encore extraite de sa gangue morale. La monnaie prend place dans la réalité de l’échange
économique. Un échange est le moyen qui consiste à acquérir la propriété d’une marchandise en cédant ma
propriété sur la quantité d’argent correspondante. Le problème qui se pose est celui de l’équivalence de ce qui est
échangé. Or les marchandises ont de l’intérêt en raison des qualités qui leur sont inhérentes. Ce sont ces qualités
qui permettent de satisfaire des besoins et des désirs. C’est pour ce que les choses sont réellement que j’ai intérêt
à les posséder afin d’en jouir. Cependant, les qualités des différentes marchandises sont à proprement parler
incommensurables c'est-à-dire qu’elles n’ont pas de mesure commune. La qualité de la laine d’un pull ne peut en
en aucun cas être comparée à une autre qualité. Cette qualité fonde la valeur d’usage d’une marchandise et
En effet, l’avare est une source de malheurs pour les autres qui sont privés de ses richesses. En effet, cet
argument reconnaît implicitement une valeur positive à l’argent.

Marc Le Ny ― Conférence « Qu’est-ce que l’argent ? » ― Jeudi 7 juin 2012 ― page 4 / 8
permet à Marx de poser le problème de l’échange économique ainsi : comment mesurer des valeurs d’usages par
définition incommensurables ? Ce problème est à la fois celui de la possibilité de l’échange et de la justice de
l’échange. La solution consiste à ramener les qualités des différentes marchandises à un dénominateur commun.
Celui-ci ne peut être une qualité : il s’agira donc d’une quantité. Il faut donc exprimer quantitativement la valeur
d’usage des marchandises, et c’est ce que Marx appelle la valeur marchande ou la valeur d’échange, à savoir,
sous sa forme concrète : le prix attribué à une marchandise.
Maintenant, nous pouvons nous tourner plus directement sur l’argent comme monnaie. Par définition
l’argent est une réalité paradoxale. C’est une chose qui, à la différence de toutes les autres choses du monde, ne
vaut pas par elle-même pour le besoin ou le désir qu’elle pourrait satisfaire, comme une pomme la faim ou un
verre d’eau la soif, mais qui vaut parce qu’en la cédant je puis acquérir n’importe quelle autre marchandise.
C’est alors qu’on comprend clairement le caractère universel de l’argent. Quand, en 1844, Marx parle, dans une
langue encore morale, de vénalité universelle ou de prostitution universelle, il nomme la monnaie, dans Le
Capital, d’équivalent universel. L’argent ne vaut en lui-même rien, en ce sens qu’il n’a aucune valeur d’usage,
ce qu’illustre traditionnellement la légende du roi Midas. Roi de Phrygie, Midas rendit service à Bacchus, le dieu
du vin, qui, en retour, lui accorda un souhait. Midas demanda que tout ce qu’il touchait se changeât en or. Son
souhait fut exaucé au-delà de ses espérances : même sa nourriture et son vin se transformèrent en or lorsqu’il
voulut boire et manger. Et quand il prit sa fille dans ses bras pour qu’elle le réconforte, elle se transforme en
statue d’or. Midas supplia alors Bacchus d’annuler son souhait. Le dieu accepta et ordonna à Midas d’aller se
laver dans le fleuve Pactole. Cette légende antique est une énième illustration de la condamnation morale de
l’argent, en ce sens qu’une trop grande richesse peut paradoxalement avoir un prix exorbitant et ruiner une vie,
mais elle contient implicitement l’intuition que la possession d’une grande fortune permet de satisfaire aucun
besoin ni aucun désir si il est impossible d’échanger l’argent contre des choses réelles. L’argent ne vaut rien en
lui-même mais en même temps il a une valeur marchande universelle puisqu’il « représente » potentiellement
toutes les marchandises. L’argent a donc une valeur paradoxale qui est à la fois nulle et universelle. L’argent
n’est pas un bien, et il est l’équivalent de tous.
La dénonciation de la société de consommation contemporaine réactive la critique du mammonisme. La
sociologie a produit un ensemble d’études sur la question dont, par exemple, et pour mémoire, La Société de
consommation de Jean Baudrillard (1974). Par société de consommation on entend l’accroissement prodigieux, à
partir du milieu du XX
e
siècle, de la consommation de biens et de services qui sont multipliés en nombre
impressionnant. Ainsi, la consommation « normal », « simple », « authentique », celle « d’avant », ne servait
qu’à satisfaire des besoins réels, alors que dorénavant, pris dans le tourbillon des publicités et des hypermarchés
où sur des centaines de mètres se déverse des marchandises de toute nature, la consommation serait devenue
irrationnelle, artificielle, futile. La critique du consumérisme est ainsi la forme contemporaine de la dénonciation
de l’argent et de son pouvoir ambivalent. La consommation serait ainsi une nouvelle pathologie de l’argent, aux
côtés des figures classiques de l’avare ou du prodigue. En affirmant que la consommation nous fait confondre
l’être et l’avoir, la critique de la consommation suit, en fait, la même interprétation. Puisque tout peut être acheté,
plus rien ne vaut. Les choses ne valent plus pour ce qu’elles sont en elles-mêmes, mais elles ne sont plus que des
marchandises. La valeur d’une marchandise est toujours relative et jamais absolue. C’est bien pour cette raison
que, à la lettre de l’expression, il n’y a pas de juste prix ou de prix juste, et qu’en ce sens l’économie n’a rien à
voir avec la justice en ce sens que la valeur économique d’un bien n’est pas rationnellement fondé. Il n’y a de
fondement absolu à la valeur marchande. Cette marchandisation de toutes choses (déjà repérée par Simmel en
1900 : « l’ensemble des objets que l’on peut acquérir avec de l’argent s’étend de plus en plus, les choses se
soumettent avec de moins en moins de résistance au pouvoir de l’argent, il est lui-même de plus en plus
dépourvu de qualités propres, ce qui précisément lui confère la même puissance par rapport à toutes les qualités
des choses »). La société de consommation s’accompagne ainsi d’un cynisme et d’une déréalisation (d’une
aliénation). La monétarisation de toutes choses : la sexualité (la prostitution, le commerce sexuel), la santé et le
corps (trafic d’organes humains vivants), les tâches autrefois accomplies dans le cadre familial, le soin aux
personnes, les loisirs, les sports, etc.). La monétarisation de toutes choses signifierait en fait leur
démonétarisation, leur perte de valeur. Depuis que tout a un prix, plus rien ne vaut.
Cette dénonciation de l’argent qui corrompt se décline sous de multiples figures : le XX
e
siècle a
inventé la figure du milliardaire qui baigne dans un luxe démesuré, les people et les stars du sport qui gagnent
des salaires incroyables ; l’argent sale, l’argent de la spéculation, l’argent de la drogue, l’argent de la corruption,
l’argent qu’il faut blanchir ; l’argent qui salit, qui corrompt, qui pervertit, qui rend fou, qui désespère.
3. L’argent comme monnaie : la conception fonctionnaliste
Les analyses de Marx font signe vers une compréhension de la réalité monétaire apaisée, moralement
neutre. Il revient à la science économique de proposer une telle théorie objective de l’argent. Comprendre
objectivement l’argent c’est ne voir en lui que sa fonction économique de monnaie, et la monnaie est une simple
technique d’échange. Cette conception strictement économique de l’argent comme monnaie contient

Marc Le Ny ― Conférence « Qu’est-ce que l’argent ? » ― Jeudi 7 juin 2012 ― page 5 / 8
implicitement une conception de la technique. Celle-ci est comprise comme un simple moyen. La technique est
moralement neutre. En comparaison de la condamnation religieuse et morale de l’argent, cette conception de
l’argent comme monnaie fait de l’argent un simple moyen moralement neutre d’échanger des biens dans le cadre
d’un marché.
Une telle conception n ;, accompagne le développement du capitalisme. Cela se comprend aisément dans la
mesure où la multiplication des échanges économiques impose de trouver de nouveaux moyens pour les faciliter
et les accélérer. Le capitalisme se définit comme un système économique fondé sur la recherche rationnel du
profit optimum. Il revient donc aux économistes historiques comme Smith ou Ricardo, qui pensent le phénomène
se déployant sous leurs yeux, de proposer une telle théorie de l’argent comme monnaie neutre. Le troc, dit Smith
(Richesse des nations), exige une double concordance. Pour échanger il faut en effet que mes propres
marchandises conviennent à celui dont je convoite la production. Le boucher peut souhaiter vendre sa viande au
boulanger et au brasseur sans avoir nécessairement besoin de pain ou de bière. Il faut qu’une marchandise tierce
qui convienne à tout le monde facilite l’échange : telle est la réalité technique de la monnaie.
Si on a longtemps frappé la monnaie, les « lettres de change » en papier apparaissent au XIII
e
siècle,
facilitant les affaires des marchands et des banquiers. Au lieu de transporter de lourdes quantités de pièces, le
marchand peut acheter avant son départ une « lettre de change » à son banquier. Ce document demande à l’agent
du banquier dans une autre ville de payer au marchand une somme d’argent donnée, dans la devise de cette ville,
à une date donnée, ce qui lui permet de financer ses dépenses dans la devise requise. La multiplication des
échanges économiques internationaux au début de l’essor du capitalisme fait apparaître les billets de banques et
les prêts avec intérêts au XV
e
siècle. On sait aussi qu’en juillet 1944, à la conférence dite de Bretton Woods, le
dollar américain est devenu la monnaie pour les échanges internationaux, puis, plus décisif encore, en 1971, le
lien entre le dollar et l’or est supprimé. Chaque monnaie nationale a maintenant une valeur relative à celle des
autres. La valeur d’une monnaie est dorénavant « flottante ». En rompant le lien avec le métal précieux, la réalité
de la monnaie apparaît au grand jour. La science économique utilise la distinction entre la monnaie divisionnaire
et la monnaie fiduciaire. La monnaie divisionnaire c’est ce qu’on appelle couramment les pièces de monnaie. Le
fait que les pièces de monnaie ont longtemps été fabriquées à partir de métaux précieux (l’argent et l’or
essentiellement) leur confère une valeur d’échange intrinsèque. Il semblait que leur valeur résidait dans leur
matérialité même. L’apparition de la monnaie fiduciaire (monnaie-papier ou billet de banque) prépare celle de la
monnaie scripturale, c’est-à-dire de la monnaie qui n’a plus d’autre existence matérielle que d’être une écriture
sur une ligne de compte dans la mémoire mécanique des ordinateurs des banques et des États. Cette évolution
historique révèle le caractère abstrait de la monnaie. Evolution historique : dématérialisation de l’argent,
augmentation considérable de la masse monétaire, accélération de sa circulation, monétarisation des sociétés
modernes (phénomène aussi important que l’urbanisation et l’industrialisation).
De l’or à la monnaie scripturale, nous avons là une conception fonctionnaliste de la monnaie ou, formulée
autrement, la thèse de la neutralité de l’argent. L’argent n’est rien d’autre qu’un moyen d’échange et toute autre
considération est une projection irrationnelle des acteurs économiques. On rappellera, dans le même ordre
d’idées, que le développement du capitalisme est accompagné par le protestantisme. C’est en effet la thèse de
Max Weber. Le conflit entre la mentalité chrétienne traditionnelle et la pratique capitaliste est en partie levé par
la mentalité protestante. La doctrine protestante est ambivalente vis-à-vis de la recherche du gain et du profit.
Luther écrit un Sermon sur l’usure où il condamne cette pratique financière. Cependant, le gain d’argent est
approuvé, la richesse et la réussite sont considérées comme des qualités, dans la mesure où cela correspond à une
activité professionnelle qui a elle-même pour fin la glorification de l’œuvre divine.
Prenant le contre-pied de la dénonciation traditionnelle de l’argent, la conception fonctionnaliste de l’argent
tend à lui reconnaître des vertus. En permettant l’échange, la monnaie permet l’enrichissement des nations et des
individus. L’argent rend possible une libération de l’individu qui peut acheter ce qu’il veut, quand il veut, à qui il
veut. L’argent permet d’établir des dettes chiffrées, et donc précises et exactes, contrairement, selon
l’anthropologue Marcel Mauss, aux systèmes d’échanges fondés sur le don et le contre-don, et où l’engagement
des protagonistes ne prend jamais fin. Le phénomène du potlatch décrit en effet une obligation de rendre à
l’infini (« dette de vie »). Dans une économie moderne, un échange est épuisé quand l’acheteur à payé et le
vendeur fourni le bien ou le service demandé. L’argent a la vertu de rendre les dettes effaçables. Il finitise la
dette : je ne dois pas tout à mon banquier, comme à mon seigneur ou à mes parents, je lui doit tant, et une fois
payé je ne lui dois plus rien. Il y a ainsi une sagesse ou une vertu de l’argent dans son exactitude numérique. La
monnaie permet l’échange, cause l’enrichissement, libère l’individu, multiplie les rapports sociaux avec les
autres, rationalise les rapports de dettes. Montesquieu : le commerce favorise la paix entre les peuples =
l’échange est un rapport à autrui non violent qui se distingue de la spoliation. Dans l’échange il y a une
réciprocité qui n’existe pas dans la violence. En plus de la réciprocité, l’échange exige une égalité des objets
échangés, et par conséquent, la pratique du commerce favorise l’évaluation commune de la valeur des choses.
4. L’argent comme institution sociale
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%