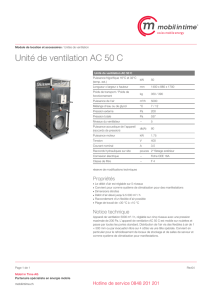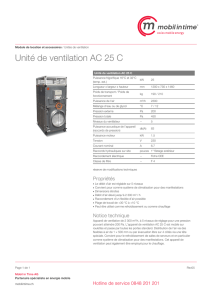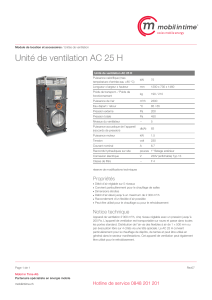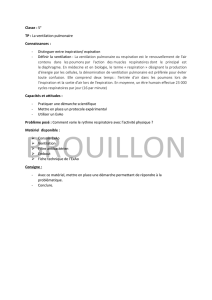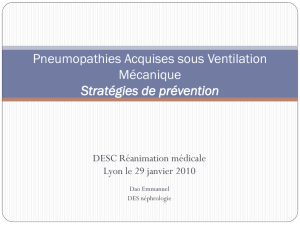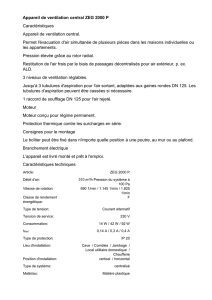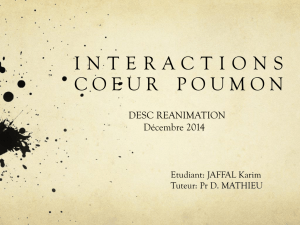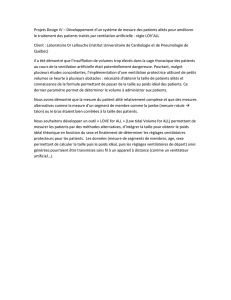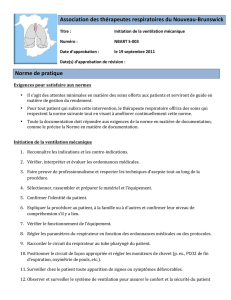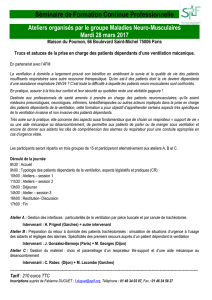restitution du congrès de l`esa 2015

1
L’ensemble de ces résumés est organisé selon le sommaire suivant :
Partie 1 : La ventilation en anesthésie-réanimation
Partie 2 : Mises au point
1. L’ambulatoire
2. Le remplissage vasculaire
3. Le patient obèse
Partie 3 : Les tendances de demain
1. En anesthésie
2. En réanimation
Composition du comité scientifique :
Dr Benjamin Bonnot (APHP St Antoine, Paris)
Dr Emmanuel Rineau (CHU d’Angers)
Dr Sébastien Ponsonnard (CHU de Limoges)
L’EUROANESTHESIA est organisé avec la
participation active de sociétés nationales et
des réunions communes sont tenues avec eux
occasionnellement. L’EUROANESTHESIA
est accrédité par l’UEMS*/EACCME* pour
des crédits de C.M.E*.
L’EUROANESTHESIA offre un programme
scientifique complet de cours de remise
à niveau, de symposiums scientifiques, de
symposiums satellites et d’ateliers, ainsi que
la présentation et la discussion de papiers de
recherche originaux.
Dr Marc Tran (APHP La Pitié Salpêtrière, Paris)
Avec le conseil du Pr Olivier Langeron (APHP La
Pitié Salpêtrière, Paris)
Le programme scientifique est établi par 19
sous-comités scientifiques.
Les abstracts et posters présentés durant le
congrès sont publiés comme un supplément
au Journal Européen d’Anesthésiologie.
Cette année s’est tenue à Berlin la dixième
édition de ce congrès. A cette occasion, un
comité de quatre médecins a accepté, en
partenariat avec Dräger, d’assister à des
conférences précises et de vous en apporter
la substantifique moelle.
La Société Européenne d’Anesthésie organise son congrès, EUROANESTHESIA,
partout en Europe. Les congrès sont soutenus par des membres et des non-membres
représentant plus de 65 pays du monde entier.
Restitution du Congrès de l’ESA 2015
RESTITUTION DU CONGRÈS DE L’ESA 2015
* European Union of Medical Specialists / European Accreditation Council for Continuing Medical Education
* Continuing Medical Education

Restitution du Congrès de l’ESA 2015
L’aventure continue ! Cette année à Berlin…
Ils sont toujours quatre jeunes anesthésistes-réanimateurs, tels
les mousquetaires en route pour le congrès annuel de l’European
Society of Anesthesiology (ESA) qui se tenait cette année à Ber-
lin. Avec la société Dräger, soutien de cette «aventure humaine
et professionnelle», ils ont pour mission de partager avec nous
les nouveautés présentées au congrès de l’ESA dans les domaines
de l’anesthésie mais aussi de la réanimation, aussi bien à travers
les communications scientiques que les conférences présentées
par des experts internationaux. Cette année encore, j’ai le privi-
lège et surtout le grand plaisir de les parrainer dans cette aven-
ture. Vous trouverez dans ce document restituant quelques-uns
des nombreux thèmes abordés au cours du congrès, des informations issues de l’analyse de nos jeunes collègues
qui ont assisté avec assiduité aux communications et débats sur des thèmes sélectionnés par leurs soins. Les
thèmes suivantssont traités : la ventilation toujours au cœur de nos préoccupations d’anesthésistes-réanima-
teurs, des mises au point sur l’ambulatoire, le patient obèse et le remplissage vasculaire, enn quelques perspec-
tives concernant l’anesthésie et la réanimation sont abordés.
Ce groupe de Jeunes Anesthésistes-Réanimateurs, constituant le JAR-club, est désormais bien en place et vous
permettra en un minimum de temps d’avoir un maximum d’informations sur de nombreux sujets et commu-
nications présentés au congrès de l’ESA à Berlin.…Très bonne lecture!
Pr Olivier Langeron
Réanimation Chirurgicale Polyvalente, Département d’Anesthésie-Réanimation
Hôpital Universitaire Pitié-Salpêtrière, Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, UPMC– Paris VI. 47-83
boulevard de l’Hôpital, 75651 PARIS Cedex 13
2

Restitution du Congrès de l’ESA 2015 3
sain n’est pas visible au-delà de
la plèvre. En revanche, en cas
de lésion, l’augmentation de tis-
su qui résulte de l’inflammation
locale tend à créer des artefacts
visibles à l’échographie. Ces
artefacts sont examinés dans
les 12 cadrans pulmonaires
prédéfinis et sont quantifiés
graduellement en allant de la
« queue de comète » simple à la
consolidation alvéolaire franche
et l’hépatisation du poumon. Le
score de LUS (Lung Ultrasound
Score) résulte de cette étude et
définit la gravité de l’atteinte pul-
monaire.
En parallèle, l’analyse du glisse-
ment pleural permet de détecter
les pneumothorax, et la visua-
lisation de la course diaphrag-
matique permet de prédire une
paralysie associée.
Les indications de l’échogra-
phie pleuro-pulmonaire sont au-
jourd’hui larges. Elle permet de
détecter l’aération pulmonaire
au décours d’un traitement anti-
biotique dans les pneumopa-
thies infectieuses (Bouhemad
et al, CCM, 2010), de monito-
rer l’effet de la Pression Expi-
ratoire Positive (PEP) et d’en
définir la « best PEP » dans les
SDRA (Rouby et al, AJRCCM,
2011), d’éliminer un pneumo-
thorax (Lichtenstein et al, Int
Care Med, 1999), et d’orienter
un diagnostic vers une patholo-
gie infectieuse ou de surcharge.
1. A propos du monitorage
Le réglage des paramètres
de ventilation chez un patient
sédaté repose principalement
sur l’hématose et les diffé-
rentes variables mesurées par
le respirateur. L’objectif de ces
modifications est d’améliorer
les échanges gazeux dans les
zones atteintes, tout en limitant
les lésions associées à un excès
de pression et de volume exercé
par cette ventilation dans les
zones saines. Cependant, la pro-
blématique essentielle réside
dans le fait que la plupart des
lésions pulmonaires concerne
une partie seulement du paren-
chyme tandis que la pression et
les volumes délivrés sont répar-
tis de manière homogène dans
l’ensemble du poumon.
Ainsi, alors que la pratique
usuelle de la ventilation s’inté-
resse à la globalité du paren-
chyme pulmonaire chez les
patients en défaillance respira-
toire aiguë, la place d’un sup-
port d’imagerie permet de mieux
considérer les différentes hété-
rogénéités parenchymateuses,
et d’adapter les paramètres
du ventilateur à l’étendue des
lésions observées. Cette image-
rie est également intéressante
pour le suivi de l’évolutivité de
l’atteinte pulmonaire.
Quelles modalités d’imagerie
sont les plus adaptées en réa-
nimation, dans ce contexte ?
La radiographie standard et la
tomodensitométrie (TDM) sont
les examens les plus fréquem-
ment utilisés, mais elles com-
portent toutes deux des limita-
tions qui réduisent leur utilité.
Alors que la première est peu
sensible chez un patient ventilé
et alité (Xirouchaki et al, Int Care
Med, 2011), la TDM, gold stan-
dard de l’imagerie pulmonaire,
expose à des risques non négli-
geables liés d’une part au trans-
port du malade et d’autre part
aux radiations émises (Beck-
man et al, Int Care Med 2004),
ce qui ne permet pas son utili-
sation répétée en routine. Les
techniques d’imagerie telles
que la tomographie par impé-
dance électrique, bien que très
intéressantes dans les modèles
de SDRA expérimentaux (Wolf
et al, Crit Care Med, 2013), sont
en cours d’évaluation pour la
routine clinique.
L’échographie pleuro-pulmo-
naire s’affranchit de ces li-
mites : facile d’utilisation, non
irradiante, reproductible et avec
une courbe d’apprentissage ra-
pide, sa performance est supé-
rieure à celle de la radiographie
standard ou de l’auscultation
(Lichtenstein et al, Anesthesio-
logy, 2004). Le principe repose
sur les propriétés physiques
des ultrasons. Ceux-ci ne tra-
versant pas un milieu rempli de
gaz, le parenchyme pulmonaire
Partie 1 : La ventilation en anesthesie-reanimation

Restitution du Congrès de l’ESA 2015
4
tion trachéale (Jaber et al. Crit
Care Med. 2006). Lors d’une
urgence, la présence d’un anes-
thésiste confirmé pendant le
geste diminue également la mor-
bidité (Schmidt et al. Anesthe-
siology. 2008).
L’extubation est un autre temps
critique de la prise en charge
des voies aériennes. Lorsque
l’intubation a été difficile, la pré-
sence d’un guide échangeur fa-
cilite la réintubation lorsqu’elle
est nécessaire et diminue les
complications de cette dernière
(Mort et al. Anesth Analg. 2007).
Lors de l’intubation prolongée,
un test de fuite réalisé avant
l’extubation peut permettre de
prédire le risque de détresse la-
ryngée et de réintubation (Jaber
et al. Int Care Med. 2003).
L’œdème laryngé post- extu-
bation peut être prévenu par
l’administration systématique de
corticoïdes dans les 24 heures
précédentes (François et al.
Lancet. 2007). La ventilation
non invasive post-extubation per-
met de réduire l’incidence des
échecs de sevrage ventilatoire
en réanimation (Ferrer et al. Am
J Respir Crit Care Med. 2006).
En réanimation, un protocole de
service incluant tous ces élé-
ments est la clef pour réduire la
morbi-mortalité liée à la prise en
charge des voies aériennes.
Tiré de “Complications of airway
En revanche, l’échographie ne
permet pas de surveiller les
sondes trachéales ou œsopha-
giennes.
Tiré de “Lung imaging in the
operative room and in the ICU”.
K Markstaller (AU), JJ Rouby
(FR), MG Abreu (DE).
Les complications de l’accès
aux voies aériennes supé-
rieures sont fréquentes (Cook
et al. Brit J Anesth 2012). Si ces
complications sont moins fré-
quentes en réanimation qu’en
péri-opératoire (20 % vs 74 % du
total des événements), elles sont
plus souvent mortelles (50 % vs
12 %).
Les difficultés de ventilation au
masque et d’intubation sont pré-
visibles (SFAR 1996, réactualisé
en 2006). La présence de deux
critères parmi les suivants per-
met de prédire la ventilation au
masque difficile : âge > 55 ans, in-
dex de masse corporelle (IMC) >
26 kg/m², limitation de la protru-
sion de la mâchoire, édentation
sub-totale, ronflement et barbes.
Le risque d’intubation difficile
est quatre fois plus important
lorsque la ventilation est difficile.
Les autres critères prédictifs
d’intubation difficile sont : anté-
cédents d’intubation difficile,
Mallampati > 2, distance thyro-
mentonnière < 65 mm, ouverture
de bouche < 35 mm, limitation
de la protrusion de la mâchoire
ou de la mobilité cervicale,
IMC > 35 kg/m², circonférence
du cou > 45 cm, pré-éclamp-
sie, pathologie de la face et du
cou. Récemment, le développe-
ment du score MACOCHA par
l’équipe d’AzuRéa (De Jong et
al. Am J Resp Crit Care. 2013) a
permis d’identifier de nouveaux
facteurs de risques : hypoxémie
sévère (SpO2 < 80 %), coma et
intubation par un non anesthé-
siste. Ainsi l’intubation dans un
secteur de réanimation doit tou-
jours être considérée comme
difficile.
La dénitrogénation avant l’in-
duction permet d’augmenter le
stock d’O2 (réserve pulmonaire
principalement) et le temps
d’apnée pendant l’intubation tra-
chéale. Elle nécessite l’emploi
d’une FiO2 à 100% (Edmark et al.
Anesthesiology. 2003), est plus
efficace associée à la ventilation
non invasive (Baillard et al. Am
J Respir Crit Care. 2006) et est
améliorée par le proclive chez
l’obèse (Dixon et al. Anesthesio-
logy. 2005). La mise en place
d’un protocole de service en
réanimation permet de réduire
l’incidence des complications
de la prise en charge des voies
aériennes supérieures (Jaber et
al. Crit Care Med. 2006). L’uti-
lisation d’un curare améliore
les conditions d’exposition lors
de la laryngoscopie (Mencke
et al. Anesthesiology. 2003) et
diminue la morbidité de l’intuba-

Restitution du Congrès de l’ESA 2015 5
management in the ICU”. O Lan-
geron (FR).
Deux publications majeures
encadrent le déplacement de
la ventilation dite protectrice de
la réanimation (ARDS Network.
New Eng J Med. 2000) vers le
bloc opératoire (Futier et al. New
Eng J Med. 2013). La ventilation
à petits volumes courants (VT
= 6 ml/kg de poids idéal théo-
rique) associée à la présence
d’une Pression Expiratoire Po-
sitive (PEP) systématique et à
des manœuvres de recrutement
améliorent la survie et diminuent
la morbidité des patients de
réanimation et de chirurgie. La
question est de savoir pourquoi.
Qu’est-ce qui lie la diminution de
volume courant à la diminution
de morbi-mortalité ?
Pour répondre à cette ques-
tion, il faut d’abord comprendre
la relation entre la variation de
pression pulmonaire (∆PL ou
stress) et la tension pulmonaire
(ou strain). Le strain peut être re-
présenté par : strain = VT/EELV
où EELV correspond au volume
pulmonaire télé expiratoire (End
Expiratory Lung Volume). La re-
lation qui lie le stress au strain
est celle-ci : stress = ELspec x
strain ; ELspec est l’élastance
pulmonaire spécifique (Chiu-
mello et al. Am J Respir Crit
Care Med. 2008).
La relation entre stress et strain
Finalement, la diminution
d’énergie appliquée au poumon
explique la diminution de morbi-
mortalité. Un stress à moins de
20 cmH2O et un strain à moins
de 1,5 pourraient être proposés
comme définition de la ventila-
tion protectrice.
Tiré de “Lung protective ventila-
tion: from the ICU to the OR and
back”. L Gattinoni (IT), B Vivien
(FR), G Hedenstierna (SW).
est linéaire lorsqu’on augmente
le VT jusqu’à ce que le strain
soit supérieur à 2. Au-delà de
ce point, la relation est de type
exponentielle ; c’est-à-dire que
l’augmentation de VT (ou l’aug-
mentation de strain) induit beau-
coup plus de stress (Protti et
al. Am J Respir Crit Care Med.
2011). C’est ce phénomène
qu’on appelle VILI (Volume In-
ducted Lung Injury).
Comment le stress et le strain
peuvent induire un VILI ? Tout
est une question d’énergie
apportée au poumon. Lorsque
la tension appliquée (strain)
est variable dans le temps, par
exemple lors de l’administration
d’un VT, une énergie est appli-
quée : Pression x ∆V = Energy
Input. En revanche, lorsque le
strain appliqué est continu, il n’y
a pas d’entrée d’énergie : PEP x
∆V = Energy Input = 0.
En diminuant le VT et en aug-
mentant la PEP, même si le
volume pulmonaire total mobi-
lisé est le même, le strain est
diminué et donc le stress est
diminué (Protti et al. Crit Care
Med. 2013). Moins d’énergie
est appliquée aux structures pul-
monaires et ce de manière plus
homogène, il n’y a pas de VILI.
L’absence de VILI n’entraine
pas d’agression et d’inflamma-
tion locale (O’Neil et al. Nature.
2005).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%