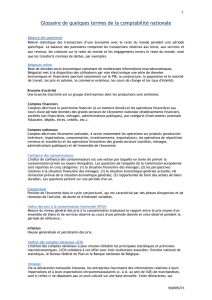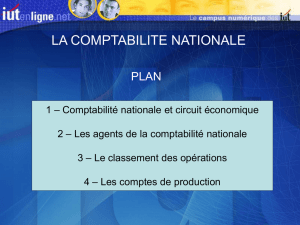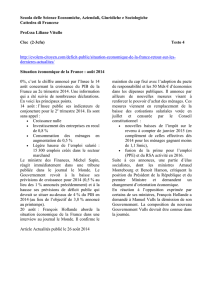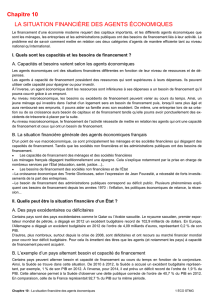0,0 = 0,0

B. Engelhardt-Bitrian Economie Politique
2013-2014
1
TD1 Introduction à l’économie réelle.
CORRECTION T.D. 1
Introduction à l’économie réelle.
Première séquence : Situation générale de l’économie mondiale en 2012.
Objectif : mesurer le degré de compréhension des étudiants en ce qui concerne la situation
économique mondiale actuelle, et celle de la France et de l’Europe en particulier.
1. Qu’appelle-t-on « crise des dettes souveraines » et quelles en sont les conséquences
principales ?
Le terme de « dette souveraine » désigne l’accumulation, dans certains pays de la zone euro, des
déficits annuels du budget de l’Etat (un excès des dépenses par rapport aux recettes de l’Etat), déficits
couverts par des emprunts matérialisés par des titres (essentiellement des obligations) représentatifs de
sa dette : ces titres sont majoritairement acquis par des investisseurs institutionnels privés (banques,
sociétés d’assurance, fonds de pension), et leur valeur inscrite à l’actif de leur bilan, dans leur portefeuille
de créances.
Le taux de ces emprunts est d’autant plus élevé que la solvabilité des Etats concernés (leur capacité
à rembourser le principal et les intérêts de leur dette) est jugée faible. Parallèlement, lorsque cette
capacité de remboursement est mise en doute, la valeur de ces titres sur le marché secondaire des
capitaux baisse, avec plusieurs conséquences :
leurs propriétaires ont tendance à s’en débarrasser, ce qui accélère encore la baisse de leur cours.
la valeur de ces créances inscrite à l’actif du bilan des organisations qui les détiennent baisse, ces
bilans sont déséquilibrés et ces organisations se retrouvent elles-mêmes en difficulté lorsqu’elles
cherchent à emprunter.
S’agissant de banques, celles-ci ont plus de mal à se refinancer sur le marché interbancaire des
capitaux, sinon à des taux d’intérêt de plus en plus élevés, les prêteurs potentiels étant réticents à
accepter en contrepartie des titres qui perdent de la valeur. Les banques concernées n’ont ainsi plus
suffisamment de liquidités pour remplir leur rôle d’intermédiaire financier, et prêter à l’économie.
C’est ainsi que la défiance envers les États se propage aux banques, provoquant une crise sur le
marché interbancaire des capitaux qui pénalise leur refinancement, et conduit à une raréfaction du crédit
et à un durcissement des conditions de financement des secteurs privés dans les pays les plus touchés par
la crise : Grèce, mais aussi Espagne, Portugal, Italie. La crise se propage ainsi à l’ensemble de l’économie.
Cette crise qui affecte un certain nombre d’économies de la zone euro menace l valeur même de
l’euro sur le marché des changes. Pour enrayer cette crise de confiance dans l’euro, la Banque Centrale
Européenne somme les Etats concernés de réduire par tous les moyens leurs déficits, ce qui a un effet
récessif sur leurs économies, récession qui, parce qu’elle réduit mécaniquement les recettes fiscales,
aggrave encore leur endettement. (Voir schéma en annexe 3)
2. Comment définit-on le PIB ?
Il s’agit du « Produit Intérieur Brut » d’un pays, c’est-à-dire :
La valeur de la production totale d’un pays (qu’elle soit ou non vendue sur un marché : production
marchande, non marchande et à compte propre), aux prix facturés par les producteurs, hors taxes :
c’est ce que l’on appelle le « prix de base »…
… Dont on déduit la valeur des consommations intermédiaires : on obtient alors la somme des valeurs
ajoutées…

B. Engelhardt-Bitrian Economie Politique
2013-2014
2
TD1 Introduction à l’économie réelle.
A laquelle on rajoute la valeur des impôts prélevés sur les produits (TVA, taxes sur les produits du
tabac et les alcools, droits de douane sur les produits importés) déduction faite des subventions sur
les produits. On obtient le PIB « aux prix du marché », ou « prix d’acquisition », c’est-à-dire les prix
réellement payés par l’acquéreur final.
Exemple de Calcul du PIB de la France pour 2012 :
P1
Production (aux prix de base)
3 699,4
P11
Production marchande
3 038,8
P12
Production pour emploi final propre
229,0
P13
Autre production non marchande
431,6
P2
Moins Consommation intermédiaire
-1 878,5
= Somme des valeurs ajoutées
1820,9
D21N
Plus Impôts moins subventions sur
les produits
+211,4
= PIB (aux prix d’acquisition)
2 032,3
En 2012, la valeur du PIB de la France s’élevait donc à 2032,3 Milliards d’euros (euros courants de
l’année 2012).
3. « Resserrement des politiques monétaire et budgétaire » : en quoi consistent ces
politiques ?
Politique Budgétair restrictive : politique visant à réduire les déficits publics. Cette politique
consiste essentiellement à accroître les recettes (augmentation des impôts) et à réduire les dépenses de
l’Etat. On parle de politique de rigueur ou d’austérité. Elles ont pour effet de réduire la demande globale, et
provoquent généralement un ralentissement de la croissance.
Inversement, une politique budgétaire expansionniste, ou de relance, consistera à augmenter les
dépenses publiques (en particulier les dépenses d’investissement, mais aussi les dépenses à caractère
social, ou encore les salaires de agents de l’Etat) de manière à accroître une demande globale jugée trop
faible, et favoriser ainsi la croissance.
Politique Monétaire restrictive : politique visant à juguler une inflation jugée trop élevée ; cette
politique passe essentiellement par une augmentation des taux d’intérêt directeurs de la Banque Centrale
(taux auquel la Banque Centrale prête des liquidités aux banques (dites « de second ordre ») pour 24
heures – facilités permanentes de prêt, taux directeur « plafond » – et taux auquel la banque centrale
rémunère les dépôts à 24 heures des banques – facilités permanentes de dépôt, taux directeur
« plancher ». Ces deux taux constituent la fourchette à l’intérieur de laquelle s’inscrit le taux auquel les
banques se prêtent mutuellement des liquidités, sur le marché interbancaire des capitaux. Il s’agit ici
d’une politique monétaire restrictive. La hausse des taux d’intérêt contribue à ralentir ou à réduire la
demande d’investissement et le crédit à la consommation, ce qui a pour effet, comme dans le cas d’une
politique d’austérité, de ralentir la croissance.
A l’inverse, une politique monétaire expansionniste passe essentiellement par une baisse des taux
directeurs de la Banque centrale, ce qui facilite l’accès au crédit, favorise l’investissement et la
consommation, et en finale la croissance.
4. Que signifie concrètement le « durcissement des conditions de crédit » ?
Il s’agit des conditions auxquelles les banques accordent des crédits (à la consommation ou à
l’investissement) aux agents économiques non financiers (ménages, entreprises collectivités territoriales
pour l’essentiel).
Montant et durée du prêt, garanties exigées par le prêteur.
Taux d’intérêt (taux de base bancaire auquel s’ajoute la « prime de risque » calculée en fonction du
risque d’insolvabilité de l’emprunteur.

B. Engelhardt-Bitrian Economie Politique
2013-2014
3
TD1 Introduction à l’économie réelle.
Le « durcissement » se traduit par une sélection plus importante des bénéficiaires d’un prêt, des
garanties exigées plus importantes, et des taux d’intérêt plus élevés. Cela conduit généralement à un
« rationnement du crédit »
5. En 2012, le taux de croissance du PIB a été de 0,9% en Allemagne, et de 0,0% en France.
Que signifient ces chiffres ?
Par rapport au PIB de 2011, celui de 2012 a augmenté en volume de 0,9% en Allemagne et est
resté stable en France.
Le taux de croissance du PIB est toujours calculé « en volume », c’est-à-dire en euros constants de
l’année de référence (ici l’année 2011), ou encore « aux prix de l’année 2011 », ce qui signifie que l’on a
valorisé la production de 2012 aux prix de l’année 2011, sans tenir compte de l’inflation.
En effet, l’augmentation de la richesse d’un pays (la « croissance ») ne peut se mesurer que par
l’augmentation des quantités (des « volumes ») de biens et de services produits, et non pas de la valeur de
la production. En effet, si le taux d’inflation est suffisamment élevé, le PIB en valeur peut avoir augmenté,
alors même que les quantités produites ont diminué.
6. Taux de croissance du PIB en 2012 : Commentez les chiffres.
A l’évidence, les pays émergents affichent une meilleure santé que les pays avancés : le taux de
croissance moyen, pour les pays émergents répertoriés dans ce tableau, est de 4,1% (moyenne simple,
non pondérée par la valeur respective des PIB de chaque pays). Trois pays se distinguent nettement des
autres par leur forte croissance ( 4%) : la Chine (7,8%), l’Indonésie (6,2%) et l’Inde (4%).
En comparaison, le taux de croissance moyen des pays avancés n’est que de 1,3%. Cette moyenne
cache des situations variées : certains pays sont en récession (taux de croissance du PIB négatif : Italie,
Espagne, Pays-Bas, Belgique), d’autres affichent des taux de croissance plus ou moins élevés : l’Australie
arrive en tête avec 3,6%, suivie des Etats-Unis (2,2%), du Japon et de la Corée du Sud (2%).
En Europe, les taux de croissance dépassent rarement 1%. Il est même négatif pour la Zone Euro
dans son ensemble.
Deuxième séquence : Les différentes approches du PIB.
Objectif : mettre en évidence, à l’aide de ces trois approches, la manière dont fonctionne une
économie : on produit (d’où provient le produit intérieur brut ? C’est l’approche « production ») ;
les biens et services produits font l’objet de différents usages (comment a été utilisée la
production ? C’est l’approche « utilisation ») ; la production et les échanges génèrent des revenus
de différente nature (comment ont été distribués les revenus issus de la production ? C’est
l’approche « répartition »).
Commenter chacune des 3 approches proposées par le tableau, en définir les termes et
indique le calcul permettant de retrouver la valeur du PIB. Répondre aux questions posées.
Approche Production :
1. En ce qui concerne la production, on distingue : la production marchande, la production pour emploi
final propre et la production non marchande. Définissez ces trois termes.
2. Les branches d’activité recensées dans le tableau sont réparties en 3 grands secteurs : primaire,
secondaire et tertiaire. Quelles branches appartiennent à quel secteur ?
3. Le tableau indique la valeur ajoutée dégagée par chaque branche : comment calcule-t-on la valeur
ajoutée ? Définissez ce que l’on appelle les « consommations intermédiaires ».
Approche « Production » ou : d’où provient le PIB ?
Production marchande
Production destinée à être vendue sur un marché à un
prix supérieur à 50% des coûts de production.
Production pour emploi final propre
Elle concerne les biens ou services qu’une unité
institutionnelle produit et conserve pour sa
consommation finale ou sa formation brute de capital

B. Engelhardt-Bitrian Economie Politique
2013-2014
4
TD1 Introduction à l’économie réelle.
fixe. Ces biens et services sont valorisés au prix de base
des biens et services de même nature vendus sur le
marché.
Autre production non marchande
Services proposés à titre gratuit ou à un prix couvrant
moins de 50% des coûts de production. Produits par les
Administrations Publiques (APU), ou les Institutions
sans But Lucratif au Service des Ménages (ISBLSM), ces
services répondent à une logique de besoins collectifs
(santé, éducation, justice, défense nationale, aide sociale,
assistance aux plus démunis, etc.).
La production non marchande est valorisée à la somme
des coûts de production.
Le PIB résulte de la production des entreprises appartenant à différentes branches d’activité.
Celles-ci regroupent les entreprises (ou les établissements d’une même entreprise) qui produisent la
même catégorie de bien ou de service. Elles sont classées dans des « nomenclatures » d’activités et de
produits (une activité = un produit).
Les nomenclatures élaborées par l’INSEE (NAF 2008) comportent 5 niveaux d’agrégation :
Niveau 5 : le plus détaillé, il recense 732 sous-classes d’activités, numérotées de 01 11Z à 99 00Z.
Niveau 4 : les 732 sous-classes précédentes sont regroupées en 615 classes d’activités, numérotées de
01 00 à 99 00.
Niveau 3 : les 615 classes précédentes sont regroupées en 272 groupes d’activités, numérotés de 01 1
à 99 00.
Niveau 2 : les 272 groupes d’activités précédents sont agrégées en 88 divisions, numérotées de 01 à
99.
Niveau 1 : à ce niveau d’agrégation, on distingue 21 sections d’activités, numérotées de A à U.
Exemple : Dans quelles catégories est classé un viticulteur de la région bordelaise ?
01.21Z
Culture de la vigne (sous-classe)
01.21
Culture de la vigne (classe)
01.2
Cultures permanentes (groupe)
01
Culture et production animale, chasse et services annexes (Division)
A
Agriculture, sylviculture et pêche (section)
Enfin, la présentation au grand public recense 10 grandes branches d’activités, (voir tableau ci-
dessus, approche « production », pour l’Allemagne) regroupées en 3 grands secteurs :
Secteur primaire : Agriculture, Sylviculture, pêche (23,0 Mrds d’€, 1% de la VA totale)
Secteur secondaire : Industrie, Bâtiment et travaux publics (722,3 Mrds d’€, 30,5%)
Secteur tertiaire : de Commerce, transports, hôtellerie et restauration à Autres services
(1619,3 Mrds d’€, 68,5%)
Comme dans tous les pays avancés, le secteur tertiaire est prépondérant.
A titre de comparaison : France 2011 :
Branches - Valeur Ajoutée brute en 2011
Mrds d'€
% VA totale
Secteur
% VA totale
Agriculture, Sylviculture, Pêche
32,8
1,8
Primaire
1,8
Industrie manufacturières, extractives et autres
224,6
12,6
Secondaire
18,7
Construction
110,1
6,2
Services principalement marchands
1017,2
56,9
Tertiaire
79,5
Services non marchands
404,3
22,6
Total
1789,0
100,0
Total
100,0

B. Engelhardt-Bitrian Economie Politique
2013-2014
5
TD1 Introduction à l’économie réelle.
Le tableau indique la valeur ajoutée (production aux prix de base, c’est-à-dire aux prix « sortie
usine » facturé par le producteur, hors taxes, moins la valeur des consommations intermédiaires) de
chaque branche d’activité.
Consommation intermédiaire
Valeur des biens et services transformés ou entièrement
consommés au cours du processus de production. Matières
premières, biens intermédiaires, et produits consommables
(ex. : électricité)
La somme des valeurs ajoutées a été en 2012 de 2364,6 Mrds d’€. Si on y ajoute les impôts nets de
subventions sur les produits (279,3 Mrds), qui contribuent à augmenter le prix de vente à l’utilisateur
final, on obtient le PIB aux prix du marché, ou aux prix d’acquisition (2643,9 Mrds).
PIB = Production – consommations intermédiaires + Impôts nets de subventions sur les produits
2643,9 = 2364,6 + 279,3
Approche « Utilisations » ou : comment a été utilisée la production ?
Une partie de la production est destinée à la consommation finale :
Dépense de consommation finale
Les produits font l’objet d’une consommation finale
lorsqu’ils sortent définitivement du circuit de
production et sont utilisés à la satisfaction des besoins
individuels ou collectifs.
Les dépenses de consommation finale sont le fait de trois secteurs institutionnels :
les ménages (dépenses de consommation finale que les ménages financent sur leur propre revenu),
Dépense de consommation finale des ménages
Dépenses que les ménages financent sur leur budget
propre.
les Institutions sans but lucratif au service des ménages ou ISBLSM (valeur des services produits par
ces institutions mais destinés à des individus, des ménages ou des groupes de ménages).
et les Administrations publiques ou APU (valeur des biens et services produits par l’Etat, les
organismes de sécurité sociale et les organisations qui en dépendent, les collectivités territoriales et
les organismes qui en dépendent, et destinés aux ménages). On distingue deux catégories de
dépenses :
Dépense de consommation finale collective des APU
Dépenses des administrations publiques dont les
bénéficiaires ne peuvent être précisément définis.
(défense nationale, police…)
Dépense de consommation finale individualisable des
APU
Dépenses effectuées par les administrations publiques à
destination d’individus ou de ménages, dont les
bénéficiaires peuvent être identifiés et le montant perçu
déterminé avec précision. par Dépense de
consommation des ménages et consommations
individualisables incluses dans la dépense de
consommation finale des Administrations Publiques et
des ISBLSM. Ex. : Education, transports publics…
Cette distinction permet d’évaluer les dépenses de consommation finale individuelle, ou
consommation effective, des ménages :
Consommation effective des ménages
Dépense de consommation des ménages et
consommations individualisables incluses dans la
dépense de consommation finale des Administrations
Publiques et des ISBLSM.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%