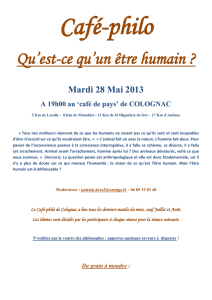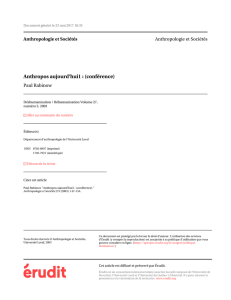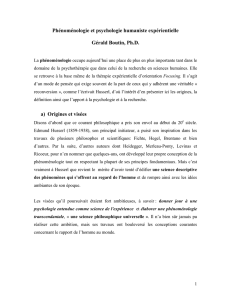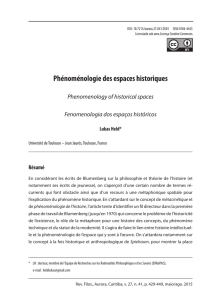Blumenberg : entre métaphores et anthropologie

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!"#$%&'%()*+*
%&,(%*$-,./01(%2*%,*.&,0(1/1"1)3%*
*
*
*
*
*
*
*
41223%(*511(61&&-*/.(*703'.#6*8#//3&)%(*
9.(#,31&*$.3*:;<=*
*
*
*
*
*
!
!
!
>$/"35.,31&2*/03"121/03?#%2*@*>ABB*:<;CD;EFG*

!
Copyright 2013 © Implications philosophiques – ISNN 2105-0864
:!
!"#$%&'%()*+"%+$,"+-.&&#+/++
!
01-%234.&+-.&3(%+,#345$%+
! "#$%! &'()*$+*,-! *%.! )#'! /0$$(!1! 2*! 3(45'! 6! #! *$/0,*! 3(*'3(*%! #$$7*%!
80(9#5.!:.,*!#9#$/7!%#$%!,5%3(*!/0))*!($*!#;;5,)#.50$!.*$<!=!<*9*$5,!#(>0(,<4?(5!
<#9#$.#-*!($*!3(*%.50$!,?7.0,53(*!<0$.!'#!,780$%*!*%.!'05$!<4:.,*!795<*$.*@!!!
! A#,#<0B#'*)*$.C! %5! %#! ,7/*8.50$! *%.! )#5$.*$#$.! +5*$! ,7*''*! *$! D,#$/*C! /*!
)0(9*)*$.!*%.!/0))*!0//('.7!8#,!/*!3(5!*%.!<*9*$(!/0))*!($*!<*95%*!<*%!7.(<*%!
+'()*$+*,-5*$$*!E! F!'4#(.5%)*! <*! '#! ,7/*8.50$!G@! 2*..*! ;0,)('*! <*! %0$! .,#<(/.*(,C!
H*$5%! I,5*,J*5'*,C! <#$%! '#! !"#$%$&$%"' ()*' %)&+*' &,()-.)*C! 7.#5.! ($! /0$%.#.! >(%.*! *.!
%(,.0(.! ($! #88*'! =! '#! /0))($#(.7! 8?5'0%08?53(*! =! #//0,<*,! %0$! #..*$.50$! =! /*!
8?5'0%08?*! 5$;5<K'*! #(B! 8?7$0)7$0'0-(*%C! )#5%! ;5<K'*! =! /*.! 5<7#'! <*! <*%/,58.50$!
#+%0'(*@!!!
!
6%5+7%#8+29,5%5+7%+",+(1-%234.&++
! 2*.!#88*'!#!7.7!*$.*$<(!*.!$0(%!80(90$%!$0(%!*$!,7>0(5,@!L#$%!<0(.*!8*(.M0$!
*%.5)*,!3(*!'4*%%*$.5*'!#!7.7!.,#<(5.C!):)*!%5!<*!$0)+,*(B!.*B.*%!,*%.*$.!=!.,#<(5,*@!
N(>0(,<4?(5! <*%! /?*,/?*(,%! <*! 8'(%! *$! 8'(%! $0)+,*(B! *B8'0,*$.! %#! 8*$%7*C! '*%!
#,.5/'*%!*.!'*%!/0''03(*%!%*!;0$.!8'(%!;,73(*$.%C!'*%!)5%*%!*$!<5#'0-(*%!#9*/!'*%!#(.,*%!
8*$%*(,%!%408K,*$.@!&*#(/0(8!#!7.7!;#5.C!*.!+*#(/0(8!8'(%!*$/0,*!,*%.*!=!;#5,*@!
! O$! $0(9*#(! 8?5'0%08?*! *%.! *$.,7! <#$%! '*%! +5+'50-,#8?5*%! *.! #9*/! '(5! <*!
$0(9*#(B! 8,0+'K)*%! *.! <*! $0(9*''*%! 80%.(,*%! %0$.! <5%80$5+'*%! 80(,! 8*$%*,! '*!
)0$<*@!P'!;#(.!/0$%.#.*,!'47'#,-5%%*)*$.!<*%!.,#<(/.50$%C!<*%!7.(<*%!*.!<*%!#,.5/'*%!
3(5!'(5!%0$.!/0$%#/,7%@!!
! A#%%7! '45$.*$%*! .,#9#5'! <*! )5%*! =! <5%80%5.50$! <*%! 8,5$/58#(B! 0(9,#-*%! <*!
&'()*$+*,-C!#9*/!'4#88#,*5'!/,5.53(*!*.!)0$0-,#8?53(*!95%#$.!=!;#)5'5#,5%*,!'*!8(+'5/!
#9*/! ($! $0(9*'! #(.*(,C! 95*$.! '*! )0)*$.! <*! '47.(<*! 8,08,*)*$.! <5.*!Q! 5$.7-,*,C!
<5-7,*,! *.! 80%*,! =! $0(9*#(B! ;,#5%! '*%! ,7%('.#.%! <*! /*%! .,#9#(B@! P'! %4#-5.! *$! 3(*'3(*!
%0,.*! <*! ;#5,*! >0(*,! '45$;5<7'5.7! *$9*,%! '4#(.*(,! /0$.,*! '#! ;7/0$<5.7! <*! /*%!
8,080%5.50$%@!!
!
:(15%&-%+7#+2,551+%3+(1-%234.&+74;;1(1%+
! P'!*%.!<5;;5/5'*!<*!$*!8#%!8,:.*,!#..*$.50$!=!'#!)#$5K,*!<0$.!'#!,7/*8.50$!<*!%#!
8,08,*! 8?5'0%08?5*! %408K,*C! .#$.! %*%! 8,08,*%! .,#9#(B! 8*(9*$.! :.,*! /0$%5<7,7%!
/0))*! ($*! 8?5'0%08?5*! <*! '#! ,7/*8.50$! *.! 0$.! .0(>0(,%! 80,.7! ($*! 5$/,06#+'*!
#..*$.50$!=!/*%!)6%.K,*%!<*!'#!,7/*8.50$C!=!'#!95,('*$/*!3(4($!/0$/*8.!80(9#5.!#905,!
?0,%! <(! %6%.K)*! 3(5! '4#! *$-*$<,7C! *.! '*%! ,*8,7%*$.#.50$%! *.! .0,%50$%! 3(*! '*%!
)*$.#'5.7%! 08K,*$.! %(,! '*%! 5<7*%@! 2*..*! 8,7%*$/*! <(! 8#%%7! <#$%! '4R(9,*! <*!
&'()*$+*,-!*%.!%#$%!<0(.*!'4($!<*%!.,#5.%!'*%!8'(%!%#5''#$.%!<*!%*%!.,#9#(B@!!
! L(,.0(.C! &'()*$+*,-! $0(%! #88,*$<! =! 905,! <5;;7,*))*$.C! =! #,,:.*,! $0.,*!
8*$%7*!%(,!<*%!<0)#5$*%!8*(!0(!)#'!*B8'0,7%!80(,!$0(%!5$<53(*,!'*(,!5)80,.#$/*!

!
Copyright 2013 © Implications philosophiques – ISNN 2105-0864
=!
<#$%! '#! 95*! <*! '#! 8*$%7*@! L0$! .,#9#5'! %(,! '*%! )7.#8?0,*%! *%.! #+%0'()*$.!
,*)#,3(#+'*@! S0.#))*$.! <#$%! /0-0($#&)' +,1-' 1.)' &"%0+2,-,!,#$)3' P'! *%.!
5)80,.#$.! <*! ,#88*'*,! 3(*! '47,(<5.50$! <*! &'()*$+*,-! $4*%.! 8#%! -,#.(5.*@! T''*!
80%%K<*!($*!95%7*!.?7,#8*(.53(*C!$0(%!<0$$#$.!'*%!)06*$%!<*!$0(%!%5.(*,C!<#$%!'*!
)0$<*!*.!<#$%!'#!/('.(,*@!!
! 2*..*!8,70//(8#.50$! *%.!8'*5$*)*$.!*$! 8?#%*!#9*/! %0$!*B5-*$/*! <*!<7/,5,*!
.0(.C!#(%%5!/0)8'K.*)*$.!3(*!80%%5+'*@!T$!/*!%*$%C!5'!,#88*'#5.!%0(9*$.!($*!/5.#.50$!
<*!U5'V*!<#$%!'#!$*(95K)*!7'7-5*!E!F!($*!%*('*!;05%C!*.!8'(%!>#)#5%!G@!L#!95*!*$.5K,*!#!
7.7!/0$%#/,7*!=!$*!>#)#5%!,5*$!'#5%%*,!8*,<,*!<*!/*!3(5!*%.!?()#5$@!!
! 2*..*! /0$;5#$/*! <#$%! '#! ,7/*8.50$C! <7.#/?7*! <*! '45))7<5#.*.7C! %*! ,*.,0(9*!
<#$%!'*%!8(+'5/#.50$%!<*!&'()*$+*,-@!L*!,*.5,#$.!<*!.0(.*!,*'#.50$!)0$<#5$*!9*,%!'#!
;5$!<*!%#!95*C!5'!%*!/0$%#/,#!=!'#!,7<#/.50$!<40(9,#-*%!5)8,*%%50$$#$.%C!3(45'!,7%*,9*!
80(,!($*!8(+'5/#.50$!80%.?()*@!!
!
<%+"=9.$$%+>+"=?#@(%*+%3+(%3.#(+
! "#$%!&'()*$+*,-!*%.!($!8?5'0%08?*!%0'5.#5,*C!8,0;0$<7)*$.!0,5-5$#'@!2*'#!*%.!
($! .,#5.! <*! +*#(/0(8! <*! 8?5'0%08?*%! <5-$*%! <*! /*! $0)C! 3(5! $*! %0$.! #'0,%! 8#%! <*%!
785-0$*%!)#5%!<*!97,5.#+'*%!8*$%*(,%C!;0,-*#$.!<*!'45$7<5.@!HK%!3(*!'40$!7/?#88*!#(B!
7.53(*..*%! *.! #(B! /0(,#$.%C! 5'! *%.! +5*$! <5;;5/5'*! <4:.,*! 5<*$.5;57@! W#,50$! L/?())! '*!
,#88*''*!E!F!&'()*$+*,-!*.!%0$!R(9,*!%*!<7,0+*$.C!%#$%!<0(.*!8#,!($*!$7/*%%5.7!<*!
8,5$/58*C!=!.0(.*!7.53(*..*!*.!#;;5'5#.50$!G@!!
! X! /*.! 7-#,<C! 5'! *%.! 795<*$.! 3(*! '*%! 0(9,#-*%! <*! &'()*$+*,-! *B8,5)*$.! ($*!
8*$%7*C!)#5%!,*;'K.*$.!#(%%5!($*!8*,%0$$#'5.7@!A0(,!#88,0;0$<5,!/*..*!5$.*,,0-#.50$!
%(,!'4?0))*!#(.#$.!3(*!%(,!%0$!R(9,*C!$0(%!90(%!%5-$#'0$%!<4#5''*(,%!'*!$()7,0!<*%!
/#?5*,%!8?5'0%08?53(*%C!#9*/!<*(B!#(.,*%!*$.,*.5*$%!#//*%%5+'*%!*$!'5-$*@!!
?..8EYY/#?5*,%8?5'0%08?53(*%@?680.?*%*%@0,-YZ[Z!
24*%.! %#$%! <0(.*! 80(,! /*'#! 3(45'! *%.! ?#(.*)*$.! 5)8,0+#+'*! <*! 905,! %*! /0$%.5.(*,!
#(.0(,!<*!/*.! ?7,5.#-*!($! /0(,#$.!8?5'0%08?53(*! ,#%%*)+'#$.!($!/0,8(%!<*!.?K%*%!
/0))($*%! *.! <*! )7.?0<*%! <45$9*%.5-#.50$! 8#,.#-7*%@! 20))*! '*! %0('5-$*! \(V#%!
"*'<!E! F!O$*! <*%! <5;;5/('.7%! 3(*! 80%*! '#! 8*$%7*! <*! &'()*$+*,-! =! %0$! 5$.*,8,K.*!
,7%5<*!*$!'4#+%*$/*!<4($!/*$.,*!/'#5,*)*$.!<7;5$5C!<4($*!8,0+'7)#.53(*!$0<#'*!<0$.!
%*%!7/,5.%!%*,#5*$.!<*%!<7/'5$#5%0$%@!G!
! A0(,! /*..*! 3(*%.50$! <*! '#! ,7/*8.50$C! *.! 8#,! <*'=C! /*''*! <*! '#! .,#$%)5%%50$C!
/*..*!<5)*$%50$!%5$-('5K,*!*.!8,*%3(*!%0'5.#5,*!<05.!:.,*!8,5%*!*$!/0)8.*!E!/0))*$.!
#''*,!8'(%!'05$!#9*/!&'()*$+*,-!1!!
! 24*%.! 80(,3(05! '*! .,#9#5'! 3(5! %4#$$0$/*! *%.! '05$! <4:.,*! 795<*$.C! /0))*! *$!
.7)05-$*,#! '*%! /0$.,5+(.50$%! ,7($5*%! <#$%! /*! <0%%5*,@! \#! <5,*/.50$! 8,5%*! 8#,! '*%!
7.(<*%!+'()*$+*,-5*$$*%!*%.!'05$!<4:.,*!($!/?*)5$!<7>=!.,#/7@!T$!*;;*.C!'#!8*$%7*!<*!
&'()*$+*,-!$4*%.!8#%!%5)8'*@!L0$!7,(<5.50$!*%.!%#5%5%%#$.*C!%0$!%.6'*!>#)#5%!,*']/?7!
*.!'45)8'5/5.*!#(%%5!<0)5$#$.!3(*!'45,0$5*@!!
I?5+#(<!^(885$-*,!

!
Copyright 2013 © Implications philosophiques – ISNN 2105-0864
G!
H#*/(1)(.$$%*6%*5%*61223%(*,0-$.,3?#%*
*
A&3(%34%&+
!2*!<0%%5*,!.?7)#.53(*!%40(9,*!8#,!($!*$.,*.5*$!#9*/!H*$5%!I,5*,J*5'*,!Q!%0$!
.,#<(/.*(,! *.! '4($! <*%! 8,5$/58#(B! #,.5%#$%! <*! %#! <5;;(%50$! *$! D,#$/*@! P'! %4#-5,#! <*!
8#,/0(,5,!($*!8,*)5K,*!;05%C!=!-,#$<*!*$>#)+7*C!'*!87,5)K.,*!<*%!/?#$.5*,%!#(B3(*'%!
%4*%.!#..*'7!"#$%!&'()*$+*,-C!#;5$!<*!.*$.*,!<4*$!8,080%*,!($*!95%50$!-7$7,#'*@!!
!
B(34-"%5+
! X!'#!%(5.*!<*!'4*$.,*.5*$C!$0(%!90(%!8,080%0$%!.,05%!#,.5/'*%!<*!/?*,/?*(,%!3(5!
/0$.,5+(*$.! 8#,! '*(,%! .,#9#(BC! =! '#! <5;;(%50$! <*! '#! 8?5'0%08?5*! <*! &'()*$+*,-@! 2*%!
.,05%! #,.5/'*%! %0$.! #(.#$.! <*! ,*-#,<%! 3(5! 8*,)*..*$.! <*! )5*(B! /0)8,*$<,*!
&'()*$+*,-!*.!%0$!5$%/,58.50$!<#$%!%0$!.*)8%@!N5$%5C!'#!/0$.,5+(.50$!<4T'5%*!W#,,0(!
%4#..#/?*,#!=!)*..,*!*$!795<*$/*!'4?7,5.#-*!*.!'#!8,7%*$/*!<*!_5..-*$%.*5$!<#$%!'*%!
7/,5.%! <*! &'()*$+*,-@! `$! /0)8,*$<! a! b! c! 3(*! 80(,! &'()*$+*,-! '*! 4-05%0%1*!
8#,.5/58*! <*! ;#d0$! 8#,#<5-)#.53(*! <*! '#! .*$<#$/*! 3(5! )0.59*! '*! 8,0>*.!
)7.#8?0,0'0-53(*!'(5M):)*!E!,*.,#/*,!F!'e*;;0,.!3(5!;#5.!8#,.5*!<*!'e?5%.05,*!<*!$0.,*!
/0$%/5*$/*!<*!,*8,7%*$.*,!'e5$<5/5+5'5.7!8#,!'*!'#$-#-*!G@!
! X! /*..*! )5%*! *$! <5#'0-(*! *$.,*! &'()*$+*,-! *.! '#! 8?5'0%08?5*! <(! '#$-#-*C!
,780$<,#!'45$.*,9*$.50$!<*!W#,50$!L/?())!3(5!8*,)*..,#!<4#88,7?*$<*,!'*!<5#'0-(*!
3(45'! #! 80(,%(595! .0(.*! %#! 95*! #9*/! '#! 8?7$0)7$0'0-5*!E! 5$.*,,0-*,! '*%! ,#880,.%! <*!
&'()*$+*,-! =! '#! 8?7$0)7$0'0-5*! /0))*! /0(,#$.! <*! 8*$%7*C! /0))*! )7.?0<*!
.0(>0(,%!<5%/(.7*!*.!,77'#+0,7*C!)#5%!%(,.0(.!/0))*!/?#)8!8,0+'7)#.53(*!<*9,#5.!
8*,)*..,*!=!'#!;05%!<*!.,#/*,!($!8#,/0(,%!<#$%!%0$!R(9,*!3(5!*$!,*$<*!'#!,5-(*(,!*.!
'#!,5/?*%%*C!)#5%!7-#'*)*$.!<*!;#5,*!9#'05,!%*%!/0$.,5+(.50$%!8?5'0%08?53(*%!<#$%!'*(,!
0,5-5$#'5.7@!!
! \*! <*,$5*,! #,.5/'*! ,*95*$<,#! %(,! ($! <5#'0-(*C! )#$3(7! /*..*! ;05%@! 2*'(5! 3(*!
&'()*$+*,-!#!.*$.7!<45$5.5*,!#9*/!L/?)5..C!$0$!%#$%!5,0$5*@!24*%.!=!\(V#%!"*')!3(*!
,*95*$<,#! '#! /?#,-*! <*! )7$#-*,! ($*! *$.,7*! <#$%! '*! <7+#.! L/?)5..Y&'()*$+*,-@!
2*..*!*$.,7*!%*,#!#(%%5!'40//#%50$!<*!)*%(,*,!/0)+5*$!'4R(9,*!<*!/*.!#(.*(,!*%.!($!
3(*%.50$$*)*$.! 8,7/5*(B! <*! '#! )0<*,$5.7! *.! <(! 80'5.53(*@! \#! ,7;(.#.50$!
+'()*$+*,-5*$$*!<*!'#!<5%.5$/.50$!#)5M*$$*)5!/?*f!L/?)5..!,*$905*!#(!8,0+'K)*!<(!
)6.?*! 80'5.53(*C! 8,0+'K)*! #(! /R(,! ):)*! <(! <7+#.! *$.,*! /*%! <*(B! 8*$%*(,%! <(!
95$-.5K)*!%5K/'*@!
!
0%-%&54.&+
!S0(%!90(%!8,080%*,0$%C!*$!-(5%*!<*!/0$/'(%50$!<*!/*!<0%%5*,!.?7)#.53(*C!'#!
,*/*$%50$!<4($!<*%!<*,$5*,%!0(9,#-*%!8#,(%!<*!&'()*$+*,-C!/*''*!<*!'#'6)*5-$+%$,.'
()'!72,&&)@!
+
!

!
Copyright 2013 © Implications philosophiques – ISNN 2105-0864
C!
A1$$.3(%*
!
!
P$.,0<(/.50$!M!703'.#6*8#//3&)%(!E!!
&'()*$+*,-C!'*!)#'!/0$$(!1!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!g!
!
T$.,*.5*$!#9*/!4%&32*7(3%(I%3"%(*E!
N(.0(,!<*!&'()*$+*,-!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@!h!
!
A0,.,#5.!<*!_5..-*$%.*5$!8#,!&'()*$+*,-!M!J"32%*K.((1#'E!
N%8*/.%!<*!'#!8'(,590/5.7!/0$.,i'7*!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
1
/
56
100%