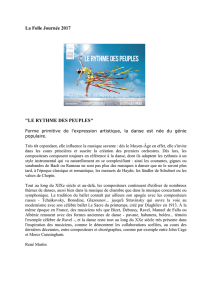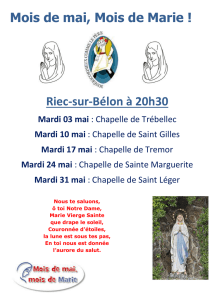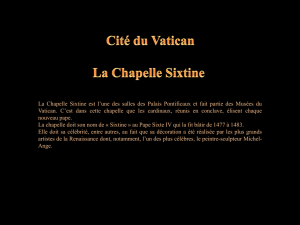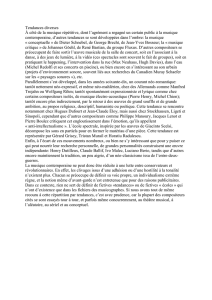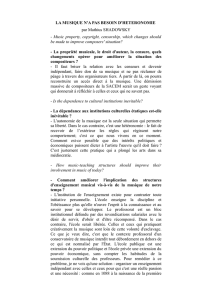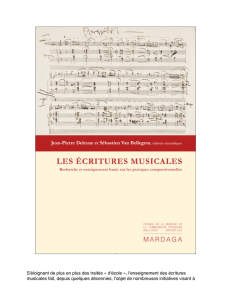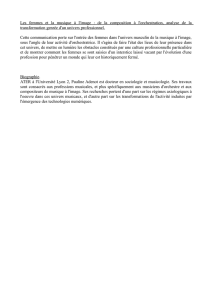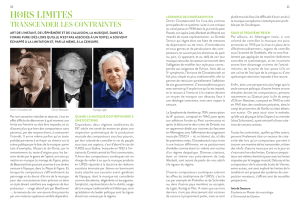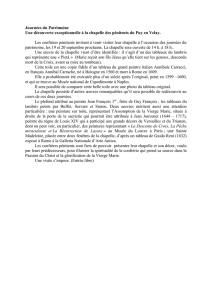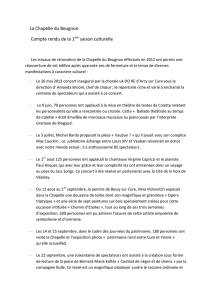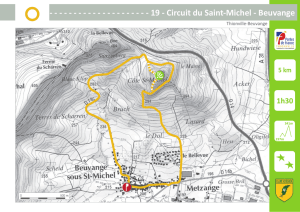Réforme extérieure et Contre-réforme

LA REFORME, LA CONTREREFORME
Les musiques qu'elles ont inspirées
II – Réforme extérieure et Contre-réforme
La réforme anglaise
Bien que la nature et les conditions soient tout à fait différentes de celles des réformes
appliquées en Allemagne et en France, la réforme anglaise ne peut être passée sous silence.
Henri VIII qui règne à l'époque où sont diffusées les idées nouvelles, n'est pas
insensible aux thèses de Luther, mais il n'en tire aucun parti dans l'immédiat.
On sait comment, dans l'espoir d'un hériter mâle, le roi d'Angleterre, négligeant les
interdits du pape, fut conduit à répudier Catherine d'Aragon qui ne lui avait donné qu'une
fille et comment il épousa Anne Boleyn. On sait aussi qu'il sut se soustraire à
l'excommunication et à l'interdit brandis par le pape en rompant avec Rome et en se
proclamant le chef de l’Église britannique.
Les réformes apportées par le roi ne seront évidemment pas sans conséquences sur la
musique religieuse. Mais appliquées davantage à l'organisation liturgique qu'aux dogmes,
elles ne provoqueront pas de grands bouleversements. Les compositeurs seront simplement
tenus d'user de la langue anglaise au lieu du latin et, plus tard, de pratiquer de nouvelles
formes musicales.
La difficulté majeure pour les musiciens consistera à s'adapter à l'instabilité affectant la
pratique religieuse. Après Henri VIII qui a imposé une autre conception du protestantisme,
son fils Édouard VII accentue la réforme dans l'église. Le court règne de 9 jours de Jeanne
Grey qui lui succède, sera vite oublié. En revanche le revirement opéré par Marie Tudor, la
demi-sœur d’Édouard VII sera mémorable : le retour au catholicisme est imposé et plus de
280 réformateurs engagés ou récalcitrants monteront au bûcher. Après son court règne de
cinq ans, sa demi-sœur cadette : Élisabeth Ière interdira le catholicisme et commencera à
structurer sérieusement la confession anglicane, cette autre voie du christianisme.
Les compositeurs, chanteurs et instrumentistes restent en place (par qui les remplacer
?). Mais il leur est demandé à chaque changement de se convertir, ce qu'ils feront en réalité
ou en apparence. En 1519, le « First Book of Common Prayer » (Premier Livre de la Prière
commune) fait autorité en fixant de façon définitive le cadre liturgique nouveau. Les
créateurs n'auront qu'à s'y conformer et produire des cantiques originaux, en particulier des
Psaumes.
Trois compositeurs appartenant à des générations distinctes illustrent cette période
musicalement remarquable, appelée non sans raison l'âge d'or anglais, une période qu'ouvre
John TAVERNER et qui culminera plus tard avec Henri PURCELL, une période enfin qui
ne se renouvellera malheureusement pas, sauf peut-être de nos jours avec Benjamin
BRITTEN.
L'essentiel de la carrière de John TAVERNER se déroule sous le règne d'Henri VIII
avant la rupture avec Rome. Son rôle consistera donc à enrichir le répertoire catholique de 8
Messes et de 23 Motets (œuvres composées sur un texte liturgique autre celui de l'ordinaire
de la messe).
Thomas TALLIS est certainement le maître de plus remarquable de la période de
trouble et d'hésitation dont il a été fait état. Compositeur et organiste il entre à la chapelle
royale où il servira successivement Édouard VI, Marie Tudor et Élisabeth Ière.
William BYRD, peut-être élève de TALLIS, en tout cas très lié avec son aîné, remplit

parfaitement ses fonctions à la chapelle royale sous Élisabeth Ière, mais il reste fidèle à sa
foi catholique et continue à écrire des œuvres en latin. Pour fuir la répression il se réfugiera
dans un petit village de l'Essex. Il meurt dans un quasi-anonymat alors qu'il a exercé a eu le
plus d'une énorme influence et que son œuvre est considérable.
Tallis
Byrd
Morceaux choisis
TAVERNER – Motet « Dum transisset Sabbatum » (
Lorsque le Sabbat fut passé
)
Un exemple de la maîtrise de l'écriture polyphonique à laquelle étaient parvenus au XVIe
siècle les compositeurs anglais qui n'avaient rien à envier à leurs confrères continentaux.
On trouve ici une alternance entre l'écriture contrapuntique et le plain-chant selon la
tradition continentale.
TALLIS – Hymne « O Lord in thee all my trust » (Ô Seigneur en toi est toute ma confiance)
Pour répondre à une exigence des réformateurs, afin de faciliter l'intelligence du texte, les
mêmes syllabes sont prononcées le plus souvent possible aux quatre voix, Cette disposition a
pris le nom d'écriture «
homophone
».
TALLIS – Tunes for Archibichop Parker's Psalter (Mélodies pour le psautier de l’archevêque
Parker).
Un exemple a cappella de parfaite écriture homophone.
BYRD – Motet « Ye sacred Muses
Déploration sur la mort de Tallis.
BYRD – Messe
Les présents Kyrie, Sanctus et Benedictus témoignent de l'exceptionnelle qualité des œuvres
de ce compositeur précurseur de PURCELL.

La situation aux Pays-Bas
Au XVIe siècle l'expression Pays-Bas désigne un conglomération de provinces
recouvrant ensemble correspondant à peu près au territoire de l'actuel Benelux. Son
caractère principal est un flagrant manque d'unité : linguistique (français, néerlandais, les
dialectes du flamand, l'allemand...), politique (les Pays-Bas du sud sont aux mains des
Espagnols). La dimension religieuse vient s'ajouter au XVIe siècle. La partie espagnole est
évidemment restée fidèle au catholicisme, alors que les Pays-Bas du nord encore appelés les
Provinces-Unies ont opté pour le calvinisme, un calvinisme appliqué dans toute sa rigueur.
D'autre part, les Pays-Bas constituent une véritable plaque tournante. Les catholiques
anglais persécutés par les anglicans viennent chercher refuge dans la partie espagnole. Les
protestant de cette même région, harcelés, vont chercher refuge dans les Provinces-Unies.
Enfin, ces dernières attirent les compositeurs allemands qui vienne se perfectionner auprès
du grand maître de l'époque l'organiste Jan Pieterszoon SWEELINCK.
On est organiste de père en fils dans la famille SWEELINCK, comme chez les BACH
ou les COUPERIN, à la Oude Kerk (la Vieille Église) d'Amsterdam. Mais alors qu'il achève
sa quatorzième années de bons et loyaux services, la paroisse se convertit au culte réformé
d'obédience calviniste dans ce qu'il a de plus rigoureux : abolition de l'usage des instruments
et de tout cantique autre que les Psaumes chantés à l'unisson et a cappella. Réduit d'une
certaine manière au chômage, Jan Pieterszoon n'a plus qu'à se reconvertir. Il écrit alors des
arrangement de Psaumes à usage domestique, des œuvres pour clavecin, il prodigue un
remarquable enseignement qui attire jusqu'aux étrangers. Comme son orgue n'a plus d'utilité
pour le culte, il invente la formule du jeu d'orgue en concert. De ce fait, il constitue un
nouveau répertoire en perfectionnant des formes venues de l'étranger : ricercar, fantasia,
toccata, prélude, partita-variations.
Sweelinck
La « Oude Kerk » d'Amsterdam
Morceaux choisis
SWEELINCK – Psaume 33 « Réveillez-vous chascun fidèle »
Les Néerlandais ont adopté les Psaumes de GOUDIMEL et de Pascal de l'ESTOCART dans
la traduction de Clément MAROT ordinairement chantés en France. Jan Pieterszoon
SWEELINK les reprend pour les transformer comme ici en somptueuse pièce de concert.
Après l'exposé du cantique à l'unisson , l'auteur intègre le thème dans un luxueux ensemble
polyphonique variant de 4 à 6 voix.

SWEELINCK – Fantasia in ecco pour orgue
Après un long développement d'une écriture dense d'une grande richesse polyphonique,
s'engage, joué sur deux claviers en alternance, l'exposé assez dévergondé d'un dialogue en
forme d'écho. L'écriture en écho connaîtra un grand succès jusqu'au XVIIIe siècle (Cf.
BACH – L'
Oratorio de Noël
).
L'Italie
Même s'ils n'apportaient pas leur caution aux idée de LUTHER les papes ne pouvaient
pas ignorer les problèmes soulevés par le réformateur. Réagir était pour eux d'autant plus
urgent que l' « hérésie » gagnait du terrain au moins en Allemagne et dans les pays
nordiques.
L'Espagnol établi à Rome Ignace de LOYOLA avait apporté sa pierre dans la lutte
contre les idées nouvelles par la création de la Compagnie de Jésus approuvée par Paul III.
Mais ce n'était pas suffisant. En 1545, s'ouvre le Concile de Trente chargé d'élaborer une
Contre-réforme. Il œuvrera dans des conditions difficiles : une durée de 18 ans pour un
travail en 25 sessions étendu sous 5 pontificats, des interruptions et deux déménagements
(Trente, Bologne, Trente de nouveau) à cause d'une épidémie de peste.
Les conciliaires s'emploieront à rejeter la plupart des idées de Luther et à préciser la
doctrine catholique sur les points importants : le problème de l'autorité, le sens de la messe,
la salut par les mérites, la mariologie et le culte des saints etc. Il est un point cependant sur
lequel les évêques n'étaient pas loin de rejoindre les impératifs de Calvin, à propos de la
place de la musique. Il s'en est fallu de peu que Rome n'adopte l'idée du rejet exprimé par le
réformateur en supprimant les œuvres polyphoniques et même la participation de l'orgue.
C'est le pape Marcel II et le musicien de sa chapelle privée Giovanni Pierluigi da
PALESTRINA qui ont sauvé la situation en montrant que la musique religieuse se détachant
des prétendus débordement antérieurs pouvait for bien être composée non pas « pour le vain
plaisir de l'ouïe, mais de manière que les paroles puissent être perçues de tous, de sorte que
les fidèles soient amenés au désir de l'harmonie céleste et de la béatitude des saints »,
comme le demandait la docte assemblée.
Alors qu'il remplissait à la satisfaction de tous les devoirs de sa charge de directeur de
la basilique Saint-Pierre, respectant scrupuleusement les directives de l'assemblée
conciliaire, PALESTRINA était loin de se douter que le pape Paul IV, le 4e pape du Concile
de Trente pousserait la rigueur contre-réformatrice jusqu'à révoquer tous les musiciens,
chanteurs et compositeurs s'étant mariés ou ayant écrit des œuvres profanes. Ce sera pour
PALESTRINA doublement concerné une traversée du désert de 16 ans. Réintégré à Saint-
Pierre de Rome il y achèvera sa carrière jusqu'à sa mort.
Morceaux choisis
PALESTRINA – Messe « Assumpta est »
Sélection : Kyrie, Sanctus et Benedictus
Ces fragment sont tout à fait représentatif du « novo modorum genere » (nouvelle
forme d'expression) imposé par le Concile par sa recherche de simplicité, la suppression de
tous les « effets » peu compatibles.

PALESTRINA – Motet « Hodie Christus natus est » (Aujourd'hui, Jésus est né)
Autre modèle de la pureté du style de l'auteur.
Palestrina
Victoria
Allegri
Nous aurons l'occasion de constater prochainement que même les églises romaines
sous l'influence des écoles florentine (créatrice de l'opéra) et vénitienne (culte de la
somptuosité) donneront libre cours à leur fantaisie, laissant les évêques à la ratiocinations,
pour le plus grand bien de la création musicale.
Mais on se doute que la règle sera suivie à la lettre à la chapelle pontificale et dans
l'entourage immédiat du pape où se retrouveront tous les affidés prêts à bien des sacrifices
pour un poste de choix. Ce qui n'enlève rien d'ailleurs à leur talent.
Thomás Luis de VICTORIA est un compositeur espagnol qui séjournera à Rome le
temps d’apprendre son métier et de se perfectionner avant de retourner dans son pays.
Morceau choisi
VICTORIA - Motet « O vos omnes »
Il s'agit d'un des 44
Motets
qu'il nous a laissés (avec 20
Messes
), composé sur un texte
emprunté au
Livre des Lamentations
de l'Ancien Testament. L’œuvre porte la marque de
l’influence palestrinienne. L'auteur y a toutefois imprimé sa personnalité et trouvé des
accents déchirants pour illustrer un texte se voulant déploration sur la ruine de Jérusalem
lors de la déportation des Hébreux à Babylone.
Grégorio ALLEGRI remarqué par Urbain VIII est devenu maître de chapelle de la
Chapelle Sixtine. Son œuvre la plus célèbre, un Miserere, s'inscrit dans la lignée des
compositions de Palestrina. L’œuvre est si belle qu'on lui pardonnera d'épouser le style
Renaissance un peu suranné, alors que triomphe déjà l'esthétique baroque.
Les dignitaires s'étaient opposés à la diffusion hors de la Chapelle Sixtine de ce
Miserere, sa propriété exclusive, menaçant d'excommunication toute personne qui
contreviendrait à cette décision. C'était sans compter sur l'extraordinaire faculté d'un gamin
surdoué de 14 ans : Wolfgang Amadeus MOZART qui sera capable, après deux auditions
seulement, d'effectuer de mémoire la notation de l’œuvre.
 6
6
1
/
6
100%