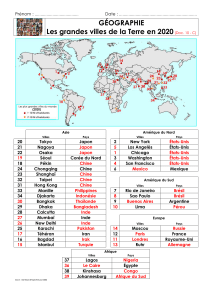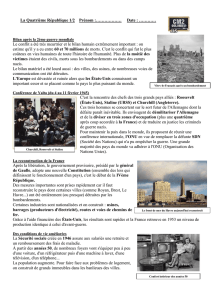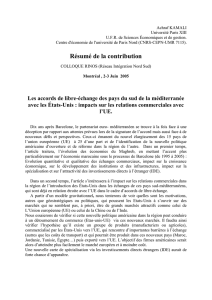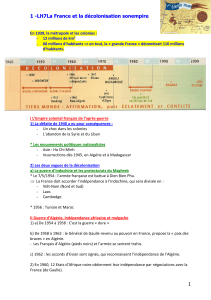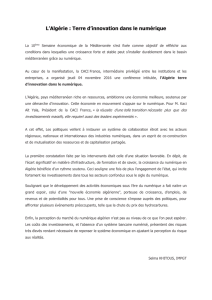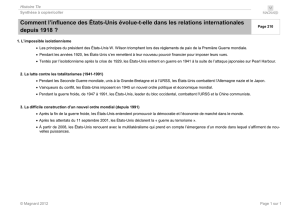Réviser son bac avec Le Monde

Term L, ES
L’ESSENTIEL DU COURS
• Des fiches synthétiques
• Les points et définitions clés
du programme
• Les repères importants
DES SUJETS DE BAC
• Des sujets et questions
types
• L’analyse des termes
• Les problématiques
• Les plans détaillés
• Les pièges à éviter
DES ARTICLES DU MONDE
• Des articles du Monde
en texte intégral
• Un accompagnement
pédagogique de chaque
article
UN GUIDE PRATIQUE
• La méthodologie
des épreuves
• Astuces et conseils
Nouveaux
programmes
À la MAIF, en tant que mutuelle d’assurance conçue par des enseignants, nous
sommes convaincus de cette priorité depuis longtemps. Alors nous agissons
aux côtés des parents et des enseignants pour favoriser l’éducation
des enfants. Nous savons que leur avenir dépend de ce que nous leur
aurons appris et des valeurs que nous leur aurons transmises. Voilà
pourquoi, à la MAIF, nous créons régulièrement des outils éducatifs qui facilitent
l’apprentissage de la lecture, de la culture ou de la sécurité routière. Et pour
s’engager davantage, la MAIF a créé le Fonds MAIF pour l’Éducation,
car favoriser l’accès à l’éducation pour tous aujourd’hui, c’est aider
à construire demain une société plus juste et plus responsable.
MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - 79038 Niort cedex 9. Filia-MAIF - Société anonyme au capital de 114 337 500 e entièrement libéré - RCS Niort : B 341 672 681
79076 Niort cedex 9. Entreprises régies par le Code des assurances.
AGISSONSPOURLEDUCATION.FR
220x280 boucliers Le Monde.indd 1 06/02/14 10:23
HORS-SÉRIE
Réviser son bac
avec
Hors-série Le Monde, mars 2014
3’:HIKPNE=YU\^U]:?k@a@a@n@f";
M 05344
- 3H -
F: 7,90 E
- RD

Avec la collaboration de :
Didier Giorgini
Cédric Oline
Mélanie Mettra-Geoffret
Sandrine Henry
Histoire Terminale L, ES
Une réalisation de
Réviser son bac
avec
En partenariat avec
© rue des écoles & Le Monde, 2014. Reproduction, diffusion et communication strictement interdites.

En partenariat avec
Complétez vos révisions du bac sur www.assistancescolaire.com :
méthodologie, fiches, exercices, sujets d’annales corrigés... des outils gratuits et efficaces
pour préparer l’examen.
Edité par la Société Editrice du Monde – 80, boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris
Tél : +(33)01 57 28 20 00 – Fax : +(33) 01 57 28 21 21
Internet : www.lemonde.fr
Président du Directoire, Directeur de la Publication : Louis Dreyfus
Directrice de la rédaction : Natalie Nougayrède
Dépôt légal : mars 2014
Imprimé par Maury
Achevé d’imprimé : mars 2014
Numéro hors-série réalisé par Le Monde - © Le Monde – rue des écoles 2014
AVANT-PROPOS
Depuis plus de soixante ans, le journal
Le Monde
analyse les grands événements et les grandes
évolutions du monde contemporain. Ses articles, rédigés par les meilleurs spécialistes, consti-
tuent une formidable ressource pour les historiens, les étudiants, mais aussi pour vous, candidat
au baccalauréat ! Dans cet ouvrage, vous trouverez toutes les clés de la réussite. Tout d’abord, de
quoi réviser en vue de l’épreuve : pour chaque chapitre, une synthèse du cours, accompagnée
des mots et notions clés ainsi que des dates essentielles. Ensuite, des sujets corrigés, qui vous
permettront de vous entraîner en appliquant les conseils prodigués dans les pages de méthodo-
logie. Des documents clés, textes et images, accompagnent chaque chapitre, vous pourrez les
confronter avec certaines des sources fondamentales pour les questions au programme. Enfin,
les articles constituent l’une des richesses de cet ouvrage et vous permettent une mise en pers-
pective du cours : ils l’approfondissent, en éclairent certains points, mobilisent les acquis en les
illustrant à travers un texte stimulant et pertinent. Et ils amènent un questionnement très forma-
teur pour apprendre à rédiger une problématique. Dans votre copie, vous pourrez ainsi exploiter
les connaissances et les exemples, différents de ceux du cours, tirés des articles. Par ailleurs, le
style de leur rédaction vous permet de vous familiariser avec une langue écrite riche et précise,
celle-là même que vous devez utiliser dans vos copies.
Le programme se focalise sur les grands enjeux du monde contemporain et est divisé en quatre
grands thèmes : le rapport des sociétés à leur passé ; idéologies et opinions en Europe de la fin
du XIXe siècle à nos jours ; puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre
mondiale à nos jours et les échelles de gouvernement dans le monde de la fin de la Seconde Guerre
mondiale à nos jours. Plusieurs questions sont proposées pour chacun de ces thèmes. Elles per-
mettent de solliciter les acquis des années précédentes pour mieux questionner l’histoire et com-
prendre le temps présent.
Les modalités de l’examen sont également passées en revue. L’épreuve se compose de deux
parties, l’une en histoire et l’autre en géographie : une composition, exercice obligatoire, et une
étude de documents, suivant une consigne donnée. Les sujets proposés dans cet ouvrage in-
tègrent le fait que, désormais, les sujets de composition peuvent reprendre tout ou partie des
intitulés des questions du programme en proposant, le cas échéant, de travailler sur une période
plus courte que celle étudiée en classe. On attend, dans ces épreuves, que vous mettiez en œuvre
des connaissances riches, développiez une argumentation qui, par son plan, réponde à une pro-
blématique, le tout en rédigeant de façon correcte.
Le présent ouvrage n’a d’autre but que de vous aider à préparer cette épreuve, en utilisant les
ressources du
Monde
, référence depuis maintenant plus d’un demi-siècle.
D. G.
© rue des écoles & Le Monde, 2014. Reproduction, diffusion et communication strictement interdites.

L’ESSENTIEL DU COURS
LE RAPPORT DES SOCIÉTÉS À LEUR PASSÉ p. 5
chapitre 01 – L’historien et la mémoire de la Seconde Guerre
mondiale en France p. 6
chapitre 02 – L’historien et les mémoires de la guerre d’Algérie p. 16
IDÉOLOGIES ET OPINIONS EN EUROPE
DE LA FIN DU XIXE SIÈCLE À NOS JOURS p. 25
chapitre 03 – Socialisme, communisme et syndicalisme
en Allemagne depuis 1875 p. 26
chapitre 04 – Médias et opinion publique dans les grandes
crises politiques en France depuis l’affaire Dreyfus p. 34
PUISSANCES ET TENSIONS DANS LE MONDE, DE LA FIN
DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE À NOS JOURS p. 41
chapitre 05 – Les États-Unis et le monde depuis les « 14 points »
du président Wilson (1918) p. 42
chapitre 06 – La Chine et le monde depuis 1949 p. 52
chapitre 07 – Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits
depuis la fin de la Première Guerre mondiale p. 60
LES ÉCHELLES DE GOUVERNEMENT DANS LE MONDE, DE LA FIN
DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE À NOS JOURS p. 69
chapitre 08 – Gouverner la France depuis 1946 :
État, gouvernement et administration.
Héritages et évolutions p. 70
chapitre 09 – Le projet d’une Europe politique depuis le congrès
de La Haye (1948) p. 78
chapitre 10 – La gouvernance économique mondiale
depuis 1944 p. 86
LE GUIDE PRATIQUE p. 93
SOMMAIRE
En partenariat avec
Complétez vos révisions du bac sur www.assistancescolaire.com :
méthodologie, fiches, exercices, sujets d’annales corrigés... des outils gratuits et efficaces
pour préparer l’examen.
© rue des écoles & Le Monde, 2014. Reproduction, diffusion et communication strictement interdites.

© rue des écoles & Le Monde, 2014. Reproduction, diffusion et communication strictement interdites.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
1
/
99
100%