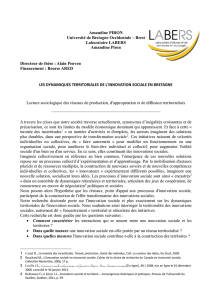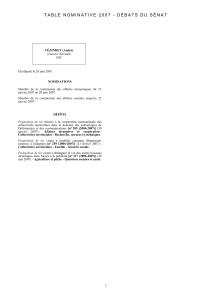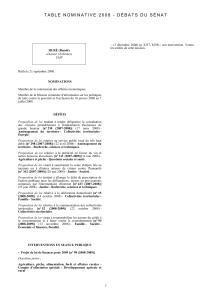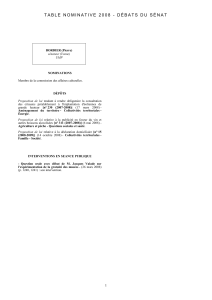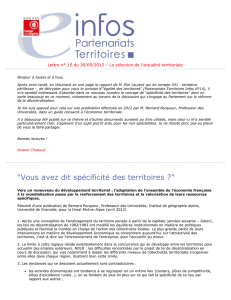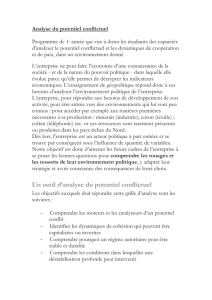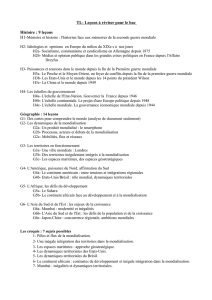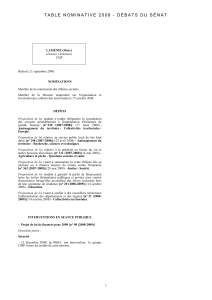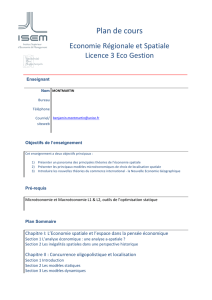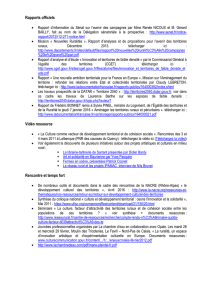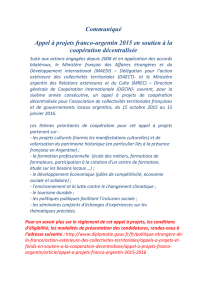Dynamiques territoriales et mutations économiques

FICHE DE LECTURE - "DYNAMIQUES TERRITORIALES ET
MUTATIONS ECONOMIQUES"
WAGALA ELODIE Mastère II COPTER / ISEAG 2011-2012
1
"Dynamiques territoriales et mutations économiques"
Sous la direction de Bernard PECQUEUR
(Edition de l’Harmattan, 1996) 246p.
SOMMAIRE:
Biographie
Questions posées
Postulats
Réponses apportées
Résumé
Commentaire critique
BIOGRAPHIE
Bernard Pecqueur docteur ès-sciences économiques de l’université de Grenoble 2 (1987) exerce actuellement ses
activités d'enseignement et de recherche au sein de l'Université Joseph Fourier de Grenoble. Ses domaines
d'intervention sont la géographie économique, l'analyse des processus de construction territoriale, le
développement local, l'économie territoriale et la révélation de ressources cachées (géographie culturelle et
analyse patrimoniale).
QUESTIONS POSÉES
Sous la direction de Bernard Pecqueur, cet ouvrage collectif, datant du milieu des années 90 est composé de
textes de 19 auteurs français comme étrangers. Il fait un état des lieux des réflexions de l'époque sur les
dynamiques territoriales et leur interaction sur la sphère économique à l’air du post-fordisme. Les Questions
transversales à l'ensemble des textes recueillis et coordonnés par Bernard Pecqueur pourraient se résumer à :
Comment dépasser la dimension descriptive jusque là accordée au territoire dans la réflexion
économique standard et le conceptualiser ?
Comment envisager l’articulation entre le local et le global sans tomber dans le localisme ou à contrario
l’idéalisation de certaines success-stories locales… ?
Comment envisager une modélisation et théorisation de l'économie spatiale à l'aune des nouvelles
théories économiques.
POSTULATS
Dans l’introduction de son livre, nous pouvons identifier une liste de propositions énoncées par Bernard Pecqueur
qui pourrait représenter autant de postulats (pp. 13-21 et qui peuvent se résumer en 4 axiomes :
1. Le territoire n’est pas qu’un lieu neutre sur laquelle se déroulent les fonctions économiques (B.Pecqueur).
2. Il existe une convergence entre l’économie spatiale et l’économie industrielle
3. L’univers de la production n’est plus peuplé d’agents mais d’acteurs qui par leurs actions et stratégies
plurielles vont interagir ensemble (Ponssard, 1994 et Kreps, 1990).

FICHE DE LECTURE - "DYNAMIQUES TERRITORIALES ET
MUTATIONS ECONOMIQUES"
WAGALA ELODIE Mastère II COPTER / ISEAG 2011-2012
2
4. L’espace devient le cadre d’émergence d’un acteur économique particulier, « le territoire ».
RÉPONSES APPORTÉES
Face à la difficulté de conceptualiser cette notion de territoire, B.Pecqueur propose de prendre comme
présupposé à cette notion celle de territorialité, car ce le lieu d’expression des comportements des acteurs qui
font le territoire où l’espace vécu est placé au cœur du développement. Et à B. Pecqueur de rappeler que ce sont
les dynamiques territoriales plus que le territoire qui interagissent avec les mutations économiques.
RÉSUMÉ
PREMIERE PARTIE - DE QUEL TERRITOIRE PARLE-T-ON?
Dans cette partie de l’ouvrage les auteurs font une sorte d'état des lieux de la littérature et cherchent à montrer
comment dans les faits empiriques, les différentes dynamiques territoriales s’appréhendent et se définissent.
Chapitre 1 : La tectonique des territoires : d'une métaphore à une théorisation
Dans sa métaphore « tectonique des territoires» Claude Lacour tient à mettre en exergue l’importance des
phénomènes longs et souterrains dont la nature n’est pas uniquement économique mais aussi culturelle, sociale
et politique. C’est en les considérants dans leur ensemble qu’ils permettent de mieux appréhender le " fait
économique territorial ". C. Lacour introduit également la dimension de temporalité ainsi que celle
d’intermédiation territoriale qui par le biais des institutions d’un genre nouveau favorise la rencontre des
trajectoires des acteurs qui le parcourent. Grace à cette notion l’auteur tire un trait d’union entre le local et le
global, Enfin en revisitant la notion de proximité, C. Lacour adopte l’analyse de Veltz et de ses territoires réseaux
par son analyse, C. Lacour libère le territoire de ses frontières spatio-temporelles, confirmant par ces multiples
facettes son caractère dynamique.
Chapitre 2 : Dynamique urbaine et développement régional : le cas d'une région de tradition industrielle
Olivier Crevoisier et Gilles Lechot vont illustrer les postulats avancés au chapitre précédent par l’exemple de l’Arc
jurassien et de l’interdépendance existant entre le développement du tissu économique et l’évolution des villes.
Sont tour à tour abordé les concepts de proximité, variété et accessibilité pour justifier ce qui a été appelé le
miracle jurassien... ainsi cette proximité au-delà de sa dimension spatiale est à la fois économique, socioculturelle
et permise par l’environnement urbain qui offrent cette concentration, tout comme pour la variété qui renvoie à
la diversité du tissu économique et l’accessibilité. La dynamique urbaine concoure ainsi à la construction d’un
véritable système territorial de production. Mais quand le contexte environnemental est peu favorable à ce
dynamisme, il convient d’envisager une mise en réseau efficace de ces villes telles que cela a été envisagé dans le
cas de l’Arc jurassien, afin de profiter de la complémentarité des territoires et des opportunités que chaque ville
présentait pour redynamiser le processus.
Chapitre 3: Efficacités collective: chemin de croissance pour la petite industrie dans les pays en développement
Ce chapitre traité par Hubert Schmitz cherche à observer la construction d’un développement économique basé
sur de petites entreprises dans les pays en développement à l’instar des grandes concentrations industrielles des
espaces urbains. Dans ces environnements particuliers de petites villes du Sud, H. Schmitz constate une variété
d’organisation allant des relations verticales entre une grande entreprise orchestrant la division du travail au sein
de ses sous-traitants à la relation horizontale entre petites entreprises en forte concurrence. Cette concurrence
que l’auteur substituera par le terme « de rivalité » n’est pas exempte d’échanges et de coopérations porteurs de

FICHE DE LECTURE - "DYNAMIQUES TERRITORIALES ET
MUTATIONS ECONOMIQUES"
WAGALA ELODIE Mastère II COPTER / ISEAG 2011-2012
3
performances économiques. Cette coopération qui se matérialise par le partage de connaissances, le prêt de
matériels, le partage de commande ainsi qu’une forte mobilité de la main d’œuvre disponible et interchangeable
est rendu possible grâce aux liens socioculturels qui permettent à la relation de confiance de s’installer et favorise
ainsi, l’efficacité collective et l’élévation de la qualité de production. L’exemple de l’industrie de la chaussure dans
la ville de Sinos au Brésil illustre bien ces systèmes et confirme bien le fait que l’émergence d’un tel système
localisé n’est pas le fruit d’une planification institutionnelle mais d’un processus endogène. L’institutionnalisation
de la coopération telle que les associations d’entreprises, les centres de services sont issus des initiatives privées
et la municipalité apparait dans un rôle d’assistance en mettant à disposition de ces entreprises, les espaces et
infrastructures nécessaires.
Chapitre 4 : La formation continue, ressource spécifique et facteur de dynamique.
Dans ce chapitre Maïten Bel, aborde l’intérêt de la formation comme facteur de dynamique. En effet, afin
d’accompagner et d’anticiper les changements techniques et organisationnels les entreprises soumises à la
concurrence doivent maintenir un haut niveau de connaissance et de compétence de ses employés, facteurs de
mobilité. Pour se faire une offre de formation doit émerger et s’organiser sur le territoire. Cependant, si le
marché de la formation continue est le fait d’acteurs privés, afin de permettre l’expression du besoin par les uns
et la réponse adéquate par les autres, Maïten Bel suggère aux collectivités territoriales de créer une structure
dont l’objectif premier sera de favoriser, accompagner et développer les relations entre les différents acteurs.
L’organisme interface va ainsi favoriser la construction de la relation entre offreurs de formations et demandeurs.
En régulant efficacement le système territorialisé de formation.
Chapitre 5 : Les districts industriels revisités
Dans le dernier chapitre de cette partie, Georges Benko, Mick Dunford et Alain Lipietz passent en revue de
manière critique les travaux dont ils disposaient à l’époque sur les systèmes localisés industriels. De la genèse des
travaux de conceptualisation en Italie aux développements contemporains. Les premières critiques qu'ils
avancent portent sur la vision statique qu'ont les principaux théoriciens sur le développement de ces districts. Du
fait du développement des firmes, le district mue dans le temps. Enfin l'idée de voir dans les districts un modèle
général de réorganisation économique a perdu depuis de sa pertinence. Et baser le modèle des districts sur le
postulat de coopération entre firmes du fait de leur proximité n'est plus non plus défendable, par les nombreux
exemples énoncés par G. Benko, M. Dunford et A. Lipietz la crise et la concurrence ont vite fait de mettre à mal
cet immuable relation de rivalité-coopérative d'autant plus que par les processus de développement et de rachat
de certaines grosses firmes, la relation de confiance du fait de la proximité socio-culturelle n'a plus lieu et la
relation horizontale si chère à nos théoriciens des districts industrielles tant à se transformer en une relation
verticale entre grandes firmes leaders répartissant le travail auprès de leurs sous-traitants... de même à G. Benko,
M. Dunford et A. Lipietz de démontrer les limites de la spécialisation flexible qui était facteur de réactivité au sein
de ces districts. L'évolution technologique difficilement supportable par les petites entreprises est le fait des
grosses firmes et nécessite donc le recours à la concentration. Cependant c'est en termes de gouvernance que les
systèmes productifs locaux ont eu un intérêt et une influence manifeste selon les auteurs. Le rôle des institutions
sur les dynamiques territoriales se révèle alors.

FICHE DE LECTURE - "DYNAMIQUES TERRITORIALES ET
MUTATIONS ECONOMIQUES"
WAGALA ELODIE Mastère II COPTER / ISEAG 2011-2012
4
DEUXIEME PARTIE - NOUVELLES VARIABLES, NOUVELLES DYNAMIQUES
Dans la seconde partie de l'ouvrage sont passées en revu les tentatives de théorisation de l'économie spatiale ainsi
que les différents modèles utilisés pour conceptualiser la dynamique spatiale.
Chapitre 6 : Les nouveaux chantiers de la théorie économique spatiale
L’auteur dans cet article partant du fait que dans le cadre de la théorie spatiale, l'équilibre général walrassien est
dépassé et ne peut constituer une base à la modélisation spatiale et que la complexité des phénomènes observés
en économie spatiale ne peut être représentée. Il faut avoir recours à d'autres hypothèses qui permettront au
mieux de cerner et modéliser les phénomènes empiriques observés. L'introduction du temps et de l'espace ne
permet plus de stabiliser l’équilibre car les procédures d'arbitrage perdent de leur rationalité (Fischer, 1990). Ainsi
le champ de l'économie industrielle serait plus proche de la théorie de l'économie spatiale. De Hotteling revisité
par J.F Thisse, D'Aspremont et Gabsewich, par la théorie des coûts de transport non-linéaire pour justifier la
localisation des firmes le long d'une route linéaire, à la théorie des jeux répétés d'Axelrod (1992) en situation de
dilemme du prisonnier pour justifier la coopération dans une structure de jeu non coopérative en passant par les
automates cellulaires de Schelling pour illustrer la ségrégation spatiale et la séparation des modes d'usages et la
spécialisation économique selon White (1993). Par le mécanisme de voisinage recherché et d'incompatibilité de
proximité, le territoire se décline. Mais André Larceneux relève là un aspect déterministe de l'automate cellulaire
qui rentre en contradiction avec le choix stratégique de l'acteur économique de la théorie des jeux.
Chapitre 7 : Apprentissage organisationnel et dynamiques territoriales: une nouvelle approche des rapports
entre groupes industriels et systèmes locaux d’innovation
Claude Dupuy et Jean-Pierre Gilly, dans cet article développent 2 analyses afin de permettre une meilleure
compréhension des dynamiques industrielles et territoriales autrement dit de la théorie de la dynamique
industrielle localisée (système locaux d'innovation, districts,...). Les auteurs nous rappellent la nécessité de
connecter cette analyse à celle de la proximité. Le territoire, en effet, produit d’une proximité géographique et
culturelle résulte du partage d’une convention qui requiert un processus d’apprentissage collectif, au travers des
relations multiples de coopération entre organisations productives, techniques, institutionnelles. Cette proximité
favorable à l’émergence d’interactions étroites entre les agents, firmes, décideurs diffuse plus vite le progrès
technique et l’information pertinente. Les acteurs sont ainsi dire, « …inscrits dans un processus productif et
cognitif des taches… par effet de proximité territorial » Or l’autonomie d’action d’une unité de production d’une
grande firme est toute relative, selon C. Dupuy et J.P Gilly, elle ne peut nouer des relations avec des entreprises
extérieures, y compris des entreprises « voisines » installées sur son territoire. « Plus une unité est intégrée
décisionnellement et industriellement au sein de son groupe et moins elle est ouverte sur son environnement »
et inversement…
Chapitre 8 : Technologie, institutions et territoires: le territoire comme création collective et ressource
institutionnelle
Lahsen A bdelmalki, Daniel Dufourt, Thierry Kirat et Denis Requier-Desjardins nous décrivent un territoire
«régulationniste », lieu où s’élaborent une partie des compromis institutionnalisés en relation étroite avec ceux
élaborés au niveau central. Il devient un espace de création collective de formes d’organisation et de relation
entre les acteurs pouvant conduire à la mise en place d’institutions adaptées. Ainsi, « la coordination des activités
économiques est, par nature, un phénomène institutionnel. » Les auteurs distinguent d'une part les institutions
informelles (les coutumes, normes, règles et toutes les formes de représentations collectives) qui façonnent les
modes de pensée et d'action collective et homogénéisent les comportements et garantissent le fonctionnement
du système économique ; d'autre part les institutions formelles, composées d'acteurs de l'administration

FICHE DE LECTURE - "DYNAMIQUES TERRITORIALES ET
MUTATIONS ECONOMIQUES"
WAGALA ELODIE Mastère II COPTER / ISEAG 2011-2012
5
publique, qui non seulement ont une fonction cognitive mais agissent aussi structurellement sur les agents
économiques, en ce sens qu'elles stabilisent les relations économiques et sociales du système en enlevant une
partie de l’incertitude.
Chapitre 10 : SUR LA COMPOSANTE TERRITORIALE DES PROCESSUS D'APPRENTISSAGE COGNITIF COLLECTIF
Dans ce chapitre Bernard Pecqueur aborde la question du territoire mémoire du processus d'apprentissage, de
même nature que les règles et les conventions. L'hypothèse à tester vise à montrer que la décision est
"interdépendante" (J.P. Ponssard, 1994) du fait de la rationalité limitée des individus qui par leur choix
stratégiques interagissent les uns sur les autres. De cette interdépendance va découler un processus cognitif
conduisant à la convergence des stratégies. Cette convergence se fait vers un point focal, au sens de T.C. Schelling
(1960) et s'inscrit dans un système de représentation situé et borné spatialement dans des espaces construits.
Après avoir précisé le cadre théorique dans lequel s'est posée la question de la convergence vers le point focal, à
travers les notions de décision interdépendante et de références communes, Bernard Pecqueur propose une
application au territoire des procédures cognitives collectives engagées par les acteurs économiques.
COMMENTAIRE CRITIQUE
La prise en compte des facteurs locaux au cœur des dynamiques économiques nous apparaît aujourd’hui comme
une évidence. A l’époque de cet ouvrage collectif, nous en étions aux prémices… Les facteurs endogènes, ignorés
jusque là de la théorie économique étaient désormais pris en compte, le territoire n’est plus économiquement
neutre. On peut apprécier la richesse des approches qui intègre les apports de la géographie, de la sociologie, et
des sciences de la cognition sortant ainsi des frontières étroites de l’économie.
Cependant, il a fallu passer par certaines approches aujourd’hui critiquées, que ce travail de réflexion collectif
essaye de nous faire appréhender et dépasser. Sont ainsi rappelées les premières générations d’approches et de
tentatives de conceptualisation des systèmes territorialisés.
Il s’agit des :
• Systèmes productifs localisés,
• Milieux innovateurs,
• Districts industriels.
Ces approches référant aux phénomènes de dynamiques territoriales défendent l’idée qui prévalait dans les
années 80, qu’il existe une dynamique endogène aux systèmes économiques permettant aux acteurs d’un
territoire d’influer sur leurs trajectoires de développement, dans un contexte de crise économique. Le territoire
devient alors « acteur » et contribuerait par ce fait aux dynamiques territoriales. Ainsi les phénomènes de
concentration spatiale évoqués par la théorie standard et observés trouveraient là leur explication,
« l’agglomération spatiale est expliquée par l’agglomération ».
Ces tentatives pour définir une nouvelle organisation post-fordisme de l’économique à partir d’idéaux-types de
développement territorial, vont connaître un fort succès durant la décennie 80 avant de rencontrer de vives
critiques. En effet, les succès mitigés de certains projets de développement territorial inspiré des districts
industriels ont démontré que les approches en question n’étaient pas des modèles applicables à tous les
contextes économiques et qu’ils ne constituaient pas des modèles de réussite fonctionnant systématiquement.
D’autres approches vont voir le jour, parmi lesquelles l’approche en termes de proximité, largement reprise
aujourd’hui dans cet ouvrage.
 6
6
1
/
6
100%