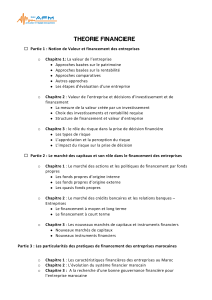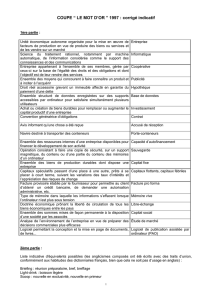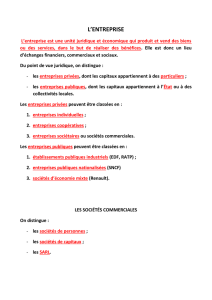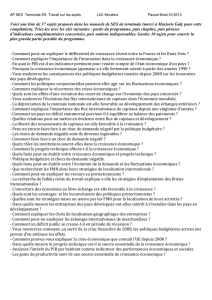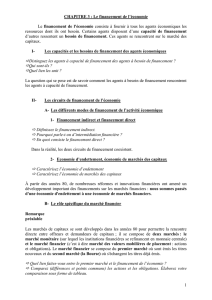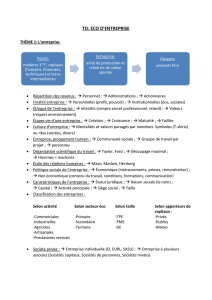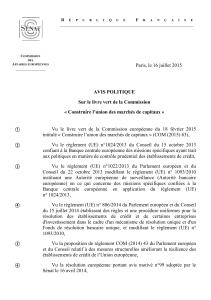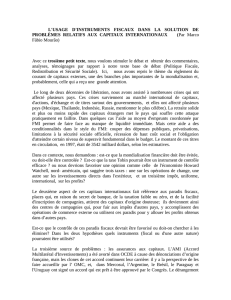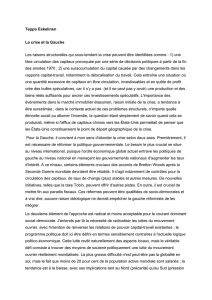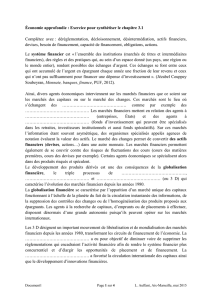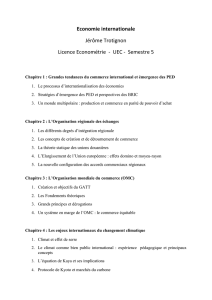II.Conventions autres que celles de portée universelle

Cours de droit international économique
L’immobilisation de certains facteurs de production
Sous-titre 1 : l’établissement de l’investissement
Il s’agit de savoir comment le DIE appréhende les deux principaux facteurs de production : le travail et le
capital. Pour ce, on s’intéresse aux mouvements des personnes et des capitaux au niveau international.
Existe-t-il des règles de DIE qui régissent le mouvement international des travailleurs et des capitaux ?
Chapitre 1 : Les mouvements internationaux de travailleurs
Le droit international pose-t-il des principes régissant les mouvements des personnes, des travailleurs ? Non
car la souveraineté reste le principe maître dans les rapports internationaux. Tout Etat est et demeure libre
d’accueillir ou non sur son territoire des travailleurs étrangers hors l’existence d’une convention internationale
d’effet contraire.
Par conséquent, le pouvoir souverain de l’Etat lui confère le droit de réglementer l’entrée et le séjour sur son
territoire des étrangers et, par suite, des travailleurs. Ce droit souverain s’exerce pleinement et entièrement
sauf convention contraire.
Cependant, le droit international général, et plus particulièrement le DIE, pose quelques principes qui vont
régir la condition juridique des étrangers une fois ceux-ci admis dans un territoire. Ces principes figurent au
sein de standards internationaux sur la condition des étrangers.
Un standard est un principe rencontré dans un domaine du droit insuffisamment consolidé qui va permettre
au juge d’apprécier si le comportement des titulaires de droits est bien conforme à ce qu’il devrait être. C’est
un instrument de mesure permettant au juge de dire si ledit comportement est conforme ou non au droit.
Ainsi, à défaut d’une règle de droit pré-établie dans un système donné pour un comportement donné, le
standard permet d’apporter les bases à l’établissement d’un système voire à la consolidation d’un système
existant.
En DIE, le standard retrouve sa place car c’est un système mal consolidé. Toutefois, un standard existe sur la
condition des étrangers : le standard du traitement juste et équitable (TJE). Or, au moyen de la notion même de
standard, nous sommes face à une contradiction ; en effet, si le standard doit être conforme au droit, c’est qu’il
existe un droit, donc pourquoi ne pas l’appliquer ?
Ainsi, l’appellation « standard » peut ne pas paraître exacte (mais ceci est dû à la traduction anglaise « fair &
equitable » qui devrait être « loyal et équitable »). Par exemple, dans la Sentence Arbitrale affaire Metalclad
(Etats-Unis-Mexique) les arbitres ont précisé que « le défaut de transparence dans les réglementations
applicables à l’investissement étranger constitue un délit au traitement juste et équitable ». On peut donc
considérer que le standard traduit une étape transitoire du droit, c’est le droit en formation. Mais dans la
condition des étrangers, le standard continue de s’appliquer en attente d’une éventuelle loi ou convention.
Le TN doit-il être juste et équitable pour les étrangers ? Pas forcément ; en effet, le TN peut être en dessous
de l’exigence internationale, mais le droit international a pour essence de corriger le droit national afin qu’il
réponde aux exigences du droit international. Ainsi, à défaut, l’étranger doit être traité de façon différente pour
répondre à l’exigence du TJE.
Le traitement préférentiel de l’étranger n’est pas contraire au droit international, il peut même l’exiger dans
le dessein de faire respecter le principe du TN. Par conséquent, le principe du TNPF ne peut être un PGDI
mais seulement un principe conventionnel.
Symétriquement, un traitement différentiel est-il contraire au droit international ? Non car il peut satisfaire le
standard du TJE, sauf dans un cas : quand il est discriminatoire.
Ainsi, au moyen de le principe de souveraineté, l’Etat peut librement choisir d’accueillir ou non sur son
territoire des travailleurs étrangers, en l’absence d’engagement conventionnel. Toutefois, l’Etat d’accueil est
tenu d’observer certaines règles de comportement envers le travailleur étranger en séjour sur son territoire et
lesdites règles doivent satisfaire au standard du TJE. Face à une convention internationale, la donne est autre…

I.Les conventions de portée universelle
Il y en a peu car la libre circulation des travailleurs est moins souhaitée que pour les échanges commerciaux
et financiers ; en effet, les impacts et les effets sur le marché intérieur d’un Etat sont autres selon les situations,
les marchés.
Par exemple, les réticences de l’UE à l’entrée de la Turquie, outre les motifs d’ordre économiques et
politiques (la Turquie ne constitue pas un Etat de droit etc.), sont aussi dues au fait que la Turquie constitue
une manne de main d’œuvre bon marché et laisse entrevoir le risque d’une forte immigration, en Allemagne
notamment.
Aussi, bien que les conventions OIT prévoient l’octroi de certains droits, elles n’organisent pas pour autant
la libre circulation des travailleurs.
Actuellement, une discussion est en cours au sein de l’UNESCO sur la diversité culturelle. Actuellement, les
Etats se trouvent fondus dans un système où se profile le risque d’une uniformité culturelle, dont le risque
provient de l’AGCS (Accords de Marrakech, 1995), du moins pour partie, car ce dernier n’a pas fini de
souligner ses effets.
Au sein de l’OMC, il existe un principe dit de « l’exception culturelle », qui ne figure pas textuellement au
sein des Accords de Marrakech, par lequel certains Etats dont la France ont fait comprendre qu’ils ne
comptaient pas faire d’offre de libéralisation en matière d’industrie culturelle, notamment dans le cadre de
l’AGCS. Mais force est de constater qu’au bout de 10 ans la situation est tout autre…
Une uniformité culturelle, souhaitée par les Etats-Unis, entraînerait la disparition de toutes les autres cultures
(des négociations de l’AGCS seraient souhaitables pour éviter cela, mais ce n’est pas à l’ordre du jour).
Chaque Etat lutte avec les armes dont il dispose pour se protéger du rouleau compresseur culturel américain et
fait jouer cette exception pour permettre l’imperméabilité de son industrie culturelle.
L’AGCS couvre tous les services, à l’exception des services gouvernementaux (voir cours semestre 1), et
prévoit que doit être assurée leur libre mode de prestation sous couvert de 4 critères :
déplacement
consommateur
fournisseur
présence permanente du fournisseur auprès du consommateur
La dernière condition correspond à la présence commerciale du prestataire ou de son représentant, ce qui
entraîne la liberté de déplacement des personnes et de l’investissement, et constitue un risque minimum
d’uniformisation culturelle.
L’annexe à l’AGCS prévoit qu’il « ne s’applique pas en principe aux personnes physiques qui cherchent à
accéder en général au marché du travail d’un Etat (l’AGCS assure la libre circulation des personnes quand
elle est nécessaire à la libre circulation du service) ni aux mesures concernant la citoyenneté et la
résidence » (une activité de service doit s’exercer pour la mise en œuvre de l’AGCS) ;
Dès lors que des personnes physiques fournissent des services ou sont salariées d’un prestataire de service,
l’AGCS s’applique (encore faut-il que les services proposés soient libéralisés par l’Etat où ils sont proposés) ;
autrement dit, l’AGCS vise plus particulièrement les prestataires de services que les activités salariées, les
employés de ces mêmes prestataires.
C’est la libre circulation des prestataires de service et non de tous les travailleurs.
II.Conventions autres que celles de portée universelle
Elles peuvent être de caractère interrégional, comme celles de l’OCDE, ou intrarégional comme le TCE. Ces
conventions restent peu prolifiques car même si elles organisent la libre circulation des travailleurs, il n’en
demeure pas moins qu’elles le font en fonction du but et de l’objet du traité.
Ainsi, le TCE institue une UEM, qui repose sur l’idée de libre circulation telle que reflétée dans l’AUE,
c’est-à-dire l’instauration d’un marché intérieur (commun) sans frontières, où circulent librement les
marchandises, les personnes (travailleurs salariés) et les capitaux, qui constituent les libertés fondamentales du
traité. La caractéristique essentielle du TCE est donc la liberté d’établissement et de prestation de services.
La libre circulation des travailleurs a été établie par des règlements alors que la liberté d’établissement et de
prestation de services le fut par des directives. C’est une intégration poussée car la plupart des intégrations
régionales se limitent, comme l’Association de Libre-Échange Nord Américain (ALENA), à la libre
circulation des marchandises et services. C’est un.

L’ALENA ne s’intéresse qu’indirectement à la libre circulation de certaines catégories de personnes et dans
le cadre de l’investissement essentiellement (« doit être autorisée la libre circulation des personnes à
condition qu’elle permette la bonne marche du service, de l’opération d’investissement »).
En effet, l’investissement doit être profitable à l’Etat de territorialité ; en effet, ce dernier demande à ce que
l’investissement étranger sur son territoire crée des emplois et, par la suite, à ce que la libre circulation des
personnes ne soit pas érigée en obligation conventionnelle (auquel cas les investisseurs pourraient recruter du
personnel originaire du pays d’où provient l’investissement, et non des locaux).
Ainsi, un compromis a été formé dans l’ALENA : il y a libre circulation pour les « business personn »
(hommes d’affaires qui apportent le capital) et les « professionnals » (les professionnels, c’est-à-dire les
personnes titulaires d’une formation acquise dans le pays d’origine de l’investissement) du fait que ceux-ci
pourraient difficilement être remplacés par des personnels recrutés sur place. C’est le droit à la libre
circulation.
Dès lors qu’on parle de libre circulation des services, on en revient à la liberté d’établissement et
d’investissement, les trois étant indissociables. L’ALENA se limite essentiellement à la libre circulation des
capitaux, donc constitue quasi-exclusivement un accord commercial.
On trouvait certaines dispositions similaires dans le traité sur la charte de l’énergie. C’est un traité
d’intégration sectorielle, qui régirait tous les aspects de la recherche, de l’exploration, de l’exploitation, du
transport et de la commercialisation des sources d’énergie. S’y greffe le traité complémentaire au traité sur la
charte de l’énergie.
Dans ce traité, l’occident devait apporter les capitaux et les orientaux les champs pétrolifères. Il devait y
avoir une intégration en la matière, les occidentaux étant libre d’investir dans ces gisements. Les Etats-Unis se
sont vite retirés du traité car la Russie avait exigé qu’il s’étende à toutes les sources d’énergie, ce qui lui aurait
permis d’investir dans le nucléaire américain (ce qui n’était pas admis par les Etats-Unis).
Ce traité Charte Energie permettait à l’occident d’investir dans la Caspienne et prévoyait, par la suite, un
certain degré de libération de mouvement de personnel, pour la réalisation de l’investissement (« key
personnel », celui qui sait faire fonctionner l’investissement).
Tant dans l’ALENA que dans le traité Charte Energie, le principe de libre circulation pour le bon
fonctionnement de l’investissement est limité matériellement, c’est-à-dire ne peut aller au-delà du champ
prévu par la convention).
Les conventions régionales restent donc modestes, à l’exception des véritables intégrations économiques
(qui se caractérisent par la libre circulation de tous les facteurs de production, y compris les travailleurs), ce
qui permet de différencier l’ALENA et assimilés du TCE.
III.Les accords bilatéraux (Bilateral Investment Treaties)
Il en existe de multiples, dont le recensement est difficile (2000 selon le CIRDI), que l’on peut ranger en 2
catégories :
-les Traités Bilatéraux sur la condition des étrangers (TBCE)
-les conventions bilatérales sur la promotion et la protection des investissements (CBPPI).
A)TBCE
Il y en a deux sous-catégories :
-Les TB sur la police des étrangers (police de l’entrée et séjour des étrangers).
-Les conventions d’établissement (traités sur les droits des étrangers)
Les premiers sont anciens et n’ont plus tellement cours au sein de l’Europe. Les traités d’immigration en
sont la forme la plus élaborée, par lesquels deux Etats s’accordent sur la limitation des flux migratoires,
émigration et immigration (exemple : Accord France-Algérie de 1968).
Les seconds, à ne surtout pas confondre avec les premiers, sont des conventions internationales entre Etats
souverains qui ne touchent pas à l’entrée ni au séjour des étrangers mais définissent les droits de ces derniers,
en séjour régulier sur le territoire de l’une ou l’autre des parties contractantes. C’est le noyau dur du droit de la
condition des étrangers. C’est essentiellement un droit conventionnel.
Ainsi, par exemple, l’art.11, CC pour la France, précise les conditions d’établissement des étrangers en
France, qui sont organisées selon 2 grands systèmes : la réciprocité (« L’étranger jouira des droits civils en
France dans la mesure où les français en jouissent dans l’Etat où l’étranger est ressortissant ») et le TN
(l’étranger bénéficie du TN réciproque et non du traitement dont celui-ci est organisé dans son pays d’origine.
Cette seconde conception est abandonnée car est difficile à mettre en œuvre du fait qu’il faut déterminer
chacun des éléments de la législation civile si elle a son pendant dans celle de l’autre Etat).

L’étranger bénéficie des droits civils reconnus aux nationaux, en général.
B)CBPPI
C’est le symétrique des accords commerciaux qui induisent l’établissement et l’investissement. Ces accords
ne permettent pas aux nationaux de circuler librement car dans la plupart des instruments conventionnels,
chaque partie contractante est libre d’admettre ou non sur son territoire les investissements de l’autre partie
contractante.
Aussi, dans la plupart des CB, on trouve une disposition spéciale selon laquelle quand un investissement est
autorisé, l’Etat où il est constitué facilitera l’obtention des titres d’entrée, de séjour et de travail. Mais la
facilitation n’est toutefois pas une obligation de délivrance (l’Etat conserve la maîtrise du flux migratoire).
Par conséquent, la libre circulation des travailleurs est la parente pauvre du DI car elle soulève des
problèmes (risque de déséquilibre économique, dégradation du marché du W, risque politique…). L’Etat
souverain n’est pas disposé à traiter de ces problèmes en profondeur, donc la maîtrise des flux migratoires
reste sa principale arme.
Chapitre 2 : Les mouvements internationaux de capitaux
La notion de mouvement de capitaux est une notion que le DIE ne définit pas. Il y a une pluralité de
définitions due à la pluralité de législations.
Les mouvements de capitaux couvrent 2 sortes de mouvement :
-les mouvements à court terme (ou placement)
-les mouvements à long terme (ou investissement)
Les deux s’opposent à un troisième type de mouvement : le payement courant.
Il existe deux sortes de payements internationaux : le payement courant et le payement autre que courant, qui
recouvre le placement et l’investissement.
Un payement courant est un payement lié à des opérations courantes, qui sont les opérations du commerce
international (opérations d’importation, d’exportation et de prestation de services à caractère international).
Par exemple, un importateur règle une facture d’importation à un fournisseur étranger.
En revanche, l’achat de valeurs mobilières (VM) à l’étranger constitue un payement non courant ; en effet,
elles constituent un avoir à l’étranger, à la différence des opérations d’achat et de vente de marchandises.
Ainsi, la principale distinction entre les opérations courantes et non courantes est que le payement relatif à
l’opération courante n’aboutit jamais à la constitution d’un avoir à l’étranger. Mais la distinction est parfois
difficile à établir.
Il existe donc trois types de payement internationaux : les payements courants (liés à des opérations
courantes) ; les payements autres que courants (liés à des opérations aboutissant à la constitution d’un avoir à
l’étranger) ; les payements courants liés à des opérations de capital.
On a coutume d’opposer la réglementation de changes (opérations courantes) à celles des mouvements de
capitaux (sur le placement des investissements). C’est une vision fausse car la réglementation des changes
s’applique à tout payement International relatif à des opérations courantes ou autres que courantes. Mais il est
vrai que la réglementation des mouvements de capitaux ne vise que les seules opérations autres que courantes.
I.La réglementation des changes
C’est l’ensemble des règles de droit interne régissant les payements, règlements et transferts à caractère
international. La réglementation est nécessaire car tout Etat, pour assurer sa viabilité économique, doit assurer
l’équilibre de sa balance des payements (BP). Le déséquilibre aboutit à une spirale déflationniste (BP
déficitaire) ou inflationniste (BP excédentaire) pour les pays concernés par les échanges.
Le moyen pour éliminer les déficits est la mise en place d’une réglementation des changes. Elle a pour objet
de soumettre au contrôle des autorités publiques tous les payements à destination de l’étranger. Ainsi, par ce
contrôle, on pourra freiner les sorties et rétablir l’équilibre de la balance des payements.
Toute réglementation des changes repose sur des principes fondamentaux :
-l’intermédiation (tous les payements entre le territoire national et l’étranger, ou à l’intérieur du territoire
national entre un résident et un non résident, doit être effectué par un intermédiaire agréé (une banque ou un
agent agréé du ministère de l’écofi). Si la BP est déficitaire, il faut aussi contrôler les rentrées car ce qui rentre
peut avoir été irrégulièrement sorti.

-l’interdiction de constituer des avoirs à l’étranger (en période de défiance contre la monnaie, la cause du
déficit de la BP est la perte de confiance des résidents dans la monnaie nationale. Donc, intéressement à
l’étranger et sortie d’avoirs pour les placer à l’étranger et constituer des avoirs à l’étranger. Mais les interdire
est une chose, comme interdire tout payement à l’étranger est autre. Si on fait ça, il n’y a plus d’activité
économique)
-l’autorisation des payements courants à l’étranger (cf. le principe de rapatriement, par lequel le titulaire
d’avoirs à l’étranger doit pouvoir les rapatrier en cas de cession).
Il ne faut pas confondre réglementation des changes avec celle du marché des changes (lieu où se
confrontent l’O et la D des monnaies). La première vise seulement l’opération de transfert de payement
international et la seconde les devises.
En principe, le marché est unique et libre d’accès. Toutefois, si la BP est en déficit, la réglementation du
marché des changes peut être un moyen de rétablir l’équilibre. Par exemple, en utilisant la technique du
marché de la devise-titre (en 1982, la principale cause de sortie des devises de France résultait de l’acquisition
de VM à l’étranger. En conséquence, on avait le choix entre réglementer les changes en interdisant le
payement des VM & ne pas interdire l’achat mais en finançant en $ les valeurs US que l’on veut acheter, en se
fournissant auprès d’un contrepartiste, qui est une personne qui achète des $ et les vend). Les $ doivent être
utilisés pour l’acquisition de VM aux Etats-Unis).
En conséquence, beaucoup de personnes ont voulu acheter des VM à New-York, mais peu ont voulu vendre
car le franc baissait et le $ en augmentait. Donc, il y eut un déséquilibre car les résidents qui demandaient des
$ furent nombreux et les contrepartistes peu.
Ainsi, le prix des VM en $-titre monta car les acquisitions et cessions se trouvaient cloisonnées dans un
marché étroit : la devise-titre où les VM cotées en devises-titre l’étaient plus que les valeurs commerciales.
A terme, lors du rétablissement des équilibres économiques, les résidents ont voulu acheter des VM en
France. Donc la demande de $-titre a baissé et l’offre augmentée. Donc, O = D et la valeur du $-titre a diminué
pour se rapprocher du $-commercial.
A cet égard, le droit communautaire diffère du droit de la finance internationale.
II.Les textes régissant en DIE les mouvements de capitaux
Les textes à portée universelle sont quasi-inexistants, si ce n’est les statuts du FMI (issus des Accords de
Bretton Woods de 1944 portant création du FMI). L’AMGI a pour but de garantir les investissements entre le
nord et le sud en vue de certains risques politiques et non pas de libérer les mouvements de capitaux.
D’après l’art.6-3, Statuts FMI (« Transferts de capitaux »), une distinction est opérée entre l’utilisation des
ressources du FMI pour faire face à un déficit de payements courants et celle pour faire face à des sorties de
capitaux.
L’art.6-1 Statuts FMI (« utilisation des ressources du fonds pour les transferts de capitaux ») pose la règle
selon laquelle « aucun Etat membre ne peut utiliser les ressources du fonds pour faire face à des sorties
importantes ou prolongées de capitaux ». Interprété a contrario, les ressources sont réservées au déficit BP lié
à des mouvements courants (qui est le déficit de la balance commerciale en réalité).
L’art.6-3 Statuts FMI tire la conséquence de l’art.6-1 : « Les membres pourront exercer tout contrôle
nécessaire pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux mais ne pourront exercer ces
contrôles d’une manière ayant pour effet de restreindre les payements pour les transactions courantes ».
En conséquence, le FMI n’a pas de compétence en matière de réglementation internationale des mouvements
de capitaux. Actuellement, une discussion sur un projet de réglementation internationale des mouvements de
capitaux est en cours : la Taxe Tobin.
Elle a pour but de décourager les mouvements spéculatifs de capitaux (mouvements de capitaux à court
terme) car ces mouvements peuvent avoir des effets ravageurs sur les équilibres fondamentaux des diverses
économies nationales.
Par exemple, en cas de vente massive de $, la valeur de cette monnaie se trouvera en baisse. En
conséquence, cela se traduira par des effets sur les paramètres de l’économie américaine : exportations en
hausse MAIS investissement difficile dans le pays (l’achat provenant d’un pays ayant une monnaie étrangère
devra payer plus de sa monnaie pour acheter des $, ce qui n’est pas bon pour l’investissement). A l’inverse,
aujourd’hui, la £ est surévaluée ce qui se traduit par un investissement fort à l’étranger mais des exportations
très faibles.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%