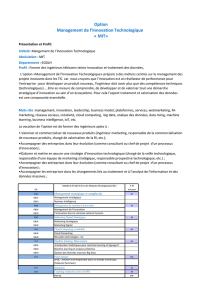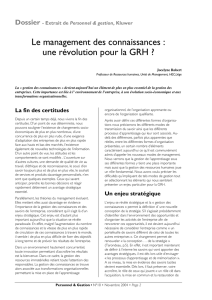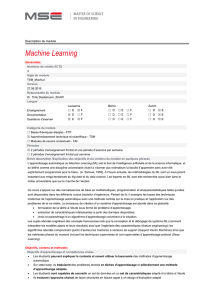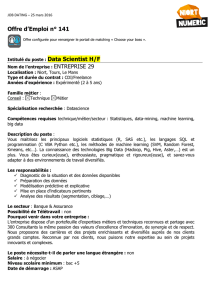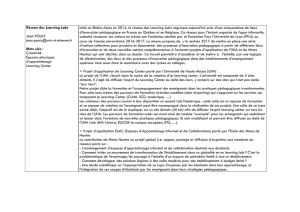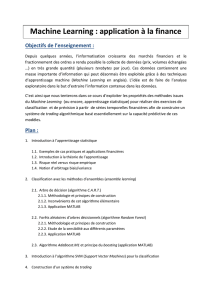vers une conception plus humaniste de l`organisation

L’organisation apprenante :
vers une conception plus humaniste de l’organisation
Philippe LE (Université d’Angers, LARGO)1
RÉSUMÉ
L’organisation apprenante a été souvent présentée ces dernières années comme
l’organisation modèle de demain aussi bien par les chercheurs que les praticiens : la
capacité d’apprentissage est considérée en effet comme la seule source d’avantage
concurrentiel durable. Mais qu’entend-t-on par « organisation apprenante » ? Au travers de
la littérature sur ce thème, on constate que cette notion, que beaucoup relient à celle moins
récente d’apprentissage organisationnel, demeure encore floue : il n’y a pas de véritable
consensus au niveau de sa définition même et de ses perspectives, de sa conceptualisation et
méthodologie. Devant la confusion et la complexité liées au concept d’apprentissage, ce
présent article vise à apporter un nouvel éclairage théorique sur l’organisation apprenante
en intégrant la dimension humaniste de ce concept, aspect souvent négligé ou mal compris.
Nous proposons un cadre conceptuel qui nous permettra de mieux comprendre les liens entre
les notions d’apprentissage et de changement : nous affirmons en effet que les entreprises
doivent changer et se tourner rapidement vers une conception plus humaniste de
l’organisation si elles veulent faire face à un environnement sans cesse changeant.
ABSTRACT
Within the last few years, the learning organization has often been presented by
scholars as well as practitioners as the ideal type of the organization of tomorrow: the
learning ability is indeed considered to be the only source of sustainable competitive
advantage. But what is really meant by « learning organization »? After reading the several
writings on the topic, we can note that this notion that much people link with that, less recent,
of organizational learning remains fuzzy: it has little consensus in terms of definition,
perspective, conceptualization, and methodology. Given the confusion and complexity linked
with the concept of learning, this paper is aimed at bringing a new theoretical perspective on
the concept of the learning organization by integrating its humanistic dimension, an aspect
which is often neglected or not well understood by those preoccupied by the subject. We
propose then a conceptual framework which will enable us to understand the links between
the notions of learning and change better: we state indeed that companies have to change and
move toward a more humanistic conception of the organization if they want to adapt to an
environment characterized by turbulence and rapid change.
1 Adresse pour la correspondance : Philippe LE, Université d’Angers; 13, allée François Mitterrand B.P. 3633 49036
Angers Cedex 01. Tél. 02.41.96.21.35 ; Fax. 02.41.96.21.96 ; e-mail: [email protected].

INTRODUCTION
Alors que nous approchons du nouveau millénaire, nous assistons à une « quête
désespérée » de nouvelles approches en management (Eccles et Nohria, 1992, p. 2), les
paradigmes de management existants montrant leurs limites (Hamel et Prahalad, 1994a). La
recherche de nouveaux paradigmes s’est accélérée en raison des facteurs suivants : déclin des
firmes occidentales amorcé depuis les années 70 avec des marges de profit déclinantes ;
l’incertitude face à l’avenir ; les changements technologiques et sociaux ; les forces du marché
avec des consommateurs de plus en plus exigeants et aux goûts de plus en plus évolués et
affirmés ; les changements démographiques ; la dégradation de la qualité de vie et de la nature
avec des coûts environnementaux énormes ; la globalisation croissante des marchés et une
concurrence exacerbée. Il n’est pas surprenant de constater que la plupart des entreprises se
trouvent dans une situation plus ou moins précaire, et il n’est guère aujourd’hui de firme dont
l’existence ne soit pas menacée, au moins à terme.
La recherche de nouveaux paradigmes en management a abouti notamment ces
dernières années vers le concept de l’organisation apprenante (learning organization), souvent
présenté par les chercheurs ou praticiens comme le modèle souhaitable de l’organisation de
demain. Ce concept apparu à la fin des années 80, que beaucoup confondent à celui moins
récent d’apprentissage organisationnel, suscite beaucoup d’intérêt (les deux notions étant
parfois utilisées indifféremment). Il faut dire que la capacité d’apprentissage a été présentée
comme la seule source d’avantage concurrentiel durable (de Geus, 1988 ; Senge, 1990 ; Stata,
1989). Cependant, au travers de la littérature, on ne trouve pas de véritable consensus en
termes de définition, perspective, conceptualisation et méthodologie sur l’organisation
apprenante (Easterby-Smith, 1997 ; Edmondson et Moingeon, 1997 ; Tsang, 1997). Le
concept demeure souvent ambigü. Il n’a pas la même signification pour tous les auteurs bien
au contraire. De plus, on constate que le fossé qui sépare les concepts d’apprentissage
organisationnel et d’organisation apprenante ne cesse de se creuser (Tsang, 1997). Le premier
faisant l’objet généralement de recherches descriptives et tentant de répondre à la question
suivante : « Comment apprend une organisation ? » Tandis que le second fait l’objet au
contraire d’écrits prescriptifs et normatifs, ne présentant pas toujours tous les gages de la
rigueur scientifique. Il se préoccupe de répondre à la question suivante : « Comment bâtir une
organisation apprenante ? » en partant donc du principe que les organisations n’apprennent
pas ou pas suffisamment.
Malgré les nombreux écrits sur l’organisation apprenante et l’apprentissage
organisationnel, ces notions restent encore floues et demandent à notre sens à être clarifiées.
Cet article vise à apporter un nouvel éclairage théorique sur ce concept en intégrant sa
dimension humaniste, en écho à l’orientation des idées en management depuis presque quatre
décennies. Cet aspect n’a pas été toujours bien compris par ceux qui se sont intéressés au
concept en raison d’une idée de l’apprentissage par trop restrictive et fragmentaire.
En effet, quelles sont les implications les plus profondes de l’évolution des écrits en
management, ceux qui plus récemment affirment « révolutionner » les théories
organisationnelles et qui appellent à une réévaluation des pratiques managériales
traditionnelles? Il semble y avoir une convergence vers le rôle déterminant des êtres humains,
leur « actualisation », leur « cohésivité », leur « engagement », leur « mobilisation », et vers la
nécessité de pratiques managériales qui permettent cette concrétisation. En dépit des limites
de ces écrits que l’on évoquera ultérieurement dans ce papier, le but actuel des théories sur
l’organisation n’est-il pas de développer une « firme plus humaine » ? Pour rendre cela

possible, je crois qu’il est nécessaire de se pencher sur la dimension humaniste voire
spirituelle oubliée des concepts de l’organisation apprenante et de l’apprentissage
organisationnel, au-delà de leurs simples aspects techniques voire cognitifs. Mais quel type
d’humanisme ? Au cours de cette réflexion, j’expliciterai le terme « humanisme », mais pour
le moment j’invite le lecteur à comprendre l’humanisme comme la priorité donnée à la
personne, ses actes, son sens du soi, et son rôle clef dans toutes les activités organisées.
L’objectif de cet article est par conséquent de proposer un cadre conceptuel qui nous
permette de mieux comprendre les rapports entre la notion d’apprentissage dans les
organisations et celle de changement organisationnel, et de développer notre argument selon
lequel les entreprises doivent s’orienter vers une conception plus humaniste de l’organisation
si elles veulent faire face à un environnement en perpétuelle mouvance.
1. BILAN DES IDÉES EN MANAGEMENT DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE : VERS
UNE REVALORISATION DU CAPITAL HUMAIN
1.1. En quête d’une organisation post-taylorienne
Quelle est donc cette organisation qui apprend ? On ne peut pas séparer l’analyse de ce
concept des théories et études existantes sur l’organisation. D’autant qu’on a présenté
l’organisation apprenante comme une rupture par rapport aux approches traditionnelles du
management. Notons toutefois que les études existantes sur l’organisation apprenante, outre
qu’elles demeurent fragmentées dans leurs orientations, sont rarement construites sur les
résultats de recherche antérieurs et font fi plus encore de l’évolution de la pensée en
management.
Pourtant, le concept de l’organisation apprenante fait partie de la problématique du
changement ainsi que de la théorisation sur l’organisation qui, depuis la fin des années 20,
vise à faire table rase des limitations imposées par les principes du taylorisme et des
théoriciens de l’école classique (Fayol, Taylor, Ford, Weber, Gilbreth, Gantt, Mooney,
Gulick...). Ceux-ci percevaient les organisations comme des machines et les travailleurs
comme des pions, jugeant que les unes et les autres se conformaient à une autorité ainsi qu’à
des règles strictes et n’agissaient que sous l’impulsion de stimulants économiques2. Une place
pour chaque homme et chaque homme à sa place, une place pour chaque chose et chaque
chose à sa place, nous dit Fayol. Sans vouloir réduire sa pensée à ce principe isolé, force est de
constater qu’il résume bien, en caricaturant, les théories traditionnelles de l’organisation.
Les préceptes de l’école classique ont eu d’importantes conséquences sur les modes de
gestion des entreprises. La mise en application de ses directives a souvent conduit à de très
nombreux dysfonctionnements dans les entreprises ainsi qu’à de nombreuses critiques qui
dénoncent notamment les méfaits de la bureaucratie (Gouldner, 1954 ; Merton, 1957 ; Perrow,
1979)3. Elles ont largement démontré leurs limites, même si leur influence se fait encore sentir
2 Pour une analyse plus approfondie, voir Morgan (1986).
3 Les critiques du modèle bureaucratique s’attaquent plus à sa dégénérescence qu’à ses principes essentiels. Il est
loisible de se poser la question de savoir si « ces effets pervers » sont inévitables et prouvent que le modèle ne peut
exister dans la conception de Weber.

de nos jours dans les entreprises et les organisations (par exemple, Pinchot, 1994 ; Senge,
1990). Elles ont en particulier le défaut de nier le facteur humain (ou d’en avoir une certaine
conception très réductrice) et de concevoir l’organisation selon une vue très mécaniste de la
réalité.
Les problèmes humains ont fait par la suite l’objet d’une nouvelle quête de rationalité,
explicitement centrée sur ce qui avait été laissé de côté, à savoir la personne et les relations
humaines entre individus. L’école des relations humaines avec ses principaux représentants
Roethlisberger et Mayo, ainsi que son prolongement, le courant participatif, se sont centrés
sur l’intégration du facteur humain aux divers contextes de la production, de la
communication et de l’organisation générale de l’entreprise. Ils ont eu le mérite de faire porter
l’attention des dirigeants sur des conduites humaines que l’on considérait antérieurement sous
l’angle purement économique, technique ou idéologique. Maslow, McGregor, Likert, Leavitt,
Lewin, Argyris, Herzberg et bien d’autres sont les psychologues industriels et sociaux qui ont
vigoureusement dénoncé les insuffisances du mouvement classique et critiqué l’organisation
hiérarchique et taylorienne du travail. Ils ont placé l’individu, l’homme, au centre de
l’organisation et ont fortement développé la recherche sur les modèles d’organisation capables
de prendre en compte la malléabilité et les capacités évolutives et créatrices de l’individu.
Leur objectif n’est pas tant de rendre absolument heureux les individus au travail, mais
d’inventer des modèles d’organisation qui exploitent davantage le potentiel humain.
Avec le mouvement socio-technique4 qui complète celui des Relations Humaines, les
logiques de liberté, d’autonomie, de changement, d’humanité, de créativité et de démocratie
ont prévalu (Perrow, 1973). Avec notamment l’idée de la participation collective par groupes
d’individus (en priorité les salariés) pour développer de nouveaux schémas de travail, d’autres
perspectives de carrière, et divers arrangements visant à mieux concilier la vie familiale et la
vie professionnelle. Ainsi que l’idée que les salariés et leurs supérieurs hiérarchiques doivent
apprendre, de ce point de vue, à reconceptualiser leur travail, et les hauts dirigeants à créer les
contextes adéquats.
Un regard rapide vers les écrits les plus influents en management depuis la fin des
années 1970 montre clairement que la pensée en management cherche à comprendre
davantage le changement, sa nature et sa dynamique. Le changement ne provient peut-être pas
de l’environnement comme l’affirment dans les années 60 les théoriciens de la contingence au
premier rang desquels Lawrence et Lorsch (1967) et Burns et Stalker (1961), qui estiment que
la firme doit simplement s’adapter au changement et donc à l’environnement.
Dans cette volonté de comprendre le changement, la culture d’entreprise, thème favori
par ailleurs de la critique du management traditionnel, figure en bonne place. La large
conquête des marchés mondiaux du Japon a éveillé l’intérêt pour cette notion (Lee, 1980 ;
Ouchi, 1981 ; Pascale & Athos, 1981 ; Peters & Waterman, 1982). Né des toutes premières
tentatives pour comprendre le succès du modèle japonais, le thème de la culture a joui d’une
popularité grâce à l’ouvrage Le prix de l’excellence (Peters et Waterman, 1982). Ainsi, une
nouvelle idée du management a été lancée. On demande désormais au manager de devenir un
héros, un créateur de mythes et valeurs, un catalyseur jouant avec les symboles pour mobiliser
une force de travail enthousiaste galvanisée par la productivité et une performance soutenue
4 Ce sont les membres de l’Institut Tavistock des Relations Humaines fondé en 1946, en Angleterre, qui ont inventé
le qualificatif de « système sociotechnique », afin de mettre en relief l’interdépendance entre les aspects sociaux et
techniques du travail.

(Deal et Kennedy, 1982 ; Kilman, Saxton & Serpa, 1985 ; Peters & Austin, 1985 ; Peters &
Waterman, 1982 ; Waterman, 1987). L’autre thème, qui est considéré comme complémentaire
au premier, est celui de la qualité totale. Celle-ci s’est développée également au Japon, via les
cercles de qualité, les systèmes de production au juste-à-temps avec les zéro stock et les zéro
défaut (Crosby, 1979 ; Deming, 1986 ; Juran , 1988).
La plupart des best-sellers des années 80 dans le domaine du management ont
essentiellement combiné les thèmes de la culture d’entreprise et le management par la qualité,
en valorisant « l’esprit d’équipe », les « valeurs partagées », le « projet commun » ou les
« cercles de qualité » (Archier et Sérieyx, 1984 ; Crozier, 1989 ; DePree, 1989 ; Peters, 1992 ;
Scherkenbach, 1988 ; Sérieyx, 1989). Les problèmes d’écologie et d’éthique se sont greffés à
ces thèmes mais la préoccupation première reste la promotion des styles de management
favorisant la cohésivité, la complicité, l’initiative et la créativité à tous les niveaux. Cela passe
par la revalorisation du capital humain et la mise en avant des valeurs communes, de l’esprit
d’équipe, de l’initiative, de la collaboration, de l’équité, de la qualité, de la moralité et de
l’honnêteté.
Auparavant, le principal problème des managers et des théoriciens de l’organisation
était de trouver les moyens de motiver, mobiliser et stimuler les gens pour faire un travail que
la spécialisation, la division technique du travail, et les préoccupations de réduction des coûts
ont rendu de plus en plus ennuyeux, insipide et vide de sens. Avec le succès économique des
japonais (et aussi, sur des bases différentes, des allemands et des suédois), les objectifs
n’étaient plus de faire des produits de plus en plus vite au moindre coût mais de les produire
mieux, de manière plus « créative » et plus fiable. L’ère de la qualité a été étendue à la firme ;
tous les employés doivent être désormais des participants actifs et intelligents.
Le thème de convergence majeur pour les nombreux courants œuvrant pour une firme
plus humanisée serait donc l’importance de l’Homme ou les attitudes et les comportements
individuels au travail. Qu’importe la tendance ou le sujet : la culture d’entreprise (Deal et
Kennedy, 1982 ; Ouchi, 1981 ; Peters et Waterman, 1982) ; « l’actualisation » de
l’intelligence et des ressources humaines (Crozier, 1989 ; Peters et Austin, 1985 ; Waterman,
1987) ; la qualité totale et le renouveau de l’éthique au travail (Juran, 1988 ; Mintzberg, 1989
; Peters et Austin, 1985) ; le lieu de travail, lieu également pour le dialogue et le partage (De
Pree, 1989 ; Peters, 1992 ; Peters et Austin, 1985 ; Weitzman, 1984) ; la vision à court terme
de la plupart des managers occidentaux, focalisés sur les profits immédiats, l’utilitarisme et le
technicisme mécaniste (Etzioni, 1989 ; Minc, 1990 ; Mintzberg, 1989) ; et plus récemment
l’émergence du concept non plus de capital humain mais de capital intellectuel (Quinn, 1996 ;
Ulrich, 1998 ; Stewart, 1997).
Ce qui ressort clairement, c’est le souci de mettre en exergue l’élément humain de façon
à ouvrir la voie à des pratiques managériales visant au mieux l’intelligence de chacun et de
développer son désir d’appartenir à l’entreprise qu’il sert. Il semble impératif maintenant de
trouver une forme de management qui voit l’employé non plus comme un rouage passif mais
comme un complice actif et volontaire.
1.2. Impasses des théories traditionnelles de l’organisation
Cependant, selon certains auteurs, le management traditionnel n’est pas préparé pour ce
changement (par ex. Chanlat, 1990). Il lui manque les moyens conceptuels et théoriques pour
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%