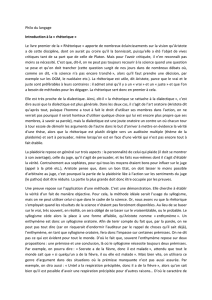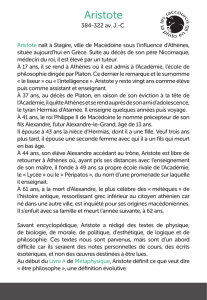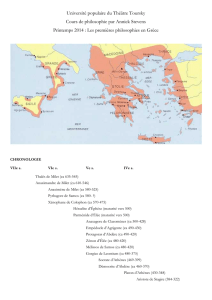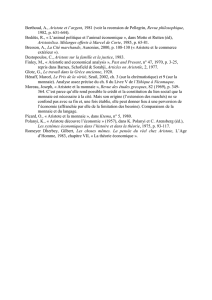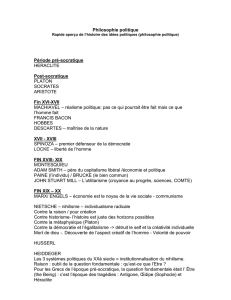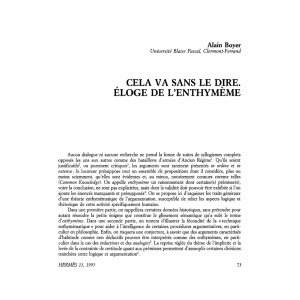Philo du langage 5. Aristote, la rhétorique et les catégories Le livre

Philodulangage
5.Aristote,larhétoriqueetlescatégories
Lelivrepremierdela«Rhétorique»apportedenombreuxéclaircissementssurlavisionqu’Aristote
adecettediscipline,dontonauraitpucroirequ’illabannissait,puisqu’elleaétél’objetdevives
critiquestantdesapartquedecelledePlaton.Maispourl’avoircritiquée,iln’enreconnaîtpas
moinssanécessité.C’estque,dit‐il,onnepeutpastoujoursrecouriràlasciencequandunequestion
seposeetqu’ondoittrancher(cettequestionsurgitdenosjoursdansdenombreuxdébatsoù,
commeondit,«lasciencen’apasencoretranché»,alorsqu’ilfautprendreunedécision,par
exemplesurlesOGM,lenucléaireetc.).Larhétoriqueestutile,ditAristote,parcequelevraietle
justesontpréférablesàleurscontraires:iladmetainsiqu’ilyaun«vrai»etun«juste»etquel’on
abesoindeméthodespourlesdégager.Larhétoriquesertdoncenpremieràcela.
Elleesttrèsprochedeladialectique.Ainsi,dit‐il«larhétoriqueserattacheàladialectique»,c’est
direaussiqueladialectiqueestplusgénérale.Danslesdeuxcas,ils’agitdel’artoratoire(Aristotedit
qu’aprèstout,puisquel’hommeatoutàfaitledroitd’utilisersesmembresdansl’action,onne
verraitpaspourquoiilseraithonteuxd’utiliserquelquechosequiluiestencoreplusproprequeses
membres,àsavoirsaparole),maisladialectiqueestunejouteoratoireuncontreunoùchacuntour
àtouressaiededémolirlesargumentsdel’autredanslebutd’arriveràmettreenévidencelavérité
d’unethèse,alorsquelarhétoriqueestplutôtdirigéeversunauditoiremultiple(thèmedela
plaidoirie)etsertàpersuader,mêmelorsqu’onestenfaced’unevéritéquin’estpasencoretoutà
faitétablie.
Laplaidoiriereposeengénéralsurtroisaspects:lapersonnalitédeceluiquiplaide(ildoitsemontrer
àsonavantage),celledujuge,qu’ils’agitdepersuader,etlesfaitseux‐mêmesdontils’agitd’établir
lavérité.Contrairementauxsophistes,pourquitouslesmoyensétaientbonspourinfluersurlejuge
(appelàlapitiéetc.),Aristotepenseque,dansunbonEtat,ondoitlaisserlemoinspossible
d’arbitraireaujuge,c’estpourquoilapartiedelaplaidoirieliéeàl’actionsurlessentimentsdujuge
(lepathos)doitêtreréduite.Lapartielaplusgrandedoitdoncêtreoccupéeparlespreuves.
Unepreuvereposesurl’applicationd’uneméthode.C’estunedémonstration.Ellechercheàétablir
lavéritéd’unfaitdemanièreobjective.Pourcela,laméthodeidéaleseraitl’usagedusyllogisme,
maisonnepeututilisercelui‐ciquedanslecadredelascience.Or,nousavonsvuquelarhétorique
s’employaitquandlesrésultatsdelasciencen’étaientpasforcémentdisponibles.Aulieudesebaser
surlevrai,trèssouvent,enréalité,onseraobligédesebasersurlevraisemblable,ouleprobable.Le
syllogismecèdealorslaplaceàuneformeaffaiblie,qu’Aristotenomme«enthymème».Un
enthymèmeestdoncunsyllogismeoratoire.Afindetenircomptedufaitque,parlaparole,onne
peutpastoutdire(caronrisqueraitd’endormirl’auditeurparlerappeldechosesqu’ilsaitdéjà),
l’enthymème,entantquesyllogismeoratoire,feradoncl’impassesurcertainesprémisses.Onnedit
pascequiestévidentpourtoutlemonde.D’oùlefaitque,souventl’enthymèmereposesurdeux
propositions:uneprémisseetuneconclusion,làoùlesyllogismenécessitetoujoursdeuxprémisses.
Parexemple,onpourradire:«Socrateadelafièvre,doncilestmalade»,attenduquetoutle
mondesaitque«siquelqu’unadelafièvre,ilouelleestmalade».Maisbienvite,onutiliserace
genred’argumentdansdessituationsoùlaprémissemanquanten’estpasaussiassurée.Par
exemple,ondiraaussi:«Untelalarespirationprécipitée,donciladelafièvre»,alorsqu’onsait
bienqu’ilestpossibled’avoirunerespirationprécipitéepourd’autresraisons…D’oùlecaractèrede

plusenplus«probabiliste»del’enthymème.Enpassant,Aristotesoulignelaparentéquiexiste
entrel’enthymèmecommenousvenonsdelevoiretlanotiondesigne.Dire«siquelqu’unadela
fièvre,ilouelleestmalade»,c’estcommedire:«lafièvreestsignedelamaladie».Ilyadoncun
lienentreenthymèmeetsigne.Simplement,ilyadessignesnécessaires(«lesignequ’unetellea
accouché,c’estqu’elleadulait»)etdessignesréfutables(«unteladelafièvrecarilaune
respirationprécipitée»).PourAristote,ilyaaussideuxtypesdesignes:ceuxquivontduparticulier
augénéraletceuxquivontdugénéralauparticulier.Danslepremiercas,onutiliseuneobservation
(ouunpetitnombre)pourfaireunegénéralité.Parexemple,uneobservationselonlaquelleunjuge
estsageetjustepeutservirdesigneàlajusticeetàlasagessedesjuges.Maisalorsc’estunsigne
hautementréfutable(onretrouveicilecasdel’exemple,cf.ci‐dessous)!(commesilefaitd’observer
uncielrougissantunsoirprécédantunepanned’électricitéfaisaitipsofactoducielrougissantun
signeavant‐coureurdepanned’électricité!).Lessignesquivontdansl’autresenssontplus
crédibles.Parexemple,onpeutétablirunliennécessaireentrelenombredecirconférencessurla
sectiond’untroncd’arbreetl’âgedel’arbre,onpeutalorsdéduirequelenombredecirconférences
estunsignedel’âgedel’arbre.C’estlaloiqui,ici,fondelarelationdesignification(celan’estpasdit
parAristote,biensûr).
Uneautrefigureutiliséeparceluioucellequiargumenteestl’exemple.Alorsquel’enthymèmeest
fondésurunerelationdepartieàtout(cf.quandondit«fièvre,doncmaladie»,onditque
l’ensembledesgensquiontdelafièvreestunepartiedel’ensembledesgensquisontmalades),
l’exempleestbasésurunerelationdepartieàpartie.Ainsiaura‐t‐onvucertaindignitairedemander
unegarderapprochéelorsqu’ilavaitentêtededevenirtyran:celaneveutpasdireque
nécessairement,toutdignitairequidemandeunegarderapprochéefaitpartiedeceuxquidésirent
devenirtyrans…c’estjusteunoudeuxcas:ilsprocurentdesexemplesdecasoùundignitairea
demandéunegarderapprochéeavantdedevenirtyran,d’oùlessoupçonsqu’onpourraavoirpourla
suite.C’estunpeucommequandondit:«ilyaeudesprécédents»concernantdesassociationsde
faitsquel’onredoute.L’argumentn’estpasfondésuruneloi(mêmeprobabiliste)maisseulement
surunexemple.Denosjours,évidemmentonavudescasoùdesattentasétaientcommispardes
islamistes,maiscelan’entraîneabsolumentpasl’existenced’uneloi.
Pourrevenirsurlaprémissemanquantedansl’enthymème,onnoteraquecertes,cetteabsence
peutsetrouverlégitiméeparlefaitquel’auditeursaitdéjàcequ’elleauraitditsielleavaitété
présente(parexemplequelafièvreindiquelamaladie),maiscelapeutnepasêtrelecas.Alors,on
ditquelepremierlocuteur(celuiquiénoncel’enthymème)introduitcetteconnaissancesupposée
dansl’arrièrefondsdesconnaissancescommunes.Ils’agitdumécanismed’accommodation(qu’on
verraàl’œuvreaussidanslemécanismedelaprésupposition).L’interlocuteurs’accommodesurle
proposdulocuteurafindemaintenirunfondscommundesavoirpartagé.Evidemment,iln’yestpas
obligé…maisonpeutnoterquececisepassesouventdansledébatquandonneveutpasdire
explicitementcesurquoionsefondedansl’enthymèmeprésenté.Onnesouhaitepasmettreen
lumièreunaspectdecequiestsupposéparceque,parexemple,c’estjustementincertain(!)ou
bienparcequec’estunevéritéinavouable.Lesdébatséconomiquessontsouventpleins
d’enthymèmesparcequebaséssurdes«lois»dontonn’estpastoutàfaitsûr.Lesdébatspolitiques
(ou«surlesvaleurs»)sontpleinsaussid’enthymèmesreposantsurdesvéritésinavouables.Direpar
exemplequ’ilfautréduirelesminimauxsociauxpourréduirelenombred’assistés(cf.MittRomney)
c’estunemanièredenepasdirequ’onpensequelespauvresetleschômeurssontdesgensquine
visentqu’àêtredesassistés.

Finalement,larhétoriqued’Aristoteouvrelavoieàuneconceptiondulangagebaséesurl’interaction
etlapragmatique.Parler,c’esttenterd’influersursonenvironnementetenparticuliersurles
arrière‐fondsdesavoirpartagédesunsetdesautres.
Ensuite,laréflexiond’Aristotenousconduitdoncàréfléchiràlaquestiondusigne.
Dansl’Organon,lelivre1contient«lesCatégories»et«Del’Interprétation».«LesCatégories»se
proposepourbutdefaireuntableaudesdiversescatégoriesdel’Etre.ContrairementàPlaton,
Aristotepensequel’Etreestmultiple(etnonpasUn).Cettemultiplicitésereflètedansles
différentescatégoriesdecequipeutêtre.Enpremierlieuviennentlessubstances:lesentités
individuellesconcrètes(«cethomme»,«cecheval»,«Aurélie»…),dontonnepeutnierl’existence.
Aristotelesappelle«substancespremières».Ensuiteviennentlestermesgénéraux,telsque
«homme»,«animal»,«cheval»…quiserventàqualifiercespremièressubstances,etqu’Aristote
appelledes«substancessecondes»:cesontprincipalementlesgenresetlesespèces.Onpeut
distinguerlessubstancesdelamanièresuivante:parmilesêtres,certainssontaffirmésdequelque
chose(parexemple,ondiraque«Aurélieestétudiante»,«étudiante»estalorsaffirméd’Aurélie),
d’autressontdansquelquechoseausensoùilsnepeuventpasenêtreséparés,oùilsontbesoinde
cetteautrechosepourexister.Parexemple,unequalitécommelablancheurnesauraitexistertoute
seule,ensuspensiondansl’air:elleestforcémentdansunesubstance(parexemplelaneige,une
hermine,telvêtementetc.).Etilexistedesêtresquisontindépendants:niaffirmésdequelque
choseninécessairementdansquelquechose,cesontlàlessubstancespremières.«Aurélie»n’est
affirméderienetn’estdansrien.Aurélieest,c’esttout.Maisilexisteaussidifférentsattributs
possiblesdelasubstance,quiserépartissentselondesclassesd’expressions:ilyalesexpressions
quiexprimentlaqualité,d’autrespourlaquantité,pourlelieu,pourlarelationetc.Lesaccidents
sontreprésentéspardesverbesconjugués:c’estcequiarriveàlasubstance.Cetterépartition
expliqueladichotomiesujet/prédicat:estsujetcequiestsubstance,estprédicatcequiestditdela
substance.Lasubstanceestpeut‐êtreune,maiselleapparaîtsousunjourmultiplegrâceàla
prédication.Onpeutdèslorsvoir«cethomme»entantqu’ilestsimplementhomme,oubienen
tantqu’ilestchauve,ouriche,ouventru,oupossèdeunemaisonetc.
Lesmotsetexpressionsquidésignentcesentités,substances,qualités,accidentsetc.serépartissent
eux‐mêmesprincipalementennomsetverbes.Cesexpressionssontd’aborddessymboles,Aristote
dit:
Lessonsémisparlavoixsontlessymbolesdesétatsdel’âme,etlesmotsécritssontles
symbolesdesmotsémisparlavoix
C’estdirequelesmotsetexpressionslinguistiquesnerenvoientpasdirectementauréel:ils
renvoientd’abordaux«étatsdel’âme»,quelquechosequ’aujourd’huionpourraitappelerles
«étatsmentaux».Onsaitalorsladifficultéquiexiste:silesmotsrenvoientànosétatsinternes
(étatsmentaux),commentpeuvent‐ilsréféreràuneréalitéexterne,etquiplusest,àlamêmeréalité
pourtouslessujets?Aristoterésoutcettedifficultéensupposantquelesétatsdel’âme
(contrairementànosétatsmentaux)sontnécessairementlesmêmespourtous:ilssontlepurreflet
delaréalité.Plusprécisément,notrepensée(notre«âme»commediraitAristote)estactive:elle
extraitdelaréalitédesformes(lesformesdesobjets,parexemplecelled’uncercle,oud’unedroite
etc)etlesétatsdel’âmeenquestionsontl’expressiondecesformes.Onvoitd’embléequ’Aristote,
contrairementàPlaton,donneunrôleactifàl’espritdansl’actedeconnaissance.Maintenant,

qu’entend‐onicipar«symboles»?Aristoteéclairecettequestionquandilditquelesnoms,par
exemple,sontreliésauxétatsdel’âmepardesliensconventionnels.Onsaitque,dans«LeCratyle»,
Platonrejettel’idéed’uneassociationconventionnelledesmotsàcequ’ilsdésignentaunomdece
ques’ilenétaitainsi,onnepourraitpascommuniquer.Sieneffet,l’undécided’appeler«cheval»
cequemoi,j’appelle«homme»etvice–versa,onnesauraplusoùdonnerdelatête!maiscette
notiondeconventionn’estpaslabonne:Aristoteseréfèreraàunenotiondeconventiontacite,
analogueauxrèglesd’unjeuquelesmembresd’unesociétéàcertainsmomentsdeleurhistoire
décidentd’adopter,sansforcémentenêtreconscients.Platon,lui,croyaitenunlien«naturel»
entrelesmotsetleschoses:lesmotsvenaientauxchosesparunesortedeprocessusd’imitation.
Parexemple,leverbe«couler»contientun«l»,phonèmequiévoquejustementl’eauquicoule
etc.
Onvoit,entreAristoteetPlaton,sedessineruneoppositionquidureralongtempsenphilosophie
(jusqu’ànosjours)entreceuxqui,commePlaton,enappellentàdesEssencespourêtregarantes
d’unevéritéuniquepourtous,etceuxqui,commeAristote,refusentlesEssencespourmettreles
opérationsdel’espritaupremierplan.
CelaesttrèsapparentdanslafameuseQuerelledesUniversaux,quiaagitéprofondémentleMoyen
Âge.Boèce,traducteurd’Aristoteenlatinavaitclarifiélaquestionendisantquecequiétaitencause
c’étaitlaréalitédesgenresetdesespèces.Sipersonnenedoutequelessubstancespremières
d’Aristoteexistentbeletbien,qu’enest‐ildessubstancessecondes?Est‐cequel’hommeengénéral
existeaussibienquecethommeparticulier?Quand,auXVIIIèmesiècle,ils’estagidefaireune
classificationdesêtresvivants,ilestapparuàcertainsnaturalistesqueseulslesindividusexistaient,
lesclassesn’étantquedescréationsdesnaturalistes.Unpointdevue«réalistemétaphysique»
soutiendraitquelesclassesexistent,voiremêmequ’ellespré‐existentauxobjetsqu’onrangeen
elles(Saint‐Thomasd’Aquin).Lepointdevuedit«nominaliste»quantàlui,prétendqueseuls
existentlesobjetssinguliersetquelesclasses(genresetespèces)sontdesproduitsdel’esprit(voire
depursélémentsdelangage).Ainsi,leréalistecroitenuneexistencedechosesindépendammentdu
processusdenotrepensée,alorsquelenominaliste(ouleconceptualiste)rejettel’existenced’objets
abstraitstelsquedesclasses,quiseraientindépendantesdel’actiondenotreesprit.
Noterquecettequerelleresurgitquandontraitedelaquestiondel’existencederéalitésabstraites
tellesqu’ilenapparaîtenpolitique,parexemple.Est‐ceque«laliberté»,«lepeuple»,«la
démocratie»réfèrentàdesentitésexistantes,dessubstances?Uneattitudeplatoniciennen’aurait
pasdedifficultéàl’admettrealorsqu’uneattitudenominalistelesrejetteraitendisantquecene
sontlàquedesmots.Or,noussavonsbienquecenesontpasquedesmotsoudesdiscours,oualors
sicesontdesdiscours,cesontdesdiscoursquiagissentsurlaréalité.Onpeutévoqueràceproposla
performativité,c’est‐à‐direlefaitquedirecertainesexpressionsouformuleslesfaitexisterdansla
réalité.Endisant«jebaptisecenavire«QueenMary»»,jebaptiseeneffetcebateau«Queen
Mary»,etl’effetdecesparolesestjustementdechangerd’état,depasserd’unétatoùlebateau
n’avaitpasdenomàceluioùils’appelledésormais«leQueenMary».Laréalitéaalorschangé.
TP:qu’est‐cequ’une«prophétieauto‐réalisatrice»?
1
/
4
100%