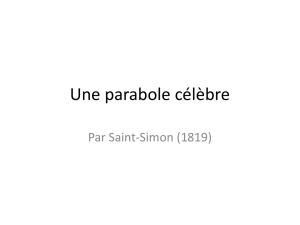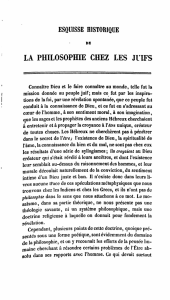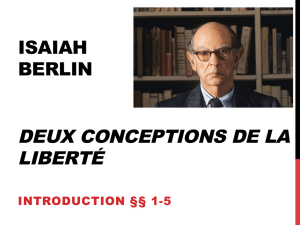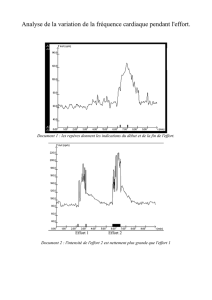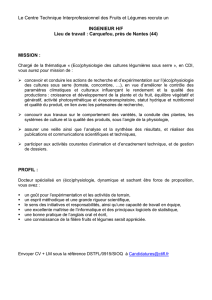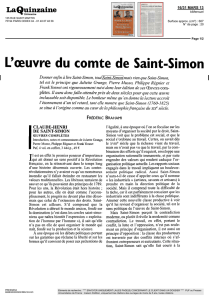LA DOCTRINE DE SAINT-SIMON Fondation du positivisme

Émile Durkheim (1928), Le socialisme : sa définition – ses débuts – la doctrine saint-simonienne 65
CHAPITRE VI
LA DOCTRINE
DE SAINT-SIMON
Fondation du positivisme
.
SIXIÈME LEÇON
(Suite)
De l'énumération [des oeuvres de Saint-Simon] à laquelle nous venons de procéder, il
semble résulter au premier abord que la pensée de Saint-Simon a poursuivi successivement
un double but : nous venons de voir en effet qu'il s'est occupé d'abord de questions plus
spécialement philosophiques, et ensuite seulement de problèmes sociaux. Y a-t-il eu réelle-
ment dualité dans ses préoccupations ? N'a-t-il abouti à la sociologie, à la politique
scientifique que par impuissance de satisfaire ses aspirations primitives à la science totale ?
Son goût pour les questions sociales ne serait-il, ainsi qu'on l'a soutenu (Michel, Idée de
l'État, 173), que le résultat d'un renoncement à des spéculations plus hautes, et le sociologue
ne serait-il chez lui qu'un philosophe avorté et découragé par son avortement ? Méconnaître à
ce point l'unité du système, c'est ne pas apercevoir ce qui en est le principe fondamental. Tout
au contraire, sa sociologie et sa philosophie sont si intimement unies que, bien loin qu'elles
soient extérieures l'une à l'autre, il est plutôt malaisé et presque impossible de les séparer et
d'exposer l'une indépendamment de l'autre.
En effet, l'idée d'où part Saint-Simon et qui domine toute sa doctrine, c'est qu'un système
social n'est que l'application d'un système d'idées. « Les systèmes de religion, de politique
générale, de morale, d'instruction publique ne sont, dit-il, autre chose que des applications du
système des idées ou, si on préfère, c'est le système de la pensée considéré sous différentes
faces » (Mémoire sur la science de l'homme, XI, 18) 1. Sans doute, il dit ailleurs (ibid., p.
1 Les peuples s'organisent et doivent s'organiser différemment suivant la manière dont ils se représentent
l'univers et eux-mêmes, selon qu'ils voient par exemple, dans la réalité, la création d'une libre volonté ou le

Émile Durkheim (1928), Le socialisme : sa définition – ses débuts – la doctrine saint-simonienne 66
191) que les révolutions scientifiques ont alterné avec les révolutions politiques, qu'elles ont
été successivement cause et effet les unes des autres et il cite des exemples de cette
alternance. Par exemple, suivant lui, c'est la constitution des sciences positives au XVIe
siècle qui détermine la constitution du protestantisme et, par suite, les transformations
politiques dans l'Europe septentrionale et même dans l'Europe tout entière ; car le lien
politique qui unissait jusque-là les divers peuples européens entre eux fut dès lors affaibli.
Mais ces changements dans l'organisation politique en suscitèrent à leur tour dans la science :
c'est l'achèvement par Galilée du système de Copernic et l'apparition de la méthode baco-
nienne. Néanmoins, et quoique ces deux facteurs s'engendrent mutuellement, il s'en faut qu'il
les mette sur le même plan. C'est l'idée, c'est-à-dire la science, qui est selon lui le moteur
initial du progrès. Si, à chaque phase de l'histoire, elle reçoit elle-même les contrecoups des
mouvements qu'elle a au préalable déterminés, c'est cependant elle qui est la cause motrice
par excellence. Car elle est la source positive de toute vie sociale. Une société est avant tout
une communauté d'idées. « La similitude des idées morales positives, dit-il dans une lettre à
Chateaubriand, est le seul lien qui puisse unir les hommes en société » (II, 218). Les
institutions ne sont que des idées en actes (Industrie, III, 39). C'est la religion qui a été
jusqu'à présent l'âme des sociétés ; or « toutes les religions ont été fondées sur le système
scientifique » du temps (Science de l'homme, XI, 30). Elles sont la science des peuples sans
science ou des choses dont la science n'est pas faite.
Cela posé, on aperçoit aisément le lien qui unit la philosophie et la sociologie de Saint-
Simon : c'est que la première a un but social et pratique, et c'est pour cette raison et non pour
satisfaire une curiosité purement spéculative que Saint-Simon aborde ces hauts problèmes.
Voici comment il y est amené. « Le seul objet que puisse se proposer un penseur », au
moment où il écrit, lui paraît être de rechercher quel est le système moral, le système
religieux, le système politique, en un mot « quel est le système des idées, sous quelque face
qu'on les envisage », qu'appelle l'état où se trouvent les sociétés européennes au commence-
ment du XIXe siècle. Mais ce système des idées n'est que la conséquence du système de la
science, c'en est l'expression abrégée et condensée, pourvu qu'on donne au mot de science
son sens large, c'est-à-dire qu'on entende par là tout l'ensemble de connaissances considérées
comme acquises à l'époque correspondante. Ce qui lie les hommes en société, c'est une
commune manière de penser, c'est-à-dire de se représenter les choses. Or, à chaque moment
de l'histoire, la manière de se représenter le monde varie suivant l'état où sont parvenues les
connaissances scientifiques ou qui passent pour telles, c'est-à-dire qui passent pour certaines.
C'est donc en systématisant ces dernières que l'on peut arriver à définir ce que doit être, à une
époque donnée, la conscience d'un peuple déterminé. Mais, d'un autre côté, cette systéma-
tisation est l'objet même de la philosophie. Car la philosophie, telle que la conçoit Saint-
Simon, n'a pas pour objet je ne sais quelle réalité qui échappe aux autres branches du savoir
humain puisque celles-ci, par définition, embrassent tout ce qui peut être atteint par la
pensée. Seulement, chacune d'elles étudie une partie du monde et une seule ; un aspect des
choses et un seul. Il y a donc place pour un système spécial qui relie les unes aux autres
toutes ces connaissances fragmentaires et spéciales et en fasse l'unité. C'est la philosophie.
Cet effort suprême de la réflexion n'a pas pour but de dépasser le réel grâce à des manières et
à des méthodes inconnues des sciences proprement dites, mais simplement d'organiser les
conclusions utiles, auxquelles elles ont abouti et de les ramener à l'unité. Elle en est la
synthèse, et comme la synthèse est de même nature que les éléments de la philosophie, elle
est elle-même une science. « Les sciences particulières sont les éléments de la science
générale à laquelle on donne le nom de philosophie ; ainsi la philosophie a eu nécessairement
produit d'une loi nécessaire, suivant qu'ils admettent un ou plusieurs dieux. La forme de chaque société
dépend donc de l'état de ses connaissances. [Addition de D.]

Émile Durkheim (1928), Le socialisme : sa définition – ses débuts – la doctrine saint-simonienne 67
et aura toujours le même caractère que les sciences particulières » (Mémoire introductif, 1,
128). « Elle est, dit-il ailleurs, le résumé des connaissances acquises », le grand livre de la
science (Correspondance avec Redern, 1, 109). C'est donc une encyclopédie. Saint-Simon
reprend ainsi l'idée des philosophes du XVIIIe siècle. Seulement, entre l'encyclopédie qu'il
appelle de ses vœux et celle de l'époque pré-révolutionnaire, il y a toute la distance qui sépare
ces deux moments de l'histoire. Celle-ci, comme toute l’œuvre du XVIIIe siècle, a été surtout
critique ; elle a démontré que le système d'idées qui avait été en vigueur jusque-là n'était plus
en harmonie avec les découvertes de la science, mais elle n'a pas dit ce qu'il devait être. Elle
a été une machine de combat, faite tout entière pour détruire et non pour reconstruire, tandis
qu'aujourd'hui c'est à une reconstruction qu'il faut procéder. « Les auteurs de l'Encyclopédie
française ont démontré que l'idée générale admise ne pouvait servir au progrès des sciences...
mais ils n'ont point indiqué l'idée à adopter pour remplacer celle qu'ils ont discréditée. » « La
philosophie du XVIIIe siècle a été critique et révolutionnaire, celle du XIXe sera inventive et
organisatrice » (ibid., 1, 92). Et voici comment il la conçoit. « Une bonne encyclopédie serait
une collection complète des connaissances humaines rangées dans un ordre tel que le lecteur
descendrait, par des échelons également espacés, depuis la conception scientifique la plus
générale jusqu'aux idées les plus particulières » (1, 148). Ce serait donc la science parfaite.
Aussi est-elle impossible à réaliser dans la perfection. Car il faudrait pour cela que toutes les
sciences particulières soient achevées et il est dans leur nature de se développer sans terme.
« La tendance de l'esprit humain sera donc toujours de composer une encyclopédie tandis que
sa perspective est de travailler indéfiniment à l'amas des matériaux qu'exige la construction
de l'édifice scientifique et à l'amélioration de ce plan, sans jamais compléter l'approvisionne-
ment de ces matériaux » (Mémoire sur l'Encyclopédie, 1, 148). C'est une oeuvre toujours
nécessaire mais qu'il est non moins nécessaire de refaire périodiquement, puisque les
sciences particulières qu'elle systématise sont perpétuellement en voie d'évolution.
Ainsi conçue, la philosophie a donc une fonction éminemment sociale. Aux époques de
calme et de maturité, alors que la société est en parfait équilibre, elle est la gardienne de la
conscience sociale par cela même qu'elle en est la partie culminante et comme la clef de
voûte. Aux temps de trouble et de crises, alors qu'un nouveau système de croyances
communes tend à s'élaborer, c'est à elle qu'il appartient de présider à cette élaboration. Il n'y a
donc pas d'écart entre les deux sortes de recherches auxquelles s'est successivement livré
Saint-Simon, puisque les unes et les autres ont le même objet, puisque ses travaux
philosophiques ont une fin sociale comme ses travaux sociologiques. La philosophie apparaît
ainsi comme une branche de la sociologie. « Tout régime social est une application d'un
système philosophique et, par conséquent, il est impossible d'instituer un régime nouveau
sans avoir auparavant établi le nouveau système philosophique auquel il doit correspondre »
(Industrie, III, 23). Il a toujours le même but en vue. Mais il y a plus, et l'unité de sa pensée
est encore beaucoup plus complète. « Le philosophe se place au sommet de la pensée ; de là,
il envisage ce qu'a été le monde et ce qu'il doit devenir. Il n'est pas seulement observateur, il
est acteur ; il est acteur du premier genre dans le monde moral, car ce sont ses opinions sur ce
que le monde doit devenir qui règlent la société humaine » (Science de l'homme, XI, 254).
D'après ce qui précède, on voit bien que c'est sous l'influence des mêmes préoccupations
pratiques qu'il a fait successivement de la philosophie et de la sociologie, mais on n'aperçoit
pas encore pourquoi il est passé de l'une à l'autre. Pourquoi la philosophie n'a-t-elle pas suffi
à l'œuvre sociale qu'il méditait ? d'où vient qu'il n'a pas pu en déduire immédiatement les
conclusions pratiques auxquelles il tendait, et qu'il a cru nécessaire de travailler en outre,
dans les différents écrits qui remplissent la seconde partie de sa carrière, à jeter les bases
d'une science spéciale des sociétés ? En d'autres termes, si l'unité du but qu'il a poursuivi
ressort de ce que nous venons de dire, il n'en est pas de même de l'unité des moyens dont il
s'est servi. Il paraît en avoir successivement employé de deux sortes, sans qu'on voie aussitôt
pourquoi. Si les routes qu'il a suivies convergent au même point, il semble en avoir suivi

Émile Durkheim (1928), Le socialisme : sa définition – ses débuts – la doctrine saint-simonienne 68
deux qui étaient différentes et n'avoir tenté l'une qu'après avoir abandonné l'autre. Mais nous
allons voir que cette dualité n'est qu'apparente. C'est la philosophie qui d'elle-même l'a mené
à la sociologie comme à son complément naturel ; la voie où nous le voyons s'engager en
second lieu n'était que la suite et que le prolongement de la première.
En effet, pour que cette systématisation qui constitue la philosophie soit logiquement
possible, il faut qu'elle ne comprenne que des éléments de même nature. On ne peut pas
coordonner ensemble, d'une manière cohérente, des conceptions théologiques, dépourvues de
toute base positive, n'ayant d'autre autorité que celle d'une prétendue révélation, et des
connaissances scientifiques, c'est-à-dire établies par l'observation et à la lumière du libre
examen. On ne saurait faire un tout un et organique avec des idées aussi hétérogènes et de
provenances aussi disparates que les conjectures des prêtres, d'une part, et les propositions
démontrées par les savants, de l'autre. Or, toutes les sciences inférieures qui traitent des corps
bruts, l'astronomie, la physique et la chimie, ont pris définitivement le caractère positif. Là-
dessus, il n'y a plus à revenir. Par conséquent, l'encyclopédie philosophique n'est possible
sans contradiction que si les autres sciences et spécialement la science de l'homme prennent
ce même caractère, si elles deviennent elles aussi positives. Or elles ne sont pas encore
parvenues à cet état 1 ; du moins, ce n'est que partiellement ou fragmentairement que certains
savants les ont traitées d'après les mêmes principes et les mêmes procédés que les autres
sciences. Par suite, si la philosophie ne comprend que les résultats acquis actuels, elle ne peut
être qu'un système ambigu et sans unité. Sans doute depuis la Renaissance on se contente de
cette ambiguïté, on vit dans cette antinomie. Mais justement c'est cette équivoque, comme
nous le verrons, qui fait l'état critique des sociétés modernes, qui, en les empêchant de se
mettre d'accord avec elles-mêmes, de se débarrasser des contradictions qui les travaillent, met
obstacle à toute organisation harmonique. Il faut sortir de cette impasse. Il n'y a donc à
choisir qu'entre les deux partis suivants. Ou bien se résigner à faire une philosophie qui
n'embrasserait que les sciences des corps bruts, ou bien, si l'on veut élargir la base des
comparaisons et des généralisations, il faut constituer au préalable cette science qui fait
défaut. Ou bien prendre son parti de la lacune, ou bien la combler. Il n'y a pas d'autre issue
possible. Mais la première de ces solutions n'en est pas une. Car une encyclopédie aussi
tronquée ne pourrait pas jouer le rôle social qui est sa seule raison d'être. Elle ne servirait à
rien. En effet, ce n'est pas en rassemblant les connaissances que nous avons sur les choses
que nous pourrons jamais arriver à découvrir les moyens de tenir les hommes unis en
sociétés. Ce n'est pas en systématisant les résultats les plus généraux de la physique, de la
chimie ou de l'astronomie qu'on peut arriver à constituer pour un peuple un système d'idées
qui puisse servir de fondement à ses croyances morales, religieuses et politiques. Ce n'est pas
que ces sciences ne soient pas des facteurs de ce système ; mais, à elles seules, elles ne
suffisent pas à le fonder. En fait, depuis longtemps elles occupent la première place et
exercent une sorte de prépondérance, précisément parce qu'elles sont les plus avancées, mais
leur impuissance morale n'est que trop rendue manifeste par l'état de crise que traversent les
sociétés européennes. Chimistes, astronomes, physiciens, s'écrie Saint-Simon, « quels sont
vos droits pour occuper dans ce moment le poste d'avant-garde scientifique ? L'espèce
humaine se trouve engagée dans une des plus fortes crises qu'elle ait essuyées depuis l'origine
de son existence ; quel effort faites-vous pour terminer cette crise ?...
Toute l'Europe s'égorge (1813), que faites-vous pour arrêter cette boucherie ? Bien Que
dis-je ! c'est vous qui perfectionnez les moyens de destruction ; c'est vous qui dirigez leur
emploi dans toutes les armées, on vous voit à la tête de l'artillerie c'est vous qui conduisez les
travaux pour l'attaque des places 1 Que faites-vous, encore une fois, pour rétablir la paix ?
1 « La physiologie ne mérite pas encore d'être classée au nombre des sciences positives » (Science de
l'homme, XI, 127).

Émile Durkheim (1928), Le socialisme : sa définition – ses débuts – la doctrine saint-simonienne 69
Rien. Que pouvez-vous faire ? Rien. La connaissance de l'homme est la seule qui puisse
conduire à la découverte des moyens de concilier les intérêts des peuples et vous n'étudiez
point cette science... Quittez (donc) la direction de l'atelier scientifique ; laissez-nous
réchauffer son cœur qui s'est glacé sous votre présidence et reporter toute son attention vers
les travaux qui peuvent ramener la paix générale en réorganisant la société » (Science de
l'homme, XI, 40). Il faut donc aller de l'avant et se mettre à l'œuvre, si l'on veut rendre à
l'humanité le service dont elle a tant besoin. Il faut faire ce qui n'a pas été fait. Il faut étendre
l'esprit positif qui inspire l'astronomie et les sciences physico-chimiques à l'homme et aux
sociétés, constituer ainsi à nouveaux frais et sur de nouvelles bases le système des
connaissances humaines relatives à ce double objet pour les mettre en harmonie avec celles
que nous possédons d'ores et déjà sur les choses inorganisées, et pour rendre possible
l'unification du monde. Voilà comment il se fait que pour atteindre le but que poursuit la
philosophie il ne suffit pas d'édifier le système des sciences telles qu'elles existent ; mais il
faut commencer par le compléter en fondant une science nouvelle, la science de l'homme et
des sociétés. Saint-Simon ne se sert pas du mot de sociologie que Comte forgera plus tard ; il
emploie celui de physiologie sociale qui en est bien l'équivalent.
Nous pouvons maintenant nous rendre compte de l'unité de la doctrine. Nous apercevons
dès à présent les différentes parties dont elle est faite et ce qui les relie les unes aux autres.
Pour dégager le corps d'idées sur lequel doit reposer l'édifice social, il faut systématiser les
sciences, c'est-à-dire en faire une encyclopédie philosophique. Mais cette encyclopédie ne
peut remplir le rôle social qui lui est ainsi dévolu que si une science nouvelle est ajoutée à la
série des sciences instituées. C'est la physiologie sociale. Et voilà comment, pour se
rapprocher du seul et unique but qu'il ait eu en vue, Saint-Simon a été amené à sortir des
considérations purement philosophiques pour aborder les questions spécialement sociolo-
giques. C'est que l'examen des secondes est indispensable à l'avancement des premières. C'est
la condition nécessaire pour qu'elles puissent aboutir. D'ailleurs, il n'est pas passé des unes
aux autres sans esprit de retour. Tout au contraire, une fois que la science des sociétés sera
faite, il y aura lieu de reprendre l'œuvre encyclopédique, un instant suspendue. Car alors, elle
pourra faire la synthèse de toutes les connaissances humaines et embrasser l'univers tout en
restant homogène ; en effet, ne comprenant plus que des sciences positives, elle sera positive
elle-même dans son ensemble comme dans ses parties. « On voit, dit Saint-Simon, que les
sciences particulières sont les éléments de la science générale ; que la science générale, c'est-
à-dire la philosophie, a dû être conjecturale tant que les sciences particulières l'ont été... et
qu'elle sera tout à fait positive quand toutes les sciences particulières le seront. Ce qui
arrivera à l'époque où la physiologie et la psychologie (qui comprend la physiologie sociale)
seront basées sur des faits observés et discutés ; car il n'existe pas de phénomène qui ne soit
astronomique, chimique, physiologique ou psychologique » (Science de l'homme, XI, 18-19).
Et c'est avec cette philosophie positive que l'on pourra enfin constituer ce système d'idées
auquel Saint-Simon aspire avant tout, qu'il ne perd jamais de vue, système dont la religion,
en somme, est la forme éminente. Ces tours et ces détours ne sont donc qu'apparents ; ils ne
l'éloignent jamais de son but primitif ; au contraire, finalement, ils le ramènent à son point de
départ. Voilà ce qui explique comment Saint-Simon, après avoir débuté par des écrits
philosophiques, a continué par des recherches politiques et enfin a couronné sa carrière
intellectuelle par son livre du Nouveau christianisme.
*
* *
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%